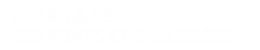JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 135
la paille hachée, sans quoi elles se fendraient à la
cuisson. L'addition de ces parties de sable et de paille
est un fait ancien et très-connu de tous les résidents,
et nous sommes étonnés qu'il ait pu échapper à l'ob-
servation de M. Spratt.
La seconde des opinions que nous avons mention-
nées admet, au contraire, que les barres et les bancs
de sable qu'on trouve à l'embouchure des fleuves sont
le résultat des apports sablonneux de ces fleuves, et
que, saisis par le courant littoral, ces apports vien-
nent naturellement s'atterrir le long des plages qui
gisent dans la direction des courants.
Entre ces deux opinions de la science, il ne nous
appartient point de prononcer ; ce n'est ni dans notre
rôle, ni dans les besoins de notre discussion, car il
nous sera facile de prouver que pour le cas spécial
dont nous nous occupons, ces deux opinions si diver-
gentes sont parfaitement d'accord entre elles pour
reconnaître que les apports du Nil ne peuvent pré-
senter aucun danger à la liberté du débouché du
canal de Suez dans la Méditerranée.
Pour la première opinion nous n'avons rien à dé-
montrer ; elle soutient que la côte de Péluse est uni-
quement formée d'apports maritimes ; que depuis un
temps immémorial elle est restée stationnaire et que,
par conséquent, l'entrée du port Saïd ne peut avoir
rien à craindre de ces invasions.
La seconde opinion a M. Paleocapa pour l'un de ses
plus illustres et plus savants représentants. En quel-
ques mots voici le résumé de son avis :
Ou les sables qui sortent des bouches du Nil ne peu-
vent plus actuellement descendre jusqu'à la rade de
Péluse et continuer à faire avancer la côte, ou cette
côte est encore sujette à un avancement progressif.
L'illustre ingénieur examine les deux cas : dans le
premier il reconnaît que l'avancement du cap de Da-
miette, le point du Delta le plus avancé sur le nord,
rejette les sables dans les grandes profondeurs de la
mer et les soustrait à l'action du courant littoral.
Dans ce cas la côte de Péluse serait dans un état d'é-
quilibre et la difficulté n'existerait pas.
Dans le second cas, les matières transportées par
le courant littoral viendraient se déposer sur les pla-
ges basses qui s'étendent au devant de la côte, soit
que ces matières proviennent du Nil, soit qu'elles pro-
viennent des corrosions de la côte africaine. Laissons
maintenant parler M. Paleocapa.
« Cette circonstance cependant, loin d'être un obsta-
» cle, facilite au contraire le moyen d'établir et de pro-
» tégerleport de Péluse; il faudrait une première jetée,
» suffisamment avancée dans la mer et placée à l'occi-
» dent du port, laquelle, soit en arrêtant les matières
» transportées par le mouvement littoral au ras du
» fond, soit en les forçant à se jeter dans les grandes
» profondeurs d'où elles ne peuvent être ramenées à
» la côte par les lames, suffirait à en éloigner les at-
» terrissements. » (Considérations sur les plages et les
ports de VAdriatique, appliquées à l'établissement d'un
port dans la baie de Péluse.)
Au moment où le savant ingénieur italien écrivait
ces considérations, la commission internationale
n'avait pas encore délibéré son projet définitif, et
M. Paleocapa avait déjà entrevu l'immanquable so-
lution du problème que, dans le moment même, dé-
couvrait l'œil exercé et pénétrant d'un autre membre
de la commission, M. Lieussou.
En effet, de la pointe septentrionale du cap de Da-
miette, le point du Delta, comme nous l'avons dit, le
plus avancé dans la mer, la côte de Péluse descend
par une pente assez rapide jusqu'à quelques kilomètres
au, delà du lac Menzaleh, :où se trouve la portion de la
baie la plus enfoncée dans le terrain de l'isthme. C'était
là que l'avant-projet avait déterminé l'embouchure
du canal comme le point abrégeant le plus la distance
entre les deux mers. Mais M. Lieussou, en inspectant
les lieux, et avec la sûreté de son expérience hydro-
graphique, avait aperçu que les vents dominants du
nord-ouest et la direction du courant littoral, si l'on
tirait une ligne de la pointe du cap dans la direction
des vents, venaient juste aboutir au fond du golfe,
tandis qu'en remontant vers Damiette, toute la côte
occidentale de la baie de Péluse était défilée en quel-
que sorte, et protégée contre les vents dominants du
nord-ouest par l'élévation et l'avancement en mer du
grand cap septentrional. C'est alors qu'il jugea que
le débouché du canal devait être remonté vers l'occident
et longer la rive orientale du lac Menzaleh. Il pensait
que dans cet emplacement on trouverait les profon-
deurs requises de huit mètres à une beaucoup moindre
distance que dans l'enfoncement du golfe ; l'événe-
ment réalisa ses prévisions ; la côte, en remontant
vers le cap de Damiette, fut reconnue beaucoup plus
déclive, et les profondeurs exigées se trouvèrent à
2,300 mètres du rivage.
La commission internationale, à l'unanimité, adopta
cette belle pensée de M. Lieussou, et moyennant cette
modification dans le plan primitif, la question de
savoir si les sables de la plage proviennent de la mer
ou proviennent du fleuve est devenue presque in-
différente, car l'inspection de la carte suffit pour
prouver qu'abritée parle cap de Damiette, l'entrée du
canal est hors de l'influence des vents de nord-ouest
et de l'action du courant littoral, qui, partant de la
pointe du cap, passent au large vers les profon-
deurs de la mer quant au débouché du chenal.
Ce fait de la protection de Port-Saïd par le cap de
Damiette est une circonstance essentielle qui, comme
tant d'autres, a complètement échappé aux observa-
tions de M. Spratt, et peut-être lui eût-il suffi pour
lui épargner toute la peine qu'il s'est donnée dans le
la paille hachée, sans quoi elles se fendraient à la
cuisson. L'addition de ces parties de sable et de paille
est un fait ancien et très-connu de tous les résidents,
et nous sommes étonnés qu'il ait pu échapper à l'ob-
servation de M. Spratt.
La seconde des opinions que nous avons mention-
nées admet, au contraire, que les barres et les bancs
de sable qu'on trouve à l'embouchure des fleuves sont
le résultat des apports sablonneux de ces fleuves, et
que, saisis par le courant littoral, ces apports vien-
nent naturellement s'atterrir le long des plages qui
gisent dans la direction des courants.
Entre ces deux opinions de la science, il ne nous
appartient point de prononcer ; ce n'est ni dans notre
rôle, ni dans les besoins de notre discussion, car il
nous sera facile de prouver que pour le cas spécial
dont nous nous occupons, ces deux opinions si diver-
gentes sont parfaitement d'accord entre elles pour
reconnaître que les apports du Nil ne peuvent pré-
senter aucun danger à la liberté du débouché du
canal de Suez dans la Méditerranée.
Pour la première opinion nous n'avons rien à dé-
montrer ; elle soutient que la côte de Péluse est uni-
quement formée d'apports maritimes ; que depuis un
temps immémorial elle est restée stationnaire et que,
par conséquent, l'entrée du port Saïd ne peut avoir
rien à craindre de ces invasions.
La seconde opinion a M. Paleocapa pour l'un de ses
plus illustres et plus savants représentants. En quel-
ques mots voici le résumé de son avis :
Ou les sables qui sortent des bouches du Nil ne peu-
vent plus actuellement descendre jusqu'à la rade de
Péluse et continuer à faire avancer la côte, ou cette
côte est encore sujette à un avancement progressif.
L'illustre ingénieur examine les deux cas : dans le
premier il reconnaît que l'avancement du cap de Da-
miette, le point du Delta le plus avancé sur le nord,
rejette les sables dans les grandes profondeurs de la
mer et les soustrait à l'action du courant littoral.
Dans ce cas la côte de Péluse serait dans un état d'é-
quilibre et la difficulté n'existerait pas.
Dans le second cas, les matières transportées par
le courant littoral viendraient se déposer sur les pla-
ges basses qui s'étendent au devant de la côte, soit
que ces matières proviennent du Nil, soit qu'elles pro-
viennent des corrosions de la côte africaine. Laissons
maintenant parler M. Paleocapa.
« Cette circonstance cependant, loin d'être un obsta-
» cle, facilite au contraire le moyen d'établir et de pro-
» tégerleport de Péluse; il faudrait une première jetée,
» suffisamment avancée dans la mer et placée à l'occi-
» dent du port, laquelle, soit en arrêtant les matières
» transportées par le mouvement littoral au ras du
» fond, soit en les forçant à se jeter dans les grandes
» profondeurs d'où elles ne peuvent être ramenées à
» la côte par les lames, suffirait à en éloigner les at-
» terrissements. » (Considérations sur les plages et les
ports de VAdriatique, appliquées à l'établissement d'un
port dans la baie de Péluse.)
Au moment où le savant ingénieur italien écrivait
ces considérations, la commission internationale
n'avait pas encore délibéré son projet définitif, et
M. Paleocapa avait déjà entrevu l'immanquable so-
lution du problème que, dans le moment même, dé-
couvrait l'œil exercé et pénétrant d'un autre membre
de la commission, M. Lieussou.
En effet, de la pointe septentrionale du cap de Da-
miette, le point du Delta, comme nous l'avons dit, le
plus avancé dans la mer, la côte de Péluse descend
par une pente assez rapide jusqu'à quelques kilomètres
au, delà du lac Menzaleh, :où se trouve la portion de la
baie la plus enfoncée dans le terrain de l'isthme. C'était
là que l'avant-projet avait déterminé l'embouchure
du canal comme le point abrégeant le plus la distance
entre les deux mers. Mais M. Lieussou, en inspectant
les lieux, et avec la sûreté de son expérience hydro-
graphique, avait aperçu que les vents dominants du
nord-ouest et la direction du courant littoral, si l'on
tirait une ligne de la pointe du cap dans la direction
des vents, venaient juste aboutir au fond du golfe,
tandis qu'en remontant vers Damiette, toute la côte
occidentale de la baie de Péluse était défilée en quel-
que sorte, et protégée contre les vents dominants du
nord-ouest par l'élévation et l'avancement en mer du
grand cap septentrional. C'est alors qu'il jugea que
le débouché du canal devait être remonté vers l'occident
et longer la rive orientale du lac Menzaleh. Il pensait
que dans cet emplacement on trouverait les profon-
deurs requises de huit mètres à une beaucoup moindre
distance que dans l'enfoncement du golfe ; l'événe-
ment réalisa ses prévisions ; la côte, en remontant
vers le cap de Damiette, fut reconnue beaucoup plus
déclive, et les profondeurs exigées se trouvèrent à
2,300 mètres du rivage.
La commission internationale, à l'unanimité, adopta
cette belle pensée de M. Lieussou, et moyennant cette
modification dans le plan primitif, la question de
savoir si les sables de la plage proviennent de la mer
ou proviennent du fleuve est devenue presque in-
différente, car l'inspection de la carte suffit pour
prouver qu'abritée parle cap de Damiette, l'entrée du
canal est hors de l'influence des vents de nord-ouest
et de l'action du courant littoral, qui, partant de la
pointe du cap, passent au large vers les profon-
deurs de la mer quant au débouché du chenal.
Ce fait de la protection de Port-Saïd par le cap de
Damiette est une circonstance essentielle qui, comme
tant d'autres, a complètement échappé aux observa-
tions de M. Spratt, et peut-être lui eût-il suffi pour
lui épargner toute la peine qu'il s'est donnée dans le
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 7/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6529959g/f7.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6529959g/f7.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6529959g/f7.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6529959g
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6529959g