Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1859-05-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 15 mai 1859 15 mai 1859
Description : 1859/05/15 (A4,N70). 1859/05/15 (A4,N70).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6529505j
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/07/2013
15 MAI. JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 156
préparatoires au moyen desquelles, nous affirme-t-on,
il sera apporté une très grande économie dans les tra-
vaux définitifs du canal.
» PnOVIN. »
LES COTES DE LA MER ROUGE.
LE YÉMEN.
Les Romains désignaient sous le nom d'Arabie heu-
reuse cette partie de la péninsule arabe qui est au
sud du Hedjaz, et que les écrivains orientaux appel-
lent aussi la perle de la mer Rouge ; et ce n'est pas
sans raison que ces qualifications caractéristiques ont
été appliquées à une région si richement douée par
la nature.
La richesse du Yémen, en effet, est extraordinaire.
Dans les plaines montueuses de l'intérieur, on re-
cueille en quantités immenses le meilleur café du
monde, de l'encens, et du lois d'aloès de la meilleure
qualité.
La café fut pour la première fois apporté en Tur-
quie dans l'année 1554, et en 1600 à Marseille et à
Venise, d'où il se répandit dans le reste de l'Europe.
L'usage s'en étend chaque jour davantage. Au mi-
lieu du XVIIe siècle l'historiographe turc Hadji Khalfa
en évaluait l'exportation annuelle à 80,000 balles de
10 faraslé (200 livres), dont 40,000 s'écoulaient par
Djeddah, et le reste par Bassorah.Si cette évaluation de
Hadji Khalfa est exacte, la production du café dans
le Yémen a seulement doublé depuis deux cents ans.
L'exportation totale de cet article précieux est aujour-
d'hui d'environ 1,562,000 faraslé, lesquels, mainte-
nant comme alors, mis en ballots de 10 faraslé (200
livres), sont exportés pour un tiers par Djeddah,
et, pour les deux autres tiers, par Hodeïda; Loheïa
et Aden , d'où ils passent en Angleterre et en
Amérique. Cette exportation représente, à 2 taléris
le faraslé comme prix moyen, une valeur totale de
3,124,000 taléris, ou au delà de 13 millions de francs.
Les sortes les plus recherchées sont celles de Kaou-
kabân, de Djébel Darfm, de Djébel Réma, d'el-Mok-
hadèr et de Chibàm. La production pourrait être en-
core plus grande, au rapport des gens du pays, si
les routes étaient plus sûres et l'administration plus
forte et moins avide. L'usage du café est inconnu
dans le Yémen ; les habitants boivent seulement une
infusion à l'eau bouillante de la pulpe du grain non
torréfié. Ils nomment cette boisson ghischr.
Le blé et la garance viennent en abondance sur les
plateaux de l'intérieur. L'indigo, le coton et le sésame
réussissent très-bien sur le littoral (le Téhama), et
une administration intelligente pourrait en faire une
source inépuisable de bien-être pour le pays.
A Dréhémi, à Beït-el-Fakih et à Zébid, il y a quel-
ques manufactures où l'on fabrique des foutas (toiles
de tête) et des rédifs. Ce dernier article est une pièce
de laine que les habitants portent le jour sur le bras,
et dont ils se font la nuit une couverture.
A Zébid , on confectionne une grande quantité de
nahhel (sandales en cuir de bœuf), pour l'usage du
Hedjaz, du Yémen et de l'Abyssinie. Une autre in-
dustrie très-répandue dans le Yémen est de teindre
en bleu des étoffes de laine blanches importées de
l'Inde et d'Angleterre. Zébid et Béït-el-Fakih four-
nissent ainsi à toutes les contrées littorales de la mer
Rouge de très-jolis milayès, comme on nomme les
mouchoirs bleus pour femmes, et des chemises éga-
lement recherchées.
La division politique du pays comprend trois cir-
conscriptions principales, le royaume d'Assyr, Abou-
Arich et le territoire de l'imam de Sana. Les parties
littorales sont depuis 1849 retombées sous l'adminis-
tration turque.
Le total des différents droits perçus dans les ports
forme un revenu d'environ 450,000 taléris ; les dé-
penses annuelles d'administration se montent à
180,000. L'excédant va à Djeddah couvrir les dépenses
d'administration du Hedjaz.
Le commerce du Yémen se fait par les ports de
Djizân, de Loheïa, de Hodeïda, de Moka et d'Aden.
Il n'est pas possible , à cause du manque complet
de négociants européens , de présenter des données
numériques exactes et précises sur le mouvement de
ces ports. Les valeurs suivantes sont fondées sur les
rapports des fermiers actuels des douanes, ou sur
ceux des principaux négociants indiens.
Loheïa. Les exportations de Loheïa sur le port de
Djeddah se sont montées, en 1856-57, à 357,800 taléris.
Elles forment la plus grande partie de l'exporta-
tion totale. Avec le surplus, le chiffre s'est élevé à
514,000 tal.
Les habitants ne sont pas renommés pour leur ha-
bileté dans la marine ; aussi laissent-ils la navigation
de leur rade en grande partie aux L "rques de Djeddah,
de Gcumfoûda et de Hodeïda.
La ville est bàtie en pierres de corail ; elle est en-
tourée d'une muraille et de forts.
Les navires ne peuvent approcher de la ville qu'à
la distance de trois milles marins ; quand le vent est
fort, ils ne peuvent faire dans la rade ouverte ni leur
chargement ni leur déchargement. Aussi l'exporta-
tion du territoire de Loheïa va-t-elle en grande partie
à Hodeïda, où la sécurité du port appelle de préférence
les navires indiens.
Hodeïda. Ce port est le plus important, après Djed-
dah, des côtes du golfe Arabique. Il doit sa proapé-
préparatoires au moyen desquelles, nous affirme-t-on,
il sera apporté une très grande économie dans les tra-
vaux définitifs du canal.
» PnOVIN. »
LES COTES DE LA MER ROUGE.
LE YÉMEN.
Les Romains désignaient sous le nom d'Arabie heu-
reuse cette partie de la péninsule arabe qui est au
sud du Hedjaz, et que les écrivains orientaux appel-
lent aussi la perle de la mer Rouge ; et ce n'est pas
sans raison que ces qualifications caractéristiques ont
été appliquées à une région si richement douée par
la nature.
La richesse du Yémen, en effet, est extraordinaire.
Dans les plaines montueuses de l'intérieur, on re-
cueille en quantités immenses le meilleur café du
monde, de l'encens, et du lois d'aloès de la meilleure
qualité.
La café fut pour la première fois apporté en Tur-
quie dans l'année 1554, et en 1600 à Marseille et à
Venise, d'où il se répandit dans le reste de l'Europe.
L'usage s'en étend chaque jour davantage. Au mi-
lieu du XVIIe siècle l'historiographe turc Hadji Khalfa
en évaluait l'exportation annuelle à 80,000 balles de
10 faraslé (200 livres), dont 40,000 s'écoulaient par
Djeddah, et le reste par Bassorah.Si cette évaluation de
Hadji Khalfa est exacte, la production du café dans
le Yémen a seulement doublé depuis deux cents ans.
L'exportation totale de cet article précieux est aujour-
d'hui d'environ 1,562,000 faraslé, lesquels, mainte-
nant comme alors, mis en ballots de 10 faraslé (200
livres), sont exportés pour un tiers par Djeddah,
et, pour les deux autres tiers, par Hodeïda; Loheïa
et Aden , d'où ils passent en Angleterre et en
Amérique. Cette exportation représente, à 2 taléris
le faraslé comme prix moyen, une valeur totale de
3,124,000 taléris, ou au delà de 13 millions de francs.
Les sortes les plus recherchées sont celles de Kaou-
kabân, de Djébel Darfm, de Djébel Réma, d'el-Mok-
hadèr et de Chibàm. La production pourrait être en-
core plus grande, au rapport des gens du pays, si
les routes étaient plus sûres et l'administration plus
forte et moins avide. L'usage du café est inconnu
dans le Yémen ; les habitants boivent seulement une
infusion à l'eau bouillante de la pulpe du grain non
torréfié. Ils nomment cette boisson ghischr.
Le blé et la garance viennent en abondance sur les
plateaux de l'intérieur. L'indigo, le coton et le sésame
réussissent très-bien sur le littoral (le Téhama), et
une administration intelligente pourrait en faire une
source inépuisable de bien-être pour le pays.
A Dréhémi, à Beït-el-Fakih et à Zébid, il y a quel-
ques manufactures où l'on fabrique des foutas (toiles
de tête) et des rédifs. Ce dernier article est une pièce
de laine que les habitants portent le jour sur le bras,
et dont ils se font la nuit une couverture.
A Zébid , on confectionne une grande quantité de
nahhel (sandales en cuir de bœuf), pour l'usage du
Hedjaz, du Yémen et de l'Abyssinie. Une autre in-
dustrie très-répandue dans le Yémen est de teindre
en bleu des étoffes de laine blanches importées de
l'Inde et d'Angleterre. Zébid et Béït-el-Fakih four-
nissent ainsi à toutes les contrées littorales de la mer
Rouge de très-jolis milayès, comme on nomme les
mouchoirs bleus pour femmes, et des chemises éga-
lement recherchées.
La division politique du pays comprend trois cir-
conscriptions principales, le royaume d'Assyr, Abou-
Arich et le territoire de l'imam de Sana. Les parties
littorales sont depuis 1849 retombées sous l'adminis-
tration turque.
Le total des différents droits perçus dans les ports
forme un revenu d'environ 450,000 taléris ; les dé-
penses annuelles d'administration se montent à
180,000. L'excédant va à Djeddah couvrir les dépenses
d'administration du Hedjaz.
Le commerce du Yémen se fait par les ports de
Djizân, de Loheïa, de Hodeïda, de Moka et d'Aden.
Il n'est pas possible , à cause du manque complet
de négociants européens , de présenter des données
numériques exactes et précises sur le mouvement de
ces ports. Les valeurs suivantes sont fondées sur les
rapports des fermiers actuels des douanes, ou sur
ceux des principaux négociants indiens.
Loheïa. Les exportations de Loheïa sur le port de
Djeddah se sont montées, en 1856-57, à 357,800 taléris.
Elles forment la plus grande partie de l'exporta-
tion totale. Avec le surplus, le chiffre s'est élevé à
514,000 tal.
Les habitants ne sont pas renommés pour leur ha-
bileté dans la marine ; aussi laissent-ils la navigation
de leur rade en grande partie aux L "rques de Djeddah,
de Gcumfoûda et de Hodeïda.
La ville est bàtie en pierres de corail ; elle est en-
tourée d'une muraille et de forts.
Les navires ne peuvent approcher de la ville qu'à
la distance de trois milles marins ; quand le vent est
fort, ils ne peuvent faire dans la rade ouverte ni leur
chargement ni leur déchargement. Aussi l'exporta-
tion du territoire de Loheïa va-t-elle en grande partie
à Hodeïda, où la sécurité du port appelle de préférence
les navires indiens.
Hodeïda. Ce port est le plus important, après Djed-
dah, des côtes du golfe Arabique. Il doit sa proapé-
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 11/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6529505j/f11.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6529505j/f11.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6529505j/f11.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6529505j
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6529505j
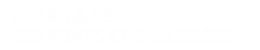


Facebook
Twitter