Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1859-02-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 15 février 1859 15 février 1859
Description : 1859/02/15 (A4,N64). 1859/02/15 (A4,N64).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k65294998
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 05/07/2013
60 L'ISTHME DE SUEZ, MARDI 15 FÉVRIER.
Ainsi dans la saison « la plus favorable » , les calculs qu'on
nous oppose exigent 30 jours du détroit à Suez, et ils n'en
demandent que 15 dans la plus défavorable !
Les navires feront le même trajet en 30 jours, vent arrière,
et en 15 jours, vent debout!
Cette deuxième erreur en engendre une troisième. L'isthme
de Suez, ajoute-t-on, ne pourra point profiter du mouvement
commercial des îles Maurice et de la Réunion, parce que les
cinq sixièmes des transports de ces colonies s'effectuant d'oc-
tobre à avril, ils aimeront mieux passer par le Cap que re-
monter la mer Rouge dans la saison la plus défavorable.
Il est établi maintenant que la saison d'octobre à avril, la
saison d'hiver, est au contraire la plus propice à cette dernière
navigation, et puisque c'est justement à cette époque que
s'opèrent les cinq sixièmes des transports pour l'Europe des
deux grandes colonies mentionnées, l'isthme indubitablement
est destiné à recevoir la masse de ce transit.
En outre, pour la durée du trajet du détroit de la Sonde à
celui de Bab-el-Mandeb, on affirme qu'il faudra : 40 jours
dans l'une des moussons, 30 jours dans l'autre; moyenne,
35 jours.
Sur quels documents, sur quels faits, ces affirmations sont-
elles appuyées? La pratique ne peut que nous instruire très-
peu à cet égard; car les navires à voiles sortant du détroit de la
Sonde viennent de Java ou de Singapore, ou des mers de la
Chine et de l'Australie, affrétés pour l'Europe ou les Indes.
Ils n'ont rien à faire aujourd'hui dans l'impasse de la mer
Rouge, fermée par la barrière qui commence à Suez.
Il n'en est pas de même au point de vue des communica-
tions maritimes entre Bab-el-Mandeb et l'Inde.
Dans l'enquête de 1834, l'officier de la marine anglaise
Jeakes, que nous avons déjà cité, atteste que, dans l'une des
deux saisons, « un bon voilier ne mettra pas plus de 12 à
n 15 jours pour se rendre de Bombay à Moka, » c'est-à-dire
à 150 milles au nord du détroit de Bab-el-Mandeb, du côté
de Suez.
Nous avons sous les yeux un tableau officiel émanant du
gouvernement de Bombay, faisant partie des pièces publiées
avec l'enquête de 1834 et constatant que dans l'autre saison,
d'avril en octobre, des barques, des navires persans, arabes,
indiens, c'est-à-dire des navigateurs peu savants et fort mal
outillés, exécutent le trajet de Moka à Bombay en 11, 12, 13
et 14 jours.
Bien plus, nous trouvons dans ce même document cette
particularité très-curieuse: de la fin de juin au commence-
ment de septembre, la barque Futteh Rymon a exécuté trois
voyages, deux d'aller de Moka à Bombay, un de retour de
Bombay à Moka, et elle ne figure point parmi ceux dont la
traversée pour Bombay a été la plus prompte.
Par conséquent, 15 jours de Bombay à Bah-el-Mandeb et
réciproquement, par l'une et l'autre mousson, telle est la large
moyenne du trajet, même pour les marins arabes et persans.
Il y a loin de là à la moyenne de 35 jours assignée à la
durée du trajet entre les deux détroits.
Il est vrai que le détroit de la Sonde est plus avancé d'une
quinzaine de degrés, environ 300 lieues, dans la mer des Indes
que Bombay. Il est vrai que pour se rendre de Bombay à Bab-
el-Mandeb, on ne passe point la ligne et qu'on la passe si l'on
part du détroit de la Sonde; mais 20 jours de différence sur
15 pour une inégalité de 300 lieues entre les deux trajets,
sous l'influence des mêmes vents, c'est un peu excessif; et des
calculs pareils ne paraîtront point plus dignes de foi pour la
mer des Indes que pour la mer Rouge.
Ainsi, erreur sur la traversée du canal, erreur sur la navi-
gation de la mer Rouge, erreur sur la navigation de la mer
des Indes, voilà où aboutissent les chiffres qui nous ont été
posés.
Malgré notre défiance de nous-même, nous pensons avoir
suffisamment éclairé les esprits sur cette première face de la
question ; nous pensons avoir fait toucher du doigt cette série
de grosses erreurs. Nous avons maintenant à remplir une tâche
moins négative.
VII.
Passera-t-il annuellement trois millions de tonneaux à tra-
vers l'isthme ouvert de Suez?
La démonstration matérielle! l'événement seul peut la
fournir, et seule elle peut fermer la bouche aux oppositions
systématiques.
Mais pour les esprits sérieux et sincères qui cherchent avec
candeur la vérité, en l'absence du chiffre acquis, il y a les
analogies et les probabilités à connaître, les circonstances à
observer, les faits à étudier, dont l'ensemble raisonné peut et
doit aboutir à une conclusion saine et logique.
Les probabilités et les analogies , en voici quelques-unes.
Tout procédé qui a pour résultat d'abréger la longueur et
de diminuer la dépense d'une route a pour premier effet de
concentrer à son foyer la masse des transports qui se meut
dans sa sphère.
Tous les transports dont le canal abrége le trajet prendront
donc, même à prix égal, le chemin du canal.
A plus forte raison ceux qui y épargneront le temps et l'ar-
gent.
Sous ces conditions, ainsi que l'ont éprouvé les chemins
de fer, la circulation s'accroît dans des proportions le plus
souvent imprévues.
Le canal de Suez abrège de trois mille lieues la route ma-
ritime entre l'Occident et l'Orient. C'est le premier fait; il est
incontestable et il est incontesté.
Dans ce mouvement des transports entre les deux hémi-
sphères déjà si vaste, se multipliant incessamment et dont on
peut à coup sûr prédire l'immense et prochaine progression,
quelle est la part que doit raisonnablement attirer dans son
cercle d'activité cette route abrégée?
Notre évaluation est au minimum trois millions de ton-
neaux; on la conteste.
Interrogeons dès lors les divers éléments du problème.
On nous accordera certainement que toute la navigation à
vapeur se dirigeant jusqu'au fond de l'extrême Orient préfé-
rera la voie de l'isthme. Voilà un premier élément.
Il est certes considérable; il se composera de tous les stea-
mers entretenant les communications entre toute l'Europe d'un
côté, et de l'autre avec l'Inde, les îles de la Sonde, l'Indo-
Chine, la Chine, le Japon, les continents australiens, etc. Il
y faut joindre le développement de la navigation à vapeur
provoquée inévitablement par la rapidité et la continuité dos
voyages sans transbordements, des limites les plus reculées de
l'Orient à toutes les mers de l' Europe.
On nous accordera encore sans difficulté que le transport
du combustible nécessaire à tous ces grands consommateurs
du charbon, que les dépôts de la mer Rouge et de la mer des
Indes seront alimentés au moyen du canal, car les transports
y gagneront dans certains cas jusqu'aux deux tiers et aux trois
quarts de la distance. Voilà un second élément.
Mentionnons encore les produits de Maurice et de la Réu-
nion, qui, comme on l'a vu d'après les saisons, auront un
temps favorable à l'aller et au retour. Voilà un troisième élé-
ment.
Ainsi dans la saison « la plus favorable » , les calculs qu'on
nous oppose exigent 30 jours du détroit à Suez, et ils n'en
demandent que 15 dans la plus défavorable !
Les navires feront le même trajet en 30 jours, vent arrière,
et en 15 jours, vent debout!
Cette deuxième erreur en engendre une troisième. L'isthme
de Suez, ajoute-t-on, ne pourra point profiter du mouvement
commercial des îles Maurice et de la Réunion, parce que les
cinq sixièmes des transports de ces colonies s'effectuant d'oc-
tobre à avril, ils aimeront mieux passer par le Cap que re-
monter la mer Rouge dans la saison la plus défavorable.
Il est établi maintenant que la saison d'octobre à avril, la
saison d'hiver, est au contraire la plus propice à cette dernière
navigation, et puisque c'est justement à cette époque que
s'opèrent les cinq sixièmes des transports pour l'Europe des
deux grandes colonies mentionnées, l'isthme indubitablement
est destiné à recevoir la masse de ce transit.
En outre, pour la durée du trajet du détroit de la Sonde à
celui de Bab-el-Mandeb, on affirme qu'il faudra : 40 jours
dans l'une des moussons, 30 jours dans l'autre; moyenne,
35 jours.
Sur quels documents, sur quels faits, ces affirmations sont-
elles appuyées? La pratique ne peut que nous instruire très-
peu à cet égard; car les navires à voiles sortant du détroit de la
Sonde viennent de Java ou de Singapore, ou des mers de la
Chine et de l'Australie, affrétés pour l'Europe ou les Indes.
Ils n'ont rien à faire aujourd'hui dans l'impasse de la mer
Rouge, fermée par la barrière qui commence à Suez.
Il n'en est pas de même au point de vue des communica-
tions maritimes entre Bab-el-Mandeb et l'Inde.
Dans l'enquête de 1834, l'officier de la marine anglaise
Jeakes, que nous avons déjà cité, atteste que, dans l'une des
deux saisons, « un bon voilier ne mettra pas plus de 12 à
n 15 jours pour se rendre de Bombay à Moka, » c'est-à-dire
à 150 milles au nord du détroit de Bab-el-Mandeb, du côté
de Suez.
Nous avons sous les yeux un tableau officiel émanant du
gouvernement de Bombay, faisant partie des pièces publiées
avec l'enquête de 1834 et constatant que dans l'autre saison,
d'avril en octobre, des barques, des navires persans, arabes,
indiens, c'est-à-dire des navigateurs peu savants et fort mal
outillés, exécutent le trajet de Moka à Bombay en 11, 12, 13
et 14 jours.
Bien plus, nous trouvons dans ce même document cette
particularité très-curieuse: de la fin de juin au commence-
ment de septembre, la barque Futteh Rymon a exécuté trois
voyages, deux d'aller de Moka à Bombay, un de retour de
Bombay à Moka, et elle ne figure point parmi ceux dont la
traversée pour Bombay a été la plus prompte.
Par conséquent, 15 jours de Bombay à Bah-el-Mandeb et
réciproquement, par l'une et l'autre mousson, telle est la large
moyenne du trajet, même pour les marins arabes et persans.
Il y a loin de là à la moyenne de 35 jours assignée à la
durée du trajet entre les deux détroits.
Il est vrai que le détroit de la Sonde est plus avancé d'une
quinzaine de degrés, environ 300 lieues, dans la mer des Indes
que Bombay. Il est vrai que pour se rendre de Bombay à Bab-
el-Mandeb, on ne passe point la ligne et qu'on la passe si l'on
part du détroit de la Sonde; mais 20 jours de différence sur
15 pour une inégalité de 300 lieues entre les deux trajets,
sous l'influence des mêmes vents, c'est un peu excessif; et des
calculs pareils ne paraîtront point plus dignes de foi pour la
mer des Indes que pour la mer Rouge.
Ainsi, erreur sur la traversée du canal, erreur sur la navi-
gation de la mer Rouge, erreur sur la navigation de la mer
des Indes, voilà où aboutissent les chiffres qui nous ont été
posés.
Malgré notre défiance de nous-même, nous pensons avoir
suffisamment éclairé les esprits sur cette première face de la
question ; nous pensons avoir fait toucher du doigt cette série
de grosses erreurs. Nous avons maintenant à remplir une tâche
moins négative.
VII.
Passera-t-il annuellement trois millions de tonneaux à tra-
vers l'isthme ouvert de Suez?
La démonstration matérielle! l'événement seul peut la
fournir, et seule elle peut fermer la bouche aux oppositions
systématiques.
Mais pour les esprits sérieux et sincères qui cherchent avec
candeur la vérité, en l'absence du chiffre acquis, il y a les
analogies et les probabilités à connaître, les circonstances à
observer, les faits à étudier, dont l'ensemble raisonné peut et
doit aboutir à une conclusion saine et logique.
Les probabilités et les analogies , en voici quelques-unes.
Tout procédé qui a pour résultat d'abréger la longueur et
de diminuer la dépense d'une route a pour premier effet de
concentrer à son foyer la masse des transports qui se meut
dans sa sphère.
Tous les transports dont le canal abrége le trajet prendront
donc, même à prix égal, le chemin du canal.
A plus forte raison ceux qui y épargneront le temps et l'ar-
gent.
Sous ces conditions, ainsi que l'ont éprouvé les chemins
de fer, la circulation s'accroît dans des proportions le plus
souvent imprévues.
Le canal de Suez abrège de trois mille lieues la route ma-
ritime entre l'Occident et l'Orient. C'est le premier fait; il est
incontestable et il est incontesté.
Dans ce mouvement des transports entre les deux hémi-
sphères déjà si vaste, se multipliant incessamment et dont on
peut à coup sûr prédire l'immense et prochaine progression,
quelle est la part que doit raisonnablement attirer dans son
cercle d'activité cette route abrégée?
Notre évaluation est au minimum trois millions de ton-
neaux; on la conteste.
Interrogeons dès lors les divers éléments du problème.
On nous accordera certainement que toute la navigation à
vapeur se dirigeant jusqu'au fond de l'extrême Orient préfé-
rera la voie de l'isthme. Voilà un premier élément.
Il est certes considérable; il se composera de tous les stea-
mers entretenant les communications entre toute l'Europe d'un
côté, et de l'autre avec l'Inde, les îles de la Sonde, l'Indo-
Chine, la Chine, le Japon, les continents australiens, etc. Il
y faut joindre le développement de la navigation à vapeur
provoquée inévitablement par la rapidité et la continuité dos
voyages sans transbordements, des limites les plus reculées de
l'Orient à toutes les mers de l' Europe.
On nous accordera encore sans difficulté que le transport
du combustible nécessaire à tous ces grands consommateurs
du charbon, que les dépôts de la mer Rouge et de la mer des
Indes seront alimentés au moyen du canal, car les transports
y gagneront dans certains cas jusqu'aux deux tiers et aux trois
quarts de la distance. Voilà un second élément.
Mentionnons encore les produits de Maurice et de la Réu-
nion, qui, comme on l'a vu d'après les saisons, auront un
temps favorable à l'aller et au retour. Voilà un troisième élé-
ment.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 12/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k65294998/f12.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k65294998/f12.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k65294998/f12.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k65294998
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k65294998
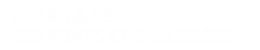


Facebook
Twitter