Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-06-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 juin 1863 01 juin 1863
Description : 1863/06/01 (A8,N167). 1863/06/01 (A8,N167).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62032469
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
182 L'ISTHME DE SUEZ,
» Je ne puis comprendre d'où pourrait s'élever aucune
opposition, d'abord, parce que le sultan a parfaitement
le droit de faire des lois pour ses sujets, et ensuite
parce que l'Angleterre et la France, comme deux des
grandes puissances, ont pris, par traité, l'engagement
de respecter l'indépendance du sultan et l'intégrité de
l'empire turc. Je pense donc que l'Angleterre et la
France sont obligées en honneur de soutenir le sultan
dans une résolution si sage et si humaine, et je ne puis
concevoir de quel autre côté pourrait survenir une
opposition. «
Si des doutes avaient pu s'élever sur l'origine de
la note turque, ces paroles de lord Palmerston les
dissiperaient jusqu'au dernier.
Lord Palmerston doit être aujourd'hui édifié sur le
sentiment de la France. Il sait qu'au lieu de consi-
dérer la note du 6 avril comme un acte d'indépen-
dance du gouvernement turc, elle la regarde au con-
traire comme un acte d'asservissement qui place le
sultan presque au niveau du roi de Delhi, avant qu'il
ne fût jugé et condamné pour rébellion, par une
cour martiale d'officiers anglais.
Ce jugement de la France est celui du monde
entier.
En vérité, à qui lord Palmerston pense-t-il faire
allusion par ce renversement des rôles? Il croit donc
la Franca et l'Europe bien simples, ou il a un bien
profond dédain pour la répulsion que cette hypo-
crisie naïve ne peut manquer de leur inspirer. Sur
cet incident l'Europe et la France se sont prononcées
d'un seul élan et à l'unanimité. A leurs yeux, la
note turque n'est autre chose qu'un sacrifice de ses
intérêts et de sa dignité imposé à la Turquie par la
compression, par « la violence », c'est le mot de la
Gazette d'Augsbourg, dont ont fait un si large usage
en cette occasion les agents britanniques.
Lord Palmerston affecte de se poser en toute cir-
constance, non comme l'allié, mais comme le pro-
tecteur en quelque sorte souverain de la Turquie.
Nous n'hésitons pas à dire qu'il vient de s'en mon-
trer le plus grand ennemi ; qu'il vient de lui porter
l'atteinte la plus désastreuse en prouvant à l'opinion
universelle que la Turquie ne s'appartenait pas, et
que le sang français et italien versé pour son affran-
chissement d'une domination extérieure, n'a servi
qu'à lui donner un autre maître étranger.
Ce sont là de tristes. et graves précédents pour
l'avenir, et l'Angleterre, nous en sommes convaincu,
n'en recueillera pas de meilleurs fruits que la Tur-
quie.
Examinons cependant les arguments employés par
lord Palmerston. Naturellement ils sont exactement
ceux de la note turque; par conséquent, en répon-
dant à l'un nous répondons nécessairement à l'autre,
ou plutôt, nous répondons à la fois à la dictée du
noble lord à Constantinople et à la répétition de
cette dictée devant la Chambre des communes.
En ce qui concerne le travail forcé, et c'est la seule
question que nous voulions aborder ici, la note et le
discours se fondent sur un seul et même principe.
C'est le point de départ, c'est la base de toute la dis-
cussion. La Turquie a, dit-on, aboli le travail forcé
sur toute la surface de son empire. L'Egypte seule
s'est soustraite jusqu'ici à l'application de cette loi.
Il est temps de la faire rentrer dans le droit commun
qui protège tous les sujets du sultan.
En nous abstenant de toute autre considération, et
il y en aurait de nombreuses et de péremptoires à
faire valoir, c'est donc sur cette loi que reposeraient
la légitimité et lajustification, contestables ou non
contestables de la prétention anglo-turque.
La Porte veut faire jouir l'Egypte d'un bienfait légal
qu'elle aurait décrété et garanti à ses propres pro-
vinces.
Quels sont les termes de cette loi? Où est-elle ? A
quelle époque a-t-elle paru? Dans quel recueil peut-on
la découvrir ? C'est ce que nous avons commencé par
nous demander. Nous avons d'abord voulu résoudre
ces questions par nous-même. Nous avons cherché
dans le hatti-cheriff de Gulhané de 1839, dans le
hatti-houmayoum de 1856, dans les divers recueils où
il est parlé de la législation turque, et nous n'avons
rien rencontré qui ressemblât, de près ou de loin, à une
loi relative à la suppression du travail forcé. Nous
nous sommes alors adressé aux hommes les plus fa-
miliers avec les lois et les affaires de la Turquie. Nous
les avons priés de nous éclairer et de nous indiquer
s'ils avaient quelque connaissance de cette loi pour nous
introuvable; ils nous ont tous répondu négativement,
et certes nous n'avons pu trouver d'éléments propres
à nous guider à cet égard dans les vagues et presque
évasives assertions et de la note turco-anglaise et du
discours de lord Palmerston.
L'insuccès de nos recherches nous a fait souvenir
que nous avions reçu les premières notions de l'exis-
tence de cette mesure par le parlement anglais et de
la bouche de M. Griffith lui-même. On ne s'en était
pas avisé ou douté en Angleterre avant que des fel-
lahs fussent employés aux travaux du canal de Suez.
Evidemment on l'ignorait dans ce pays lorsque de
1851 à 1855, les agents anglais obligeaient Abbas-Pacha
de construire pour le transit de la malle des Indes,
par le travail forcé, le chemin de fer d'Alexandrie au
Caire. On l'ignorait aussi lorsque, par les obsessions
et les instances de ces mêmes agents, Saïd-Pacha, de
1856 à 1860, faisait prolonger ce chemin, du Caire
jusqu'à Suez, toujours par le travail forcé. Continuait-
on à l'ignorer lorsque, pas plus tard que l'année
dernière , dans l'hiver de 1861-62, une violente
tempête ayant enlevé une grande partie de ce che-
min et interrompu le service du transit entre Alexan-
drie et Suez, la diplomatie anglaise insista, persécuta
» Je ne puis comprendre d'où pourrait s'élever aucune
opposition, d'abord, parce que le sultan a parfaitement
le droit de faire des lois pour ses sujets, et ensuite
parce que l'Angleterre et la France, comme deux des
grandes puissances, ont pris, par traité, l'engagement
de respecter l'indépendance du sultan et l'intégrité de
l'empire turc. Je pense donc que l'Angleterre et la
France sont obligées en honneur de soutenir le sultan
dans une résolution si sage et si humaine, et je ne puis
concevoir de quel autre côté pourrait survenir une
opposition. «
Si des doutes avaient pu s'élever sur l'origine de
la note turque, ces paroles de lord Palmerston les
dissiperaient jusqu'au dernier.
Lord Palmerston doit être aujourd'hui édifié sur le
sentiment de la France. Il sait qu'au lieu de consi-
dérer la note du 6 avril comme un acte d'indépen-
dance du gouvernement turc, elle la regarde au con-
traire comme un acte d'asservissement qui place le
sultan presque au niveau du roi de Delhi, avant qu'il
ne fût jugé et condamné pour rébellion, par une
cour martiale d'officiers anglais.
Ce jugement de la France est celui du monde
entier.
En vérité, à qui lord Palmerston pense-t-il faire
allusion par ce renversement des rôles? Il croit donc
la Franca et l'Europe bien simples, ou il a un bien
profond dédain pour la répulsion que cette hypo-
crisie naïve ne peut manquer de leur inspirer. Sur
cet incident l'Europe et la France se sont prononcées
d'un seul élan et à l'unanimité. A leurs yeux, la
note turque n'est autre chose qu'un sacrifice de ses
intérêts et de sa dignité imposé à la Turquie par la
compression, par « la violence », c'est le mot de la
Gazette d'Augsbourg, dont ont fait un si large usage
en cette occasion les agents britanniques.
Lord Palmerston affecte de se poser en toute cir-
constance, non comme l'allié, mais comme le pro-
tecteur en quelque sorte souverain de la Turquie.
Nous n'hésitons pas à dire qu'il vient de s'en mon-
trer le plus grand ennemi ; qu'il vient de lui porter
l'atteinte la plus désastreuse en prouvant à l'opinion
universelle que la Turquie ne s'appartenait pas, et
que le sang français et italien versé pour son affran-
chissement d'une domination extérieure, n'a servi
qu'à lui donner un autre maître étranger.
Ce sont là de tristes. et graves précédents pour
l'avenir, et l'Angleterre, nous en sommes convaincu,
n'en recueillera pas de meilleurs fruits que la Tur-
quie.
Examinons cependant les arguments employés par
lord Palmerston. Naturellement ils sont exactement
ceux de la note turque; par conséquent, en répon-
dant à l'un nous répondons nécessairement à l'autre,
ou plutôt, nous répondons à la fois à la dictée du
noble lord à Constantinople et à la répétition de
cette dictée devant la Chambre des communes.
En ce qui concerne le travail forcé, et c'est la seule
question que nous voulions aborder ici, la note et le
discours se fondent sur un seul et même principe.
C'est le point de départ, c'est la base de toute la dis-
cussion. La Turquie a, dit-on, aboli le travail forcé
sur toute la surface de son empire. L'Egypte seule
s'est soustraite jusqu'ici à l'application de cette loi.
Il est temps de la faire rentrer dans le droit commun
qui protège tous les sujets du sultan.
En nous abstenant de toute autre considération, et
il y en aurait de nombreuses et de péremptoires à
faire valoir, c'est donc sur cette loi que reposeraient
la légitimité et lajustification, contestables ou non
contestables de la prétention anglo-turque.
La Porte veut faire jouir l'Egypte d'un bienfait légal
qu'elle aurait décrété et garanti à ses propres pro-
vinces.
Quels sont les termes de cette loi? Où est-elle ? A
quelle époque a-t-elle paru? Dans quel recueil peut-on
la découvrir ? C'est ce que nous avons commencé par
nous demander. Nous avons d'abord voulu résoudre
ces questions par nous-même. Nous avons cherché
dans le hatti-cheriff de Gulhané de 1839, dans le
hatti-houmayoum de 1856, dans les divers recueils où
il est parlé de la législation turque, et nous n'avons
rien rencontré qui ressemblât, de près ou de loin, à une
loi relative à la suppression du travail forcé. Nous
nous sommes alors adressé aux hommes les plus fa-
miliers avec les lois et les affaires de la Turquie. Nous
les avons priés de nous éclairer et de nous indiquer
s'ils avaient quelque connaissance de cette loi pour nous
introuvable; ils nous ont tous répondu négativement,
et certes nous n'avons pu trouver d'éléments propres
à nous guider à cet égard dans les vagues et presque
évasives assertions et de la note turco-anglaise et du
discours de lord Palmerston.
L'insuccès de nos recherches nous a fait souvenir
que nous avions reçu les premières notions de l'exis-
tence de cette mesure par le parlement anglais et de
la bouche de M. Griffith lui-même. On ne s'en était
pas avisé ou douté en Angleterre avant que des fel-
lahs fussent employés aux travaux du canal de Suez.
Evidemment on l'ignorait dans ce pays lorsque de
1851 à 1855, les agents anglais obligeaient Abbas-Pacha
de construire pour le transit de la malle des Indes,
par le travail forcé, le chemin de fer d'Alexandrie au
Caire. On l'ignorait aussi lorsque, par les obsessions
et les instances de ces mêmes agents, Saïd-Pacha, de
1856 à 1860, faisait prolonger ce chemin, du Caire
jusqu'à Suez, toujours par le travail forcé. Continuait-
on à l'ignorer lorsque, pas plus tard que l'année
dernière , dans l'hiver de 1861-62, une violente
tempête ayant enlevé une grande partie de ce che-
min et interrompu le service du transit entre Alexan-
drie et Suez, la diplomatie anglaise insista, persécuta
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.97%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.97%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 6/32
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k62032469/f6.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k62032469/f6.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k62032469/f6.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k62032469
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k62032469
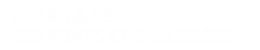


Facebook
Twitter