Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-03-01
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 01 mars 1863 01 mars 1863
Description : 1863/03/01 (A8,N161). 1863/03/01 (A8,N161).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203240t
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
'18 L'ISTHME DE SUEZ,
marin, resplendissent entre deux bourrelets de sables,
roulés jadis et déposés là par les eaux. Bientôt appa-
raissent, non loin des ruines de Cambysis, les premiers
vestiges du canal attribué aux Pharaons.
» Ce canal se prolonge sans interruption vers la mer
Rouge. Sa largeur est d'environ 50 mètres. 11 se pro-
longe ainsi sur une étendue de cinq à six lieues, ac-
cusant un relief d'autant moins sensible qu'il se rap-
proche davantage de Suez.
» Or, s'agissait-il pour les Pharaons d'ouvrir entre les
deux mers une voie navigable qui rapprochât l'Orient
de l'Occident? Comment le supposer quand on sait que
l'Egypte était interdite aux étrangers ; que les débris
des peuples pasteurs cantonnes sur ses côtes avaient
pour mission d'égorger et de piller quiconque tenterait
d'y attérir; qu'un seul port était ouvert aux négociants
des autres pays; que les Egyptiens, en un mot, vrais
Chinois de l'Afrique, ne devaient pas connaître d'autres
dieux que les leurs, d'autres rois que les leurs.
« Amener les eaux du Nil sur le versant occidental
de l'isthme, les y soumettre au même régime que
dans le reste de leurs États, et féconder ainsi le sol au
moyen d'inondations et d'irrigations régulières, telle
fut la pensée des Pharaons lorsqu'ils entreprirent ces
immenses travaux hydrauliques, auxquels sont restés
attachés les noms de Sésostris et de Néchos.
« Le Nil, à l'époque de ses crues, entrait par deux en-
droits dans les vallées de l'isthme, au nord par les lacs
Meuzaleh et Ballah, et son flot venait battre les der-
nières pentes du seuil d'El-Guisr; à l'ouest, par le Tel
Basta ou terre de Bubaste, et il descendait de ce côté
au lac Timsah. Donc, l'un des prédécesseurs d'Améno-
phis 111, le Pharaon de la Bible, n'eut qu'à abaisser
aux environs de Bubaste les berges du pour établir
jusqu'au lac Timsah, et perpendiculairement au thalweg
de l'isthme, une dérivation continue, qui permit d'ar-
roser tout le sol riverain sur un parcours d'environ
15 lieues. Ce canal fut endigué, et l'on disposa par éta-
ges sur ses bords une série de bassins propres à en
recevoir les eaux. Une simple rigole d'écoulement suf-
fisait ensuite pour déverser dans les lacs Amers le trop
plein du lac Timsah. Les crocodiles suivaient, au mo-
ment des crues, le flot montant du Nil et se rendaient
au lac, où un grand nombre d'entre eux fixaient leur
résidence. Le canal leur servait de promenade. C'est ce
que nous apprend une ancienne inscription recueillie
dans le temple de Karnac, à Thèbes. D'autre part,
timsah. en arabe, veut dire crocodile. Nul doute, par con-
séquent, que les plus délicats de ces amphibies, fati-
gués très-probablement du poisson de la Méditerranée,
ne soient venus au lac Timsah goûter celui de la mer
Rouge; ce qui ne les empêchait pas de happer, quand
l'occasion s'en présentait, les dévots Égyptiens qui n'a-
vaient pas soin de les adorer à une distance suffisam-
ment respectueuse.
» Ainsi fut conquise sur le désert la grande vallée de
l'isthme de Suez qui s'étend de Bubaste au lac Timsah.
C'est l'Ouadée Toumilat des Arabes, la contrée des pâtu-
rages, cette terre de Gessen où s'établit la postérité de
Jacob, et que Moïse illustra par ses miracles. Vers Bel-
beïs, le Tel-el-Ioudieh rappelle encore la terre des Juifs;
Abasce est l'Avaris deJosèphe,capitale des rois pasteurs,
le Raz-el-Ouadée, le Toum et Pithoum construit par les
Hébreux sur les confins de l'Arabie et del'Égypte; enfin,
Tel-el-Héroan marque l'emplacement d'Héroopolis, ville
d'une ancienneté respectable, puisqu'elle fut contempo-
raine de Jacob. On voit sur son territoire une statue de
ce Ramsès, père d'Aménophis III, en présence duquel
Moïse et les Robert-Houdin attachés à la cour de ce
prince, opérèrent les prodiges que l'on sait.
» Les lacs Amers n'étaient pas, à cette époque, séparés
de la mer Rouge, dont ils formaient les dernières la-
gunes. Moïse partit d'Héroopolis, alors appelée Ramses,
avec son peuple.
La seconde station des Hébreux fut Socoth, aujourd'hui
Oum-Riam, la mère des tentes. De là, guidé par l'inspira-
tion divine, Moïse rebroussa chemin et vint s'établir à
Si Hahiroth, la baie des roseaux, sur la rive égyptienne
du lac Timsah.
» Aménophis et son armée approchaient. Les Israélites
s'étant engagés dans les lagunes de la mer Rouge, le
Pharaon osa les y suivre et fut englouti sous les flots,
lui, ses fantassins, ses cavaliers et ses chars.
» Après les travaux exécutés pour mettre la vallée de
Gessen en culture, aucune autre entreprise ne vint éten-
dre le bienfait des inondations au reste de l'isthme,
jusqu'à Néchos, fils de Psamméticus, qui vécut six cents
ans avant Jésus-Christ. Les levées du grand canal qu'on
aperçoit de nos jours au pied du seuil d'El-Guisr, sont
attribuées à ce prince. Rien de plus facile à concevoir
que son projet, si l'on veut admettre avec d'Anville,
qu'il fit pratiquer une seconde prise d'eau à Phacusa,
le Facous des Arabes, sur la branche pélusiaque du
Nil. On serait conduit par là à supposer que Néchos
construisit en cet endroit un canal à point de partage,
courant de l'ouest à l'est, parallèlement à celui des an-
ciens Pharaons, et dont une branche se serait déversée
dans le lac Timsah, tandis que l'autre aurait gagné les
lacs Ballah et Menzaleh. Le fils de Psamméticus aurait
ainsi fécondé la partie nord de l'isthme, comme ses
prédécesseurs l'avaient fait pour les vallées centrales.
Quant à celles de l'extrémité sud, on y retrouve, il est
vrai, les traces du limon du Nil sur tout le parcours de
la route de poste qui va du Caire à Suez. Mais comment
les eaux du fleuve sont-elles parvenues à cette distance?
Des travaux d'art ont-ils été jamais pratiqués pour les y
conduire ? Sur ce point l'histoire ne nous fournit aucun
renseignement.
» On a dit que Néchos avait été arrêté dans l'exécu-
tion de ses plans par la crainte que la mer Rouge,
plus élevée que le sol de l'Égypte, suivant l'ancienne
tradition consignée dans la Météorologie d'Aristote, n'en-
vahît son royaume, et, se mêlant aux eaux du Nil, n'en
changeât absolument le cours. Mais comment supposer
une semblable appréhension chez un prince qui devait
si bien connaître l'hydrographie de l'isthme, et qui
avait pu mesurer si souvent, sur les berges des lacs
Amers, le niveau des plus hautes marées?
»> On assure qu'il perdit cent mille hommes dans ses
entreprises, soit par excès de fatigue, soit par défaut
marin, resplendissent entre deux bourrelets de sables,
roulés jadis et déposés là par les eaux. Bientôt appa-
raissent, non loin des ruines de Cambysis, les premiers
vestiges du canal attribué aux Pharaons.
» Ce canal se prolonge sans interruption vers la mer
Rouge. Sa largeur est d'environ 50 mètres. 11 se pro-
longe ainsi sur une étendue de cinq à six lieues, ac-
cusant un relief d'autant moins sensible qu'il se rap-
proche davantage de Suez.
» Or, s'agissait-il pour les Pharaons d'ouvrir entre les
deux mers une voie navigable qui rapprochât l'Orient
de l'Occident? Comment le supposer quand on sait que
l'Egypte était interdite aux étrangers ; que les débris
des peuples pasteurs cantonnes sur ses côtes avaient
pour mission d'égorger et de piller quiconque tenterait
d'y attérir; qu'un seul port était ouvert aux négociants
des autres pays; que les Egyptiens, en un mot, vrais
Chinois de l'Afrique, ne devaient pas connaître d'autres
dieux que les leurs, d'autres rois que les leurs.
« Amener les eaux du Nil sur le versant occidental
de l'isthme, les y soumettre au même régime que
dans le reste de leurs États, et féconder ainsi le sol au
moyen d'inondations et d'irrigations régulières, telle
fut la pensée des Pharaons lorsqu'ils entreprirent ces
immenses travaux hydrauliques, auxquels sont restés
attachés les noms de Sésostris et de Néchos.
« Le Nil, à l'époque de ses crues, entrait par deux en-
droits dans les vallées de l'isthme, au nord par les lacs
Meuzaleh et Ballah, et son flot venait battre les der-
nières pentes du seuil d'El-Guisr; à l'ouest, par le Tel
Basta ou terre de Bubaste, et il descendait de ce côté
au lac Timsah. Donc, l'un des prédécesseurs d'Améno-
phis 111, le Pharaon de la Bible, n'eut qu'à abaisser
aux environs de Bubaste les berges du pour établir
jusqu'au lac Timsah, et perpendiculairement au thalweg
de l'isthme, une dérivation continue, qui permit d'ar-
roser tout le sol riverain sur un parcours d'environ
15 lieues. Ce canal fut endigué, et l'on disposa par éta-
ges sur ses bords une série de bassins propres à en
recevoir les eaux. Une simple rigole d'écoulement suf-
fisait ensuite pour déverser dans les lacs Amers le trop
plein du lac Timsah. Les crocodiles suivaient, au mo-
ment des crues, le flot montant du Nil et se rendaient
au lac, où un grand nombre d'entre eux fixaient leur
résidence. Le canal leur servait de promenade. C'est ce
que nous apprend une ancienne inscription recueillie
dans le temple de Karnac, à Thèbes. D'autre part,
timsah. en arabe, veut dire crocodile. Nul doute, par con-
séquent, que les plus délicats de ces amphibies, fati-
gués très-probablement du poisson de la Méditerranée,
ne soient venus au lac Timsah goûter celui de la mer
Rouge; ce qui ne les empêchait pas de happer, quand
l'occasion s'en présentait, les dévots Égyptiens qui n'a-
vaient pas soin de les adorer à une distance suffisam-
ment respectueuse.
» Ainsi fut conquise sur le désert la grande vallée de
l'isthme de Suez qui s'étend de Bubaste au lac Timsah.
C'est l'Ouadée Toumilat des Arabes, la contrée des pâtu-
rages, cette terre de Gessen où s'établit la postérité de
Jacob, et que Moïse illustra par ses miracles. Vers Bel-
beïs, le Tel-el-Ioudieh rappelle encore la terre des Juifs;
Abasce est l'Avaris deJosèphe,capitale des rois pasteurs,
le Raz-el-Ouadée, le Toum et Pithoum construit par les
Hébreux sur les confins de l'Arabie et del'Égypte; enfin,
Tel-el-Héroan marque l'emplacement d'Héroopolis, ville
d'une ancienneté respectable, puisqu'elle fut contempo-
raine de Jacob. On voit sur son territoire une statue de
ce Ramsès, père d'Aménophis III, en présence duquel
Moïse et les Robert-Houdin attachés à la cour de ce
prince, opérèrent les prodiges que l'on sait.
» Les lacs Amers n'étaient pas, à cette époque, séparés
de la mer Rouge, dont ils formaient les dernières la-
gunes. Moïse partit d'Héroopolis, alors appelée Ramses,
avec son peuple.
La seconde station des Hébreux fut Socoth, aujourd'hui
Oum-Riam, la mère des tentes. De là, guidé par l'inspira-
tion divine, Moïse rebroussa chemin et vint s'établir à
Si Hahiroth, la baie des roseaux, sur la rive égyptienne
du lac Timsah.
» Aménophis et son armée approchaient. Les Israélites
s'étant engagés dans les lagunes de la mer Rouge, le
Pharaon osa les y suivre et fut englouti sous les flots,
lui, ses fantassins, ses cavaliers et ses chars.
» Après les travaux exécutés pour mettre la vallée de
Gessen en culture, aucune autre entreprise ne vint éten-
dre le bienfait des inondations au reste de l'isthme,
jusqu'à Néchos, fils de Psamméticus, qui vécut six cents
ans avant Jésus-Christ. Les levées du grand canal qu'on
aperçoit de nos jours au pied du seuil d'El-Guisr, sont
attribuées à ce prince. Rien de plus facile à concevoir
que son projet, si l'on veut admettre avec d'Anville,
qu'il fit pratiquer une seconde prise d'eau à Phacusa,
le Facous des Arabes, sur la branche pélusiaque du
Nil. On serait conduit par là à supposer que Néchos
construisit en cet endroit un canal à point de partage,
courant de l'ouest à l'est, parallèlement à celui des an-
ciens Pharaons, et dont une branche se serait déversée
dans le lac Timsah, tandis que l'autre aurait gagné les
lacs Ballah et Menzaleh. Le fils de Psamméticus aurait
ainsi fécondé la partie nord de l'isthme, comme ses
prédécesseurs l'avaient fait pour les vallées centrales.
Quant à celles de l'extrémité sud, on y retrouve, il est
vrai, les traces du limon du Nil sur tout le parcours de
la route de poste qui va du Caire à Suez. Mais comment
les eaux du fleuve sont-elles parvenues à cette distance?
Des travaux d'art ont-ils été jamais pratiqués pour les y
conduire ? Sur ce point l'histoire ne nous fournit aucun
renseignement.
» On a dit que Néchos avait été arrêté dans l'exécu-
tion de ses plans par la crainte que la mer Rouge,
plus élevée que le sol de l'Égypte, suivant l'ancienne
tradition consignée dans la Météorologie d'Aristote, n'en-
vahît son royaume, et, se mêlant aux eaux du Nil, n'en
changeât absolument le cours. Mais comment supposer
une semblable appréhension chez un prince qui devait
si bien connaître l'hydrographie de l'isthme, et qui
avait pu mesurer si souvent, sur les berges des lacs
Amers, le niveau des plus hautes marées?
»> On assure qu'il perdit cent mille hommes dans ses
entreprises, soit par excès de fatigue, soit par défaut
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.95%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.95%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 14/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6203240t/f14.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6203240t/f14.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6203240t/f14.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6203240t
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6203240t
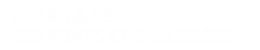


Facebook
Twitter