Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1863-02-15
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 15 février 1863 15 février 1863
Description : 1863/02/15 (A8,N160). 1863/02/15 (A8,N160).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k62032395
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 26/11/2012
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 61
accrédité un consul. Il n'est pas sans intérêt de rappe-
ler que c'est grâce à ce transit que quelques cabanes
de pêcheurs s'étaient changées en une cité populeuse
et florissante. La statistique de l'Amérique septen-
trionale , si riche en phénomènes de ce genre, ne
présente aucun exemple que l'on puisse comparer
au rapide et prodigieux accroissement d'Odessa.
» Le gouvernement russe, en cette circonstance,
n'hésitait pas à sacrifier les intérêts particuliers d'O-
dessa aux intérêts généraux de l'Etat. Il ne voulut pas
que les étrangers pussent atteindre avec lui aux sour-
ces d'un trafic qui, de jour en jour, grandissait en ex-
tension et en importance. En défendant le transit par
ses Etats, la Russie eut pour but d'encourager ses ma-
nufactures indigènes, et de les mettre en état de suffire
seules aux échanges qui constituent le commerce avec
l'Asie.
» Cette prohibition inattendue frappa douloureuse-
ment les industries françaises, allemandes et anglaises.
Mais l'impulsion était donnée ; l'Europe productrice et
manufacturière éprouvait désormais la nécessité impé-
rieuse de renouer ses. anciennes communications di-
rectes avec l'Asie centrale. Ne pouvant traverser la
Russie, le commerce s'ouvrit une autre voie : il prit la
direction de Trébizonde, ville munie d'un port commode,
et située à courte distance des frontières perses.
D Les progrès du trafic, par Trébizonde, furent in-
croyablement rapides. En 1832, les exportations étaient
de sept millions et demi de francs; en 1836, elles s'é-
levaient à quarante millions. — En 1834, les importa-
tions- n'excédaient pas onze millions; en 1836, elles dé-
passaient quarante-trois millions.
» De semblables faits ressort, avec la plus évidente
clarté, l'irrésistible besoin qu'a l'industrie européenne
de s'ouvrir une route directe pour arriver aux grands
marchés de l'Asie.
» Pendant que les produits industriels de l'Europe
allaient cherchant leur voie pour pénétrer dans l'inté-
rieur de ce monde si difficilement accessible, la politi-
que commerciale de l'Angleterre avait subi des modi-
fications essentielles.
» Le privilége anciennement concédé à la Compa-
gnie des Indes orientales, marchait graduellement à
une abolition complète. La péninsule indostane, consi-
dérée en principe comme une partie intégrante des
domaines britanniques, le commerce avec l'empire
anglo-indien fut ouvert à toutes les nations. Cette con-
cession servit de prélude à des innovations plus impor-
tantes encore. Si l'Angleterre avait cru ce moment venu
pour ses intérêts — les seuls qu'elle consulte jamais
— d'abaisser la barrière du monopole qu'elle exerçait
sur les marchés indiens, d'un autre côté, elle posait en
maxime, que la célérité des communications était l'âme
de l'industrie; par suite de cette maxime, aux bâti-
ments àvoile succédaient les bâtiments à vapeur, et le
sol se couvrait de chemins de fer.
» La tendance de l'Europe à arriver aux grands mar-
chés de l'Asie par les voies les plus directes et les plus
économiques, ne pouvait manquer d'éveiller la suscep-
tibilité sagace du gouvernement britannique. L'Angle-
terre se posa résolûment à la tête du mouvement
qu'elle ne pouvait comprimer, et qui, d'ailleurs, coïnci-
dait avec ses vues et ses propres intérêts. Elle marcha
la première à la recherche des communications qui
formaient le but commun des intérêts européens ; elle
en prêcha, elle en voulut l'établissement, mais elle <
voulut en même temps s'en assurer le domaine et les
subordonner à sa suprématie. Ces visées n'étaient évi_
demment possibles, qu'autant que ces communications
déboucheraient dans la Méditerranée. Elle eut bientôt
reconnu les inconvénients du passage impovisé par
Trébizonde, conduisant en Perse. La difficulté de péné-
trer dans la mer Noire, les traités qui en fermaient l'en-
trée aux bâtiments de guerre, ne pouvaient lui laisser
de doute sur le peu de sécurité de cette ligne en cas
d'événements politiques. Il était évident que le com-
merce avec la Perse et les autres contrées de l'Asie
devait avoir, pour point de départ, un port de la Mé-
diterranée que l'on pût, en toute occurrence, surveiller
et défendre.
» Le gouvernement britannique jeta donc ses regards
sur le bras de mer qui sépare l'Asie de l'Afrique. Il eut
bientôt apprécié les avantages que lui présentait le
golfe Arabique, et n'aspira plus qu'à en dominer l'en-
trée, comme, à une autre époque, il s'était assuré celle
de la Méditerranée par la possession de Gibraltar. —
Ce but posé, aucun point ne répondait mieux à ses
vues que la ville forte d'Aden, que l'on peut considérer
comme la clef du détroit de Bab-el-Mandeb. Les Anglais,
qui achètent tout, en firent l'acquisition et en devin-
rent les maîtres en 1839. — Il suffit de jeter les yeux
sur une carte géographique pour se convaincre, au
premier coup d'œil, de l'importance d'un semblable
établissement, soit comme position militaire, soit
comme station maritime et commerciale.
» Aden, qui entretenait des rapports étendus avec
Ormus ou Harmouz, clef du golfe Persique et de la côte
septentrionale de la Péninsule en deçà du Gange, Aden,
disons-nous, concentrait déjà au moyen âge un mou-
vement commercial considérable. Ebn-el-Ouardi, qui
écrivait au commencement du XIVe siècle, rapporte que
l'on y voyait arriver en grand nombre les navires de
la Chine, de Malacca et des Indes, chargés des pro-
duits de leurs contrées respectives. La population, ex-
clusivement composée d'Arabes et d'Indiens, vivait de
trafic, et tirait un grand parti de la préparation de
YÂmphiam, très-recherché en Orient et connu sous le
nom d'Opium thébaïque. La haine aveugle et invétérée des
musulmans en avait éloigné les chrétiens. Mais l'inté-
rêt finit par l'emporter sur le péril, et dans les pre-
mières années du xiv" siècle, on trouve Aden peuplé
de marchands italiens qui s'y étaient établis et y te-
naient magasins. Les marchandises qui y arrivaient
des Indes étaient transportées à la Mecque par le
moyen des caravanes. Plus tard, on préféra une autre
voie. Les navires franchissaient le détroit de Bat-el-
Mandeb, abordaient à Djeddah, ville peu distante de la
Mecque, et qui devint ainsi l'échelle de cette dernière.
» En 1326, le soudan d'Egypte imagina de concentrer
accrédité un consul. Il n'est pas sans intérêt de rappe-
ler que c'est grâce à ce transit que quelques cabanes
de pêcheurs s'étaient changées en une cité populeuse
et florissante. La statistique de l'Amérique septen-
trionale , si riche en phénomènes de ce genre, ne
présente aucun exemple que l'on puisse comparer
au rapide et prodigieux accroissement d'Odessa.
» Le gouvernement russe, en cette circonstance,
n'hésitait pas à sacrifier les intérêts particuliers d'O-
dessa aux intérêts généraux de l'Etat. Il ne voulut pas
que les étrangers pussent atteindre avec lui aux sour-
ces d'un trafic qui, de jour en jour, grandissait en ex-
tension et en importance. En défendant le transit par
ses Etats, la Russie eut pour but d'encourager ses ma-
nufactures indigènes, et de les mettre en état de suffire
seules aux échanges qui constituent le commerce avec
l'Asie.
» Cette prohibition inattendue frappa douloureuse-
ment les industries françaises, allemandes et anglaises.
Mais l'impulsion était donnée ; l'Europe productrice et
manufacturière éprouvait désormais la nécessité impé-
rieuse de renouer ses. anciennes communications di-
rectes avec l'Asie centrale. Ne pouvant traverser la
Russie, le commerce s'ouvrit une autre voie : il prit la
direction de Trébizonde, ville munie d'un port commode,
et située à courte distance des frontières perses.
D Les progrès du trafic, par Trébizonde, furent in-
croyablement rapides. En 1832, les exportations étaient
de sept millions et demi de francs; en 1836, elles s'é-
levaient à quarante millions. — En 1834, les importa-
tions- n'excédaient pas onze millions; en 1836, elles dé-
passaient quarante-trois millions.
» De semblables faits ressort, avec la plus évidente
clarté, l'irrésistible besoin qu'a l'industrie européenne
de s'ouvrir une route directe pour arriver aux grands
marchés de l'Asie.
» Pendant que les produits industriels de l'Europe
allaient cherchant leur voie pour pénétrer dans l'inté-
rieur de ce monde si difficilement accessible, la politi-
que commerciale de l'Angleterre avait subi des modi-
fications essentielles.
» Le privilége anciennement concédé à la Compa-
gnie des Indes orientales, marchait graduellement à
une abolition complète. La péninsule indostane, consi-
dérée en principe comme une partie intégrante des
domaines britanniques, le commerce avec l'empire
anglo-indien fut ouvert à toutes les nations. Cette con-
cession servit de prélude à des innovations plus impor-
tantes encore. Si l'Angleterre avait cru ce moment venu
pour ses intérêts — les seuls qu'elle consulte jamais
— d'abaisser la barrière du monopole qu'elle exerçait
sur les marchés indiens, d'un autre côté, elle posait en
maxime, que la célérité des communications était l'âme
de l'industrie; par suite de cette maxime, aux bâti-
ments àvoile succédaient les bâtiments à vapeur, et le
sol se couvrait de chemins de fer.
» La tendance de l'Europe à arriver aux grands mar-
chés de l'Asie par les voies les plus directes et les plus
économiques, ne pouvait manquer d'éveiller la suscep-
tibilité sagace du gouvernement britannique. L'Angle-
terre se posa résolûment à la tête du mouvement
qu'elle ne pouvait comprimer, et qui, d'ailleurs, coïnci-
dait avec ses vues et ses propres intérêts. Elle marcha
la première à la recherche des communications qui
formaient le but commun des intérêts européens ; elle
en prêcha, elle en voulut l'établissement, mais elle <
voulut en même temps s'en assurer le domaine et les
subordonner à sa suprématie. Ces visées n'étaient évi_
demment possibles, qu'autant que ces communications
déboucheraient dans la Méditerranée. Elle eut bientôt
reconnu les inconvénients du passage impovisé par
Trébizonde, conduisant en Perse. La difficulté de péné-
trer dans la mer Noire, les traités qui en fermaient l'en-
trée aux bâtiments de guerre, ne pouvaient lui laisser
de doute sur le peu de sécurité de cette ligne en cas
d'événements politiques. Il était évident que le com-
merce avec la Perse et les autres contrées de l'Asie
devait avoir, pour point de départ, un port de la Mé-
diterranée que l'on pût, en toute occurrence, surveiller
et défendre.
» Le gouvernement britannique jeta donc ses regards
sur le bras de mer qui sépare l'Asie de l'Afrique. Il eut
bientôt apprécié les avantages que lui présentait le
golfe Arabique, et n'aspira plus qu'à en dominer l'en-
trée, comme, à une autre époque, il s'était assuré celle
de la Méditerranée par la possession de Gibraltar. —
Ce but posé, aucun point ne répondait mieux à ses
vues que la ville forte d'Aden, que l'on peut considérer
comme la clef du détroit de Bab-el-Mandeb. Les Anglais,
qui achètent tout, en firent l'acquisition et en devin-
rent les maîtres en 1839. — Il suffit de jeter les yeux
sur une carte géographique pour se convaincre, au
premier coup d'œil, de l'importance d'un semblable
établissement, soit comme position militaire, soit
comme station maritime et commerciale.
» Aden, qui entretenait des rapports étendus avec
Ormus ou Harmouz, clef du golfe Persique et de la côte
septentrionale de la Péninsule en deçà du Gange, Aden,
disons-nous, concentrait déjà au moyen âge un mou-
vement commercial considérable. Ebn-el-Ouardi, qui
écrivait au commencement du XIVe siècle, rapporte que
l'on y voyait arriver en grand nombre les navires de
la Chine, de Malacca et des Indes, chargés des pro-
duits de leurs contrées respectives. La population, ex-
clusivement composée d'Arabes et d'Indiens, vivait de
trafic, et tirait un grand parti de la préparation de
YÂmphiam, très-recherché en Orient et connu sous le
nom d'Opium thébaïque. La haine aveugle et invétérée des
musulmans en avait éloigné les chrétiens. Mais l'inté-
rêt finit par l'emporter sur le péril, et dans les pre-
mières années du xiv" siècle, on trouve Aden peuplé
de marchands italiens qui s'y étaient établis et y te-
naient magasins. Les marchandises qui y arrivaient
des Indes étaient transportées à la Mecque par le
moyen des caravanes. Plus tard, on préféra une autre
voie. Les navires franchissaient le détroit de Bat-el-
Mandeb, abordaient à Djeddah, ville peu distante de la
Mecque, et qui devint ainsi l'échelle de cette dernière.
» En 1326, le soudan d'Egypte imagina de concentrer
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.94%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.94%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 13/16
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k62032395/f13.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k62032395/f13.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k62032395/f13.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k62032395
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k62032395
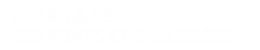


Facebook
Twitter