Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1858-09-25
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 25 septembre 1858 25 septembre 1858
Description : 1858/09/25 (A3,N55). 1858/09/25 (A3,N55).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203101c
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/05/2012
SAMEDI 25 SEPTEMBRE.. JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 479
8. Il faudrait un grand nombre d'écluses à sas aux deux
entrées du canal, dont la construction, quoique très-
possible, présenteràit pourtant de grandes difficultés et
exigerait des frais énormes.
9. Une des raisons qui ont fait rejeter le tracé Talabot, c'est
son pont-canal, et ce serait tomber à peu près dans un
vice analogue que de multiplier sans nécessité le nombre
des écluses.
10. Pour fournir l'eau du Nil dans toutes les saisons, il fau-
drait agrandir le profil du canal d'alimentation, et aug-
menter le nombre des écluses, attendu qu'on ne peut
détourner l'eau destinée aux irrigations,
Il. La navigation intérieure du pays par le canal du Nil au
lac Timsah, pourrait être entravée et quelquefois in-
terrompue totalement.
12. L'eau nécessaire pour le canal maritime ne pourrait être
fournie en tout temps qu'avec l'aide de puissantes ma-
chines.
13. Il y a, il est vrai, une économie dans les terrassements;
mais, en tenant compte de tous les autres travaux né-
cessaires, on trouvera qu'il n'y aurait pas en définitive
la moindre économie.
Sans entrer dans plus de détails, on peut affirmer que la
résolution par laquelle le canal à niveau bas, qui ne présente
aucune de ces difficultés, a été adopté de préférence au canal
à niveau élevé , était parfaitement motivée.
Mais on a dit que les expériences des ingénieurs du Vice-
roi, dans la construction des canaux locaux, rappelées dans le
rapport de la Commission, pouvaient convaincre de l'impos-
sibilité, soit de faire, soit de tenir ouvert un canal construit
au-dessous du niveau de la mer.
Le passage sur lequel on a fondé cette opinion se trouve
dans le § XV, pages 145-152 du rapport de la Commission.
Mais on a oublié totalement qu'il n'est là question que du canai
de jonction qui passe en partie dans les terrains d'alluvion, et
qu'il ne s'y agit aucunement du canal maritime qui passe par
le désert. Or, la différence de ces terrains est énorme.
Ce qui est dit dans le § XV du rapport s'applique unique-
ment aux canaux qui bordent le Nil, et qui passent par les
terrains d'alltivion , désavantages qui disparaissent en appro-
chant du désert. Dès qu'on arrive sur le sol de l'isthme, on
trouve ùn terrain ferme et invariable, ainsi que les forages et
les observations géologiques l'ont démontré à l'évidence, et ce
terrain se prêtera sans difficulté au creusement du canal.
Pour ce qui est du passage par le lac Menzaleh, il n'y
aura pas plus de difficultés que pour le passage dans les
lagunes de Venise et dans les marais ou les lacs-canaux de la
Hollande.
Dans notre pays, on ne trouverait d'autres difficultés pour
creuser et maintenir un canal à travers ce lac que celles qui
resUltëraieht dès frais d'ëxécutidn.
III.
Les opinions de M. R. Stéphenson peuvent être ainsi ré-
sumées : Avec une différence de 9.90 mëtrës entré les hiveaux
des deux mers, l'exécution du canal aurait été possible; en-
suite en admettant l'égalité des niveaux des deux mers, et que
la prise d'eau fût placée dans les parties supérieures du Nil,
ce serait une chose absurde; enfin, les deux mers étant de
niveau, et aucun courant ne pouvant être établi dans le
canal, on ne s'exprime pas bien en parlant d'un canal, parce
que, selon M. Sléphënson, ce prétendu canal ne serait qu'un
fossé.
Tout cela n'est pas très-clair et semble se contredire un
peu; et l'on s'étonne avec raison qu'un ingénieur ddnt on
doit estimer la haute renommée puisse soutenir des idées si
singulières. On a donc droit d'exiger les raisons qui ont fait
adopter une opinion si contraire à celle dé la Commission
internationale, approuvée par l'Académie des sciences de
l'Institut impérial de France, d'après les rapports si lucides
du baron Charles Dupin. Jusqu'ici on a vainement attendu
ces explications, et j'espère qu'on m'excusera de dire que,
pour moi, je n'oserais pas avancer dans mon pays des idées
aussi contraires à ce que nous voyons sous nos yeux.
En Hollande, il serait inutile de réfuter une telle assertion ;
car chez nous chacun se connaît assez bien en matière de
canaux, voies qui sillonnent notre pays dans toutes les direc-
tions, et dont une grande partie de la population se sert
journellement. Le public aurait bientôt fait justice d'une
assertion aussi bizarre. Quant à la différence qu'on veut faire
entre un canal et un fossé, je ne comprends pas le fin mot
de cette distinction. Il parait que M. Stéphenson n'admet sous
la dénomination de canaux que les voies d'eau où il existe
un courant constant, et que tous lés canaux où il n'y a pas
de courant ne sont à ses yeux que des fossés.
Il n'y a qu'un mot à répondre : c'est que si l'on adoptait
cette définition, il n'existerait pas en Hollande un seul canal;
quoique ce soient des voies d'eau parfaitement navigables, même
pour de grands navires, témoin le grand canal de la Nord-
Hollande d'Amsterdam au Nieuwe-Diep, celui de Vborne à
Hellevoetsluis, celui de Neuzen et tant d'autres encore, tous
nos canaux ne seraient que des fossés !
Mais la dénomination ne fait rien à la chose. On peut
hardiment assurer que ces fossés de la Hollande sont des
voies d'eau parfaitement navigables, et que dès qu'on aura
exécuté un fossé d'une largeur de 100 mètres et d'une pro-
fondeur de 8 mètres entre Suez et Tineh, on aura créé tout
aussi bien une voie navigable; et il importerait peu qu'elle ne
méritât point le nom de canal. Laissons donc cette distinction
pour ce qu'elle est. Voyons ce que nous entendons par la dé-
nomination de canaux.
Les canaux propres à la navigation, qu'ils aient pour but
de remplacer la navigation d'une rivière, ou d'établir une
jonction entre deux rivières ou deux mers, peuvent être di-
visés en deux espèces principales.
Les premiers sont ceux dont les niveaux montent ou des-
cendent constamment vers l'une ou l'autre extrémité.
Ce sont les cahaux ordinaires dans les pays plats comme
la Hollande, et comme dans ùne grande partie de l'Egypte.
Les seconds sont ceux qui ont un niveau plus élevé au
milieu , où l'on descend des deux côtés ; ce sont lës caftailx à
point de partage.
Là différence dès niveaux est rachetée dans les deux cas
par des écluses qui divisent le canal en différents biefs ; et s'il
h'y a pas de différence entre les niveaux des deux éxtrémités,
ou si la différence est si petite qu'il ne peut y avoir de Cou-
rant redoutable pour les berges, les écluses ne sont même
pas nécessaires, et le canal peut rester libre et ouvert.
Le câhàl de Suez èst certainement dans ce cas, et il n'est
pas besoin de répéter pourquoi la Commission internationale
s'est décidée pour le mode le plus simple, c'est-à-dire pour
un canal btivërt, sans écluses.
Pour ce qui regardé l'impraticabilité du canal, s'il êtâii
Vrai que les ingénieurs àbglais fussent d'accord, je les plain-
drais beaucoup ; car ce serait une cdhception bien au-dessous
de leur réputation justement âcqliisè de profonde perspicacité.
Mais je me garderais bien d'une pareille supposition énvers
8. Il faudrait un grand nombre d'écluses à sas aux deux
entrées du canal, dont la construction, quoique très-
possible, présenteràit pourtant de grandes difficultés et
exigerait des frais énormes.
9. Une des raisons qui ont fait rejeter le tracé Talabot, c'est
son pont-canal, et ce serait tomber à peu près dans un
vice analogue que de multiplier sans nécessité le nombre
des écluses.
10. Pour fournir l'eau du Nil dans toutes les saisons, il fau-
drait agrandir le profil du canal d'alimentation, et aug-
menter le nombre des écluses, attendu qu'on ne peut
détourner l'eau destinée aux irrigations,
Il. La navigation intérieure du pays par le canal du Nil au
lac Timsah, pourrait être entravée et quelquefois in-
terrompue totalement.
12. L'eau nécessaire pour le canal maritime ne pourrait être
fournie en tout temps qu'avec l'aide de puissantes ma-
chines.
13. Il y a, il est vrai, une économie dans les terrassements;
mais, en tenant compte de tous les autres travaux né-
cessaires, on trouvera qu'il n'y aurait pas en définitive
la moindre économie.
Sans entrer dans plus de détails, on peut affirmer que la
résolution par laquelle le canal à niveau bas, qui ne présente
aucune de ces difficultés, a été adopté de préférence au canal
à niveau élevé , était parfaitement motivée.
Mais on a dit que les expériences des ingénieurs du Vice-
roi, dans la construction des canaux locaux, rappelées dans le
rapport de la Commission, pouvaient convaincre de l'impos-
sibilité, soit de faire, soit de tenir ouvert un canal construit
au-dessous du niveau de la mer.
Le passage sur lequel on a fondé cette opinion se trouve
dans le § XV, pages 145-152 du rapport de la Commission.
Mais on a oublié totalement qu'il n'est là question que du canai
de jonction qui passe en partie dans les terrains d'alluvion, et
qu'il ne s'y agit aucunement du canal maritime qui passe par
le désert. Or, la différence de ces terrains est énorme.
Ce qui est dit dans le § XV du rapport s'applique unique-
ment aux canaux qui bordent le Nil, et qui passent par les
terrains d'alltivion , désavantages qui disparaissent en appro-
chant du désert. Dès qu'on arrive sur le sol de l'isthme, on
trouve ùn terrain ferme et invariable, ainsi que les forages et
les observations géologiques l'ont démontré à l'évidence, et ce
terrain se prêtera sans difficulté au creusement du canal.
Pour ce qui est du passage par le lac Menzaleh, il n'y
aura pas plus de difficultés que pour le passage dans les
lagunes de Venise et dans les marais ou les lacs-canaux de la
Hollande.
Dans notre pays, on ne trouverait d'autres difficultés pour
creuser et maintenir un canal à travers ce lac que celles qui
resUltëraieht dès frais d'ëxécutidn.
III.
Les opinions de M. R. Stéphenson peuvent être ainsi ré-
sumées : Avec une différence de 9.90 mëtrës entré les hiveaux
des deux mers, l'exécution du canal aurait été possible; en-
suite en admettant l'égalité des niveaux des deux mers, et que
la prise d'eau fût placée dans les parties supérieures du Nil,
ce serait une chose absurde; enfin, les deux mers étant de
niveau, et aucun courant ne pouvant être établi dans le
canal, on ne s'exprime pas bien en parlant d'un canal, parce
que, selon M. Sléphënson, ce prétendu canal ne serait qu'un
fossé.
Tout cela n'est pas très-clair et semble se contredire un
peu; et l'on s'étonne avec raison qu'un ingénieur ddnt on
doit estimer la haute renommée puisse soutenir des idées si
singulières. On a donc droit d'exiger les raisons qui ont fait
adopter une opinion si contraire à celle dé la Commission
internationale, approuvée par l'Académie des sciences de
l'Institut impérial de France, d'après les rapports si lucides
du baron Charles Dupin. Jusqu'ici on a vainement attendu
ces explications, et j'espère qu'on m'excusera de dire que,
pour moi, je n'oserais pas avancer dans mon pays des idées
aussi contraires à ce que nous voyons sous nos yeux.
En Hollande, il serait inutile de réfuter une telle assertion ;
car chez nous chacun se connaît assez bien en matière de
canaux, voies qui sillonnent notre pays dans toutes les direc-
tions, et dont une grande partie de la population se sert
journellement. Le public aurait bientôt fait justice d'une
assertion aussi bizarre. Quant à la différence qu'on veut faire
entre un canal et un fossé, je ne comprends pas le fin mot
de cette distinction. Il parait que M. Stéphenson n'admet sous
la dénomination de canaux que les voies d'eau où il existe
un courant constant, et que tous lés canaux où il n'y a pas
de courant ne sont à ses yeux que des fossés.
Il n'y a qu'un mot à répondre : c'est que si l'on adoptait
cette définition, il n'existerait pas en Hollande un seul canal;
quoique ce soient des voies d'eau parfaitement navigables, même
pour de grands navires, témoin le grand canal de la Nord-
Hollande d'Amsterdam au Nieuwe-Diep, celui de Vborne à
Hellevoetsluis, celui de Neuzen et tant d'autres encore, tous
nos canaux ne seraient que des fossés !
Mais la dénomination ne fait rien à la chose. On peut
hardiment assurer que ces fossés de la Hollande sont des
voies d'eau parfaitement navigables, et que dès qu'on aura
exécuté un fossé d'une largeur de 100 mètres et d'une pro-
fondeur de 8 mètres entre Suez et Tineh, on aura créé tout
aussi bien une voie navigable; et il importerait peu qu'elle ne
méritât point le nom de canal. Laissons donc cette distinction
pour ce qu'elle est. Voyons ce que nous entendons par la dé-
nomination de canaux.
Les canaux propres à la navigation, qu'ils aient pour but
de remplacer la navigation d'une rivière, ou d'établir une
jonction entre deux rivières ou deux mers, peuvent être di-
visés en deux espèces principales.
Les premiers sont ceux dont les niveaux montent ou des-
cendent constamment vers l'une ou l'autre extrémité.
Ce sont les cahaux ordinaires dans les pays plats comme
la Hollande, et comme dans ùne grande partie de l'Egypte.
Les seconds sont ceux qui ont un niveau plus élevé au
milieu , où l'on descend des deux côtés ; ce sont lës caftailx à
point de partage.
Là différence dès niveaux est rachetée dans les deux cas
par des écluses qui divisent le canal en différents biefs ; et s'il
h'y a pas de différence entre les niveaux des deux éxtrémités,
ou si la différence est si petite qu'il ne peut y avoir de Cou-
rant redoutable pour les berges, les écluses ne sont même
pas nécessaires, et le canal peut rester libre et ouvert.
Le câhàl de Suez èst certainement dans ce cas, et il n'est
pas besoin de répéter pourquoi la Commission internationale
s'est décidée pour le mode le plus simple, c'est-à-dire pour
un canal btivërt, sans écluses.
Pour ce qui regardé l'impraticabilité du canal, s'il êtâii
Vrai que les ingénieurs àbglais fussent d'accord, je les plain-
drais beaucoup ; car ce serait une cdhception bien au-dessous
de leur réputation justement âcqliisè de profonde perspicacité.
Mais je me garderais bien d'une pareille supposition énvers
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.9%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.9%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
-
-
Page
chiffre de pagination vue 7/24
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6203101c/f7.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6203101c/f7.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6203101c/f7.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6203101c
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6203101c
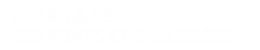


Facebook
Twitter