Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1858-03-10
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 10 mars 1858 10 mars 1858
Description : 1858/03/10 (A3,N42). 1858/03/10 (A3,N42).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203088z
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/10/2012
J AIERCREDI 10 MARS. JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS. 125 *
EMPIRE DES INDES.
La surface de l'Empire anglo-indien s'étend du 7e degré au
31e degré de latitude nord, et du 65e au 90° degré de longitude
orientale. Les frontières se développent sur une ligne égale à
la moitié de la circonférence du globe, et elles renferment
une superficie de 3,160,000 kilomètres carrés , ou de plus de
1,800,000 milles anglais. Sa population, d'après un docu-
ment récent que la Chambre des Communes d'Angleterre
a publié en 1856,. était de 180,450,010 habitants: c'est-à-
dire 64,108,372 dans la présidence du Bengale; 33,437,193
dans la province d'Agra et Punjab; 22,437,297 dans la pré-
sidence, de Madras; 11,990,901 dans celle de Bombay 9 et
48,476,247 en Etats indigènes, tributaires ou vassaux.
Les conquêtes des musulmans dans les Indes durèrent près
de six siècles, de 1004 à 1565, c'est-à-dire des Gaznévides à
la fondation de l'Empire mongol. Vinrent ensuite celles des
Européens. Les Portugais furent les premiers à y pénétrer et
à s'ytétablir. Les autres peuples européens, jaloux de la ri-
chesse et de la puissance des Portugais, ne tardèrent pas à
courir sur leurs pas, et les Hollandais, les Anglais, les Fran-
çais, les Danois, en chassèrent presque entièrement les pre-
miers conquérants européens. Les Portugais, tombés dans
leur propre pays sous la domination espagnole, n'avaient à
cœur que de reconquérir leur vieille indépendance, et ils
durent abandonner leurs colonies lointaines. Les Hollandais
en profitèrent pour s'étendre sur la côte orientale de l'Hin-
doustan; et en 1655 ils conquirent Calicut, en 1660 Naga-
patam, et en 1661 Cochin et Tananore. Les Français, qui,
dès le temps de François Ier, avaient tâché, mais en vain,
de s'établir dans les Indes, repoussés par les tempêtes en
doublant le Cap, sous Henri IV fondèrent (1604) une com-
pagnie appelée Compagnie des Indes orientales, qui n'eut pas
de succès. Mais, en 1664, une autre compagnie, plus heu-
reuse, s'étendit de telle sorte que les Hollandais en furent
jaloux. Ce n'est cependant que beaucoup plus tard, vers 1750,
sous le gouvernement du célèbre Dupleix, que la compagnie
française atteignit le plus haut degré de splendeur et de
force, pour déchoir bientôt.
Voyant la possibilité de conquérir les Indes, au milieu des
ruines de l'Empire mongol, Dupleix mit au service des princes
indiens plusieurs corps d'Européens, et de cette manière il
domina sur le Carnatic, et peu après sur le Deccan, c'est-à-dire
sur 35,000,000 d'habitants, moitié des États du Grand Mongol.
Grâce au génie de Dupleix, et malgré de grands revers,
en 1758, les établissements de Mahé, de Ganaor, de Chan-
dernagor, appartenaient à la Compagnie française, qui pos-
sédait sur les côles de Coromandel et d'Orissa Pondichéry,
Karikal, Masulipatam, avec d'immenses étendues de territoire.
Tous ces établissements lui donnaient une rente annuelle de
plus de 18 millions de francs.
Mais, en 1758, éclataTune nouvelle guerre entre la France
et 1 Angleterre, et, dans l'espace de moins de deux ans, toutes
ces possessions tombèrent entre les mains des Anglais. Parla
paix de 1763, l' Angleterre rendit à la France Pondichéry, et,
en 1765, les Français reprirent Mahe, Karikal, Chandernagor
et quelques petits établissements dansMe Bengale. La domina-
tion française était ruinée. La colonie de Pondichéry, pen-
dant les guerres de la Révolution et de l'Empire, tomba trois
fois au pouvoir des Anglais; mais, avec les traités de Paris
de 1814 et de 1815, la France recouvra ses établissements,
réduits désormais à très-peu de chose.
Les Danois tentèrent aussi des établissements dans les
Indes, en achetant ; Tranquebar du radja de Tanjore, qu'ils
ont cédé récemment à la Compagnie des Indes orientales.
Nous ne voulons pas raconter comment les Anglais ont at-
teint tant de grandeur dans les Indes; nous dirons seulement
que les nations européennes qui découvrirent ces régions
orientales et y.plantèrent les premières leur étendard, c'est-
à-dire le Portugal, la Hollande et la France, se sont retirées
peu à peu devant l'anglica fortuna, et aujourd'hui l'Angle-
terre en a exclusivement l'empire. Pour donner une idée de ses
conquêtes", nous rappellerons que, en 1612, la compagnie for-
mée sous Elisabeth s'empara de Surate et fonda des établisse-
ments commerciaux dans cette ville, à Cambaia, à Ahmed-
abad ; qu'en 1622 elle s'empara de Bender-Abassi, au fond
du golfe d'Ormuz; qu'en 1639 elle conquit Madras; qu'en 1640
elle commença à faire quelques expéditions dans le Bengale;
en 1668, elle prit possession de Bombay; en 1690, elle agran-
dit ses établissements dans les contrées où fut depuis fondée
Calcutta; en 1749, elle s'empara de Tanjore; de 1750 àl757,
elle conquit plusieurs districts immenses du Bengale ; en 1760,
une portion de l'Orissa; en 1761, tout le pays de Dehli ;
en 1765, le Behar ; en 1775, le district de Bénarès; en 1780,
une partie du Guzarate; en 1781, elle acheta les établisse-
ments hollandais de Paliacate, Bublipatnam, Negapatnam et
de l'île de Ceylan; en 1783, elle s'empara des districts de
Bidnapore, Caunpore, Mangalore, etc., dans le Malabar;
de 1784 à 1799, du Mysore; en 1801 , du Carnatic, de la
province d'Allahabad et de la partie méridionale du Doab ;
en 1803, de Dehli, de la province d' Agra, tu reste du Mala-
bar et de la partie septentrionale du Doab; en 1814, du
Népal; en 1817 et 1818, de la ville d'Agemir, d'une. partie
du Malwah; en 1818, du territoire des Mahrattes; en 1824,
de celui deMalacca; en 1826, de diverses provinces dans
l'Empire birman ; en 1834, de Goorg; en 1839, du Scind;
en 1840, deTavoy, Tenasserim, Malacca,. Bardivan et Sa-
tarah; en 1846, des provinces du Cachemir et d'Hayara ;
en 1849, du Pendjab et de Pechawer; en 1850, des posses-
sions danoises de Tranquebaret de Sérampore; enfin,. en 1855,
des États du Roi d'Oude.
Pour ce qui concerne l'histoire politique et financière
de cette grande compagnie, on sait que la reine Élisabeth
octroya, le 31 décembre 1600, une charte qui fonda la Com-
pagnie des négociants de Londres pour le commerce des Indes
orientales, et lui donna Thomas Smith pour gouverneur, avec
un conseil de vingt-quatre directeurs; que Charles II la con-
firma en 1661, et lui concéda en outre le droit de paix et de
guerre avec tous les États non chrétiens; elle put ériger des
forteresses et fonder des colonies; mais cette nouvelle conces-
sion n'eut pas l'assentiment du Parlement, et la compagnie
ne put pas jouir d'un commerce exclusif dans les Indes. Bientôt
se forma une autre compagnie rivale; les deux sociétés se.
disputèrent le commerce de ces contrées; mais, en 1702,.
elles se réunirent en une seule compagnie, qui s'appela la
Compagnie unie des négociants d'Angleterre dans les Indes
orientales.
Cependant la Compagnie, ruinée par suite des guerres avec
là France et avec Hyder-Ali, loin de pouvoir payer à l'État la
rétribution annuelle de 400,00.0 livres qu'elle lui devait, fut
contrainte d'emprunter du trésor une somme considérable, et
peu après de recourir à de nouveaux emprunts. C'est alors que
le Parlement vint à son aide : il renonça en partie à la rétri-
bution annuelle; mais en même temps il changea l'ordre in-
térieur de la Compagnie, en établissant un gouverneur général
résidant au Bengale, et qui dut changer tous les cinq ans,,
avec un conseil de cinq membres élus par la Compagnie el
EMPIRE DES INDES.
La surface de l'Empire anglo-indien s'étend du 7e degré au
31e degré de latitude nord, et du 65e au 90° degré de longitude
orientale. Les frontières se développent sur une ligne égale à
la moitié de la circonférence du globe, et elles renferment
une superficie de 3,160,000 kilomètres carrés , ou de plus de
1,800,000 milles anglais. Sa population, d'après un docu-
ment récent que la Chambre des Communes d'Angleterre
a publié en 1856,. était de 180,450,010 habitants: c'est-à-
dire 64,108,372 dans la présidence du Bengale; 33,437,193
dans la province d'Agra et Punjab; 22,437,297 dans la pré-
sidence, de Madras; 11,990,901 dans celle de Bombay 9 et
48,476,247 en Etats indigènes, tributaires ou vassaux.
Les conquêtes des musulmans dans les Indes durèrent près
de six siècles, de 1004 à 1565, c'est-à-dire des Gaznévides à
la fondation de l'Empire mongol. Vinrent ensuite celles des
Européens. Les Portugais furent les premiers à y pénétrer et
à s'ytétablir. Les autres peuples européens, jaloux de la ri-
chesse et de la puissance des Portugais, ne tardèrent pas à
courir sur leurs pas, et les Hollandais, les Anglais, les Fran-
çais, les Danois, en chassèrent presque entièrement les pre-
miers conquérants européens. Les Portugais, tombés dans
leur propre pays sous la domination espagnole, n'avaient à
cœur que de reconquérir leur vieille indépendance, et ils
durent abandonner leurs colonies lointaines. Les Hollandais
en profitèrent pour s'étendre sur la côte orientale de l'Hin-
doustan; et en 1655 ils conquirent Calicut, en 1660 Naga-
patam, et en 1661 Cochin et Tananore. Les Français, qui,
dès le temps de François Ier, avaient tâché, mais en vain,
de s'établir dans les Indes, repoussés par les tempêtes en
doublant le Cap, sous Henri IV fondèrent (1604) une com-
pagnie appelée Compagnie des Indes orientales, qui n'eut pas
de succès. Mais, en 1664, une autre compagnie, plus heu-
reuse, s'étendit de telle sorte que les Hollandais en furent
jaloux. Ce n'est cependant que beaucoup plus tard, vers 1750,
sous le gouvernement du célèbre Dupleix, que la compagnie
française atteignit le plus haut degré de splendeur et de
force, pour déchoir bientôt.
Voyant la possibilité de conquérir les Indes, au milieu des
ruines de l'Empire mongol, Dupleix mit au service des princes
indiens plusieurs corps d'Européens, et de cette manière il
domina sur le Carnatic, et peu après sur le Deccan, c'est-à-dire
sur 35,000,000 d'habitants, moitié des États du Grand Mongol.
Grâce au génie de Dupleix, et malgré de grands revers,
en 1758, les établissements de Mahé, de Ganaor, de Chan-
dernagor, appartenaient à la Compagnie française, qui pos-
sédait sur les côles de Coromandel et d'Orissa Pondichéry,
Karikal, Masulipatam, avec d'immenses étendues de territoire.
Tous ces établissements lui donnaient une rente annuelle de
plus de 18 millions de francs.
Mais, en 1758, éclataTune nouvelle guerre entre la France
et 1 Angleterre, et, dans l'espace de moins de deux ans, toutes
ces possessions tombèrent entre les mains des Anglais. Parla
paix de 1763, l' Angleterre rendit à la France Pondichéry, et,
en 1765, les Français reprirent Mahe, Karikal, Chandernagor
et quelques petits établissements dansMe Bengale. La domina-
tion française était ruinée. La colonie de Pondichéry, pen-
dant les guerres de la Révolution et de l'Empire, tomba trois
fois au pouvoir des Anglais; mais, avec les traités de Paris
de 1814 et de 1815, la France recouvra ses établissements,
réduits désormais à très-peu de chose.
Les Danois tentèrent aussi des établissements dans les
Indes, en achetant ; Tranquebar du radja de Tanjore, qu'ils
ont cédé récemment à la Compagnie des Indes orientales.
Nous ne voulons pas raconter comment les Anglais ont at-
teint tant de grandeur dans les Indes; nous dirons seulement
que les nations européennes qui découvrirent ces régions
orientales et y.plantèrent les premières leur étendard, c'est-
à-dire le Portugal, la Hollande et la France, se sont retirées
peu à peu devant l'anglica fortuna, et aujourd'hui l'Angle-
terre en a exclusivement l'empire. Pour donner une idée de ses
conquêtes", nous rappellerons que, en 1612, la compagnie for-
mée sous Elisabeth s'empara de Surate et fonda des établisse-
ments commerciaux dans cette ville, à Cambaia, à Ahmed-
abad ; qu'en 1622 elle s'empara de Bender-Abassi, au fond
du golfe d'Ormuz; qu'en 1639 elle conquit Madras; qu'en 1640
elle commença à faire quelques expéditions dans le Bengale;
en 1668, elle prit possession de Bombay; en 1690, elle agran-
dit ses établissements dans les contrées où fut depuis fondée
Calcutta; en 1749, elle s'empara de Tanjore; de 1750 àl757,
elle conquit plusieurs districts immenses du Bengale ; en 1760,
une portion de l'Orissa; en 1761, tout le pays de Dehli ;
en 1765, le Behar ; en 1775, le district de Bénarès; en 1780,
une partie du Guzarate; en 1781, elle acheta les établisse-
ments hollandais de Paliacate, Bublipatnam, Negapatnam et
de l'île de Ceylan; en 1783, elle s'empara des districts de
Bidnapore, Caunpore, Mangalore, etc., dans le Malabar;
de 1784 à 1799, du Mysore; en 1801 , du Carnatic, de la
province d'Allahabad et de la partie méridionale du Doab ;
en 1803, de Dehli, de la province d' Agra, tu reste du Mala-
bar et de la partie septentrionale du Doab; en 1814, du
Népal; en 1817 et 1818, de la ville d'Agemir, d'une. partie
du Malwah; en 1818, du territoire des Mahrattes; en 1824,
de celui deMalacca; en 1826, de diverses provinces dans
l'Empire birman ; en 1834, de Goorg; en 1839, du Scind;
en 1840, deTavoy, Tenasserim, Malacca,. Bardivan et Sa-
tarah; en 1846, des provinces du Cachemir et d'Hayara ;
en 1849, du Pendjab et de Pechawer; en 1850, des posses-
sions danoises de Tranquebaret de Sérampore; enfin,. en 1855,
des États du Roi d'Oude.
Pour ce qui concerne l'histoire politique et financière
de cette grande compagnie, on sait que la reine Élisabeth
octroya, le 31 décembre 1600, une charte qui fonda la Com-
pagnie des négociants de Londres pour le commerce des Indes
orientales, et lui donna Thomas Smith pour gouverneur, avec
un conseil de vingt-quatre directeurs; que Charles II la con-
firma en 1661, et lui concéda en outre le droit de paix et de
guerre avec tous les États non chrétiens; elle put ériger des
forteresses et fonder des colonies; mais cette nouvelle conces-
sion n'eut pas l'assentiment du Parlement, et la compagnie
ne put pas jouir d'un commerce exclusif dans les Indes. Bientôt
se forma une autre compagnie rivale; les deux sociétés se.
disputèrent le commerce de ces contrées; mais, en 1702,.
elles se réunirent en une seule compagnie, qui s'appela la
Compagnie unie des négociants d'Angleterre dans les Indes
orientales.
Cependant la Compagnie, ruinée par suite des guerres avec
là France et avec Hyder-Ali, loin de pouvoir payer à l'État la
rétribution annuelle de 400,00.0 livres qu'elle lui devait, fut
contrainte d'emprunter du trésor une somme considérable, et
peu après de recourir à de nouveaux emprunts. C'est alors que
le Parlement vint à son aide : il renonça en partie à la rétri-
bution annuelle; mais en même temps il changea l'ordre in-
térieur de la Compagnie, en établissant un gouverneur général
résidant au Bengale, et qui dut changer tous les cinq ans,,
avec un conseil de cinq membres élus par la Compagnie el
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 21/24
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6203088z/f21.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6203088z/f21.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6203088z/f21.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6203088z
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6203088z
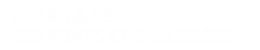


Facebook
Twitter