Titre : Nouvelles annales de la construction : publication rapide et économique des documents les plus récents et les plus intéressants relatifs à la construction française et étrangère... / C.-A. Oppermann
Titre : New annals of the construction
Titre : Neue Annalen der Baukunst
Éditeur : V. Dalmont (Paris)
Éditeur : V. DalmontV. Dalmont (Paris)
Éditeur : DunodDunod (Paris)
Éditeur : J. BaudryJ. Baudry (Paris)
Éditeur : C. BérangerC. Béranger (Paris)
Date d'édition : 1858-08-01
Contributeur : Oppermann, Charles Alfred (18..-18.. ; ingénieur des Ponts et chaussées). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32826369p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5529 Nombre total de vues : 5529
Description : 01 août 1858 01 août 1858
Description : 1858/08/01 (T4,N8)-1858/08/31. 1858/08/01 (T4,N8)-1858/08/31.
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k56657781
Source : Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, V-3528
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/11/2010
99
NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. - AOUT 1858.
100
tracé et de la solidité de la construction, et peut être compté digne-
ment au rang des grands passages montagneux exécutés depuis quel-
ques années avec tant de hardiesse en Bavière, en 'Wurtemberg, en
Autriche et en différents autres pays.
THÉODORE HOCHEISEN,
Ingénieur.
®e la disposition générale des bâtiments d'une ferme,
et Description de la grande ferme de Liscard (Angleterre).
PL. 56.
L'importance des bonnes dispositions d'ensemble et de détail des
bâtiments d'une exploitation agricole ne peut être mise en doute. La
ferme est une manufacture de blé, de viande, de lait, etc., et le cultiva-
teur, comme tout industriel, doit, pour réussir, chercher à produire au
plus bas prix : or de la main-d'oeuvre dépend en grande partie ce prix
de revient, soit directement, soit indirectement. Le cultivateur doit
donc chercher, par exemple, à diminuer le travail nécessaire pour ali-
menter et soigner le bétail, pour transporter et préparer les récoltes
et le fumier.
Bien qu'il ne convienne pas de dire en thèse générale que le bétail est.
un mal nécessaire, il est certain que l'objet principal des bâtiments de
ferme, c'est la fabrication du fumier ■? — fourrages, racines, grains et
paille, conservés et préparés dans une première série de bâtiments,
doivent être transportés des magasins dans les mangeoires ou sous le
pied des animaux; puis, transformées par les animaux, ces matières
doivent passer du plancher des écuries, vacheries, etc., sur le tas à
fumier ou dans la fosse à purin.
Eh bien, 1° ces transports de paille, racines, etc., du magasin à paille
et des silos jusqu'aux logements des animaux, doivent être lesplus di-
rects et les plus courts possibles. (Premier principe.)
2" Le transport du produit animal principal, le fumier, doit aussi
être le plus direct et le plus court possible. (Deuxième principe.)
Supposons donc que nous entrions dans le cercle continu des opéra-
tions de la ferme, à la fin de l'année agricole. ; — tous les produits des
champs sont rentrés et les animaux renfermés. Le but à remplir, c'est
alors la transformation des récoltes, ou produits bruts, en produits de
marché et en fumier.
La première série de bâtiments comprendra donc ceux affectés à
Vemmagasinage et à la préparation des récoltes : ce sont les granges,
les silos et les greniers à grains avec les bâtiments accessoires ; le ma-
gasin à paille, placé de façon ordinaire de transition entre la première
série et la seconde, qui comprend tous les logements d'animaux.
En troisième lieu, viennent les constructions ayant pour but le recueil
et la préparation du fumier, des liquides, des engrais commerciaux ou
des composts : rigoles et canaux, plates-formes à fumier, citernes,
hangars à compost, etc.
Une quatrième série de bâtiments est destinée aux instruments de la-
bour et de transport ; hangars pour instruments et pour chariots, ate-
liers de forge et de menuiserie, etc., etc.
Un certain^ nombre de bâtiments accessoires qu'il n'est pas besoin
d'indiquer peuvent être rangés dans chacune des catégories précé-
dentes.
Lorsque l'exploitation est d'une étendue restreinte, les bâtiments
sont assez facilement disposés autour d'une cour unique : sur la surface
nord, les granges, etc. ; sur deux autres, les logements d'animaux;
au centre de la cour, les plates-formes à fumier et les citernes; le
quatrième côté de la cour étant formé par la maison d'habitation et
ses dépendances.
Dans cette disposition si commune, les logements d'animaux ont
presque toujours des greniers à fourrages, et tous les bâtiments sont,
par suite, assez élevés et doivent être construits solidement pour sup-
porter l'énorme poids des greniers.
Lorsqu'il s'agit d'exploitations considérables, cette disposition est
moins convenable : la cour occupe un grand espace ; les transports
d'une série d'un bâtiment à l'autre sont parfois importants et non di-
rects ; en outre, on ne peut satisfaire à un troisième principe non moins
capital que ceux indiqués plus haut, possibilité d'augmenter l'étendue
des bâtiments. Au fur et à mesure de l'amélioration de la culture qui
donne plus de récoltes, plus de fumier, et exige de nouvelles disposi-
tions pour économiser la main-d'oeuvre et les chevaux par l'emploi de
machines diverses et de moteurs économiques, l'eau ou la vapeur, on
est forcé d'augmenter les bâtiments. Si ce troisième principe n'a pas été
pris en considération dès le début, on se voit amené à greffer intérieu-
rement ou extérieurement de nouvelles constructions sur les anciens
bâtiments, et cela ne peut jamais se faire qu'en désaccord avec les
deux premiers principes. C'est ainsi que beaucoup de fermes sont, au-
jourd'hui , composées d'un fouillis de bâtiments réunis sans ordre et
d'un aspect qui n'est rien moins qu'agréable.
Dans le modèle de grande ferme que nous donnons, planche 56, on
a eu égard aux trois principes que nous venons d'indiquer.
Au Nord, la cour des meules; au centre, du côté nord, la grange à
battre et les ateliers de préparation des grains, des racines, de la
paille, etc., soit pour le marché, soit pour la nourriture des animaux ;
toutes ces préparations se faisant par une machine à vapeur. A gauche
de la grange à battre se trouvent des silos surmontés de greniers; à
droite, des hangars à chariots.
Devant les silos est une petite cour que l'on pourrait appeler la cour
des racines; à droite de la grange, une cour de même grandeur; la
cour des travaux d'attelage et des instruments. Lé magasin à paille est
placé près de chambres propres à faire les mélanges de paille ou de
foin hachés, de racines lavées et coupées, etc ; et devant, au Sud, s'é-
tendent quatre corps de bâtiments parallèles servant au logement des
animaux.—Entre ces bâtiments sont des cours où se fait et se recueille
le fumier, où sont les citernes, etc.
., Au sud se trouvent des cottages ou logements d'ouvriers, et à droite,
la maison du régisseur. — On n'a pas cherché à faire entrer ce dernier
bâtiment dans le cercle des autres constructions, ce qui rend la surveil-
lance peut-être moins facile ; mais ceci est de peu d'importance dans
une exploitation bien dirigée, où chaque chose est à sa place, où chaque
homme a sa besogne et peut la faire le mieux possible, sans fatigue
corporelle abrutissante.
Ayant indiqué d'une manière sommaire la disposition générale des
bâtiments, nous donnons une légende des diverses parties. La fig. 2 est
le plan, et la fig. 1, une perspective de la ferme de M. Harold
LlTTLEDALE.
ED. VIANKE,
Directeur de la Cie Gle du Drainage économique,
11, rue des Beaux-Arts.
NOTICE
sur le régime de la (Saronne à Toulouse,
Par M. MAITROT DE VARENNES, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Dans les Questions à traiter du mois de Décembre 1856, nous avons
fait appel à l'obligeance de ceux de nos lecteurs qui pourraient avoir
quelques renseignements sur le débit des principaux cours d'eau, et sur
leur régime en des points déterminés.
Le travail suivant répond, pour la Garonne en particulier, à la ques-
tion dont il s'agit. Il serait bien désirable d'avoir pour le Rhin, pour le
Rhône, pour la Loire et pour la Seine des travaux analogues et des
résultats aussi complets et aussi scientifiquement établis (1).
Bassin hydrographique. — Régime général. — Jaugeages divers.
BASSIN HYDROGRAPHIQUE. — La Garonne prend sa source au point
culminant des Pyrénées, le pic de Nethou et la Maladetfa, et reçoit
successivement, avant de couler dans les murs de Toulouse, la Neste,
le Salât et l'Ariége, qui proviennent également des montagnes princi-
pales de la chaîne. Son bassin hydrographique, déterminé sur les car-
tes de Cassini, est de 10,240 kilomètres quarrés,ou 10,240 myriamètres
quarrés, ou 1,024,000 hectares, suivant qu'on prend pour unité de sur-
face le kilomètre quarré, le myriamètre quarré ou l'hectomètre quarré
(hectare); nous adopterons le kilomètre quarré, à l'exemple de M. BEL-
GRAND, dans ses remarquables études hydrologiques.
Les 10.240 kilomètres quarrés se divisent, ainsi qui suit, en plaines et
en montagnes. Les plaines renferment toutes les collines qui se trouvent
en dehors des chaînes principales et secondaires des Pyrénées :
RIVIÈRES. PLAINES. MONTAGNES. TOTABI.
k q. \.q. k.q.
Neste. . » 772 T,2
Garonne et Salât 2,436 2,604 5,040
Ariége. . . '. 2,525 1,903 4,428
totaux 4,961 5,279 10,240
HAUTEURS D'EAU DANS LA GARONNE A TOULOUSE.—Nous avons exa-
miné les hauteurs de la Garonne relevées à l'échelle de l'embouchure
(1) Voir la note 2, colonne 103, pour quelques chiffres sommaires.
NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. - AOUT 1858.
100
tracé et de la solidité de la construction, et peut être compté digne-
ment au rang des grands passages montagneux exécutés depuis quel-
ques années avec tant de hardiesse en Bavière, en 'Wurtemberg, en
Autriche et en différents autres pays.
THÉODORE HOCHEISEN,
Ingénieur.
®e la disposition générale des bâtiments d'une ferme,
et Description de la grande ferme de Liscard (Angleterre).
PL. 56.
L'importance des bonnes dispositions d'ensemble et de détail des
bâtiments d'une exploitation agricole ne peut être mise en doute. La
ferme est une manufacture de blé, de viande, de lait, etc., et le cultiva-
teur, comme tout industriel, doit, pour réussir, chercher à produire au
plus bas prix : or de la main-d'oeuvre dépend en grande partie ce prix
de revient, soit directement, soit indirectement. Le cultivateur doit
donc chercher, par exemple, à diminuer le travail nécessaire pour ali-
menter et soigner le bétail, pour transporter et préparer les récoltes
et le fumier.
Bien qu'il ne convienne pas de dire en thèse générale que le bétail est.
un mal nécessaire, il est certain que l'objet principal des bâtiments de
ferme, c'est la fabrication du fumier ■? — fourrages, racines, grains et
paille, conservés et préparés dans une première série de bâtiments,
doivent être transportés des magasins dans les mangeoires ou sous le
pied des animaux; puis, transformées par les animaux, ces matières
doivent passer du plancher des écuries, vacheries, etc., sur le tas à
fumier ou dans la fosse à purin.
Eh bien, 1° ces transports de paille, racines, etc., du magasin à paille
et des silos jusqu'aux logements des animaux, doivent être lesplus di-
rects et les plus courts possibles. (Premier principe.)
2" Le transport du produit animal principal, le fumier, doit aussi
être le plus direct et le plus court possible. (Deuxième principe.)
Supposons donc que nous entrions dans le cercle continu des opéra-
tions de la ferme, à la fin de l'année agricole. ; — tous les produits des
champs sont rentrés et les animaux renfermés. Le but à remplir, c'est
alors la transformation des récoltes, ou produits bruts, en produits de
marché et en fumier.
La première série de bâtiments comprendra donc ceux affectés à
Vemmagasinage et à la préparation des récoltes : ce sont les granges,
les silos et les greniers à grains avec les bâtiments accessoires ; le ma-
gasin à paille, placé de façon ordinaire de transition entre la première
série et la seconde, qui comprend tous les logements d'animaux.
En troisième lieu, viennent les constructions ayant pour but le recueil
et la préparation du fumier, des liquides, des engrais commerciaux ou
des composts : rigoles et canaux, plates-formes à fumier, citernes,
hangars à compost, etc.
Une quatrième série de bâtiments est destinée aux instruments de la-
bour et de transport ; hangars pour instruments et pour chariots, ate-
liers de forge et de menuiserie, etc., etc.
Un certain^ nombre de bâtiments accessoires qu'il n'est pas besoin
d'indiquer peuvent être rangés dans chacune des catégories précé-
dentes.
Lorsque l'exploitation est d'une étendue restreinte, les bâtiments
sont assez facilement disposés autour d'une cour unique : sur la surface
nord, les granges, etc. ; sur deux autres, les logements d'animaux;
au centre de la cour, les plates-formes à fumier et les citernes; le
quatrième côté de la cour étant formé par la maison d'habitation et
ses dépendances.
Dans cette disposition si commune, les logements d'animaux ont
presque toujours des greniers à fourrages, et tous les bâtiments sont,
par suite, assez élevés et doivent être construits solidement pour sup-
porter l'énorme poids des greniers.
Lorsqu'il s'agit d'exploitations considérables, cette disposition est
moins convenable : la cour occupe un grand espace ; les transports
d'une série d'un bâtiment à l'autre sont parfois importants et non di-
rects ; en outre, on ne peut satisfaire à un troisième principe non moins
capital que ceux indiqués plus haut, possibilité d'augmenter l'étendue
des bâtiments. Au fur et à mesure de l'amélioration de la culture qui
donne plus de récoltes, plus de fumier, et exige de nouvelles disposi-
tions pour économiser la main-d'oeuvre et les chevaux par l'emploi de
machines diverses et de moteurs économiques, l'eau ou la vapeur, on
est forcé d'augmenter les bâtiments. Si ce troisième principe n'a pas été
pris en considération dès le début, on se voit amené à greffer intérieu-
rement ou extérieurement de nouvelles constructions sur les anciens
bâtiments, et cela ne peut jamais se faire qu'en désaccord avec les
deux premiers principes. C'est ainsi que beaucoup de fermes sont, au-
jourd'hui , composées d'un fouillis de bâtiments réunis sans ordre et
d'un aspect qui n'est rien moins qu'agréable.
Dans le modèle de grande ferme que nous donnons, planche 56, on
a eu égard aux trois principes que nous venons d'indiquer.
Au Nord, la cour des meules; au centre, du côté nord, la grange à
battre et les ateliers de préparation des grains, des racines, de la
paille, etc., soit pour le marché, soit pour la nourriture des animaux ;
toutes ces préparations se faisant par une machine à vapeur. A gauche
de la grange à battre se trouvent des silos surmontés de greniers; à
droite, des hangars à chariots.
Devant les silos est une petite cour que l'on pourrait appeler la cour
des racines; à droite de la grange, une cour de même grandeur; la
cour des travaux d'attelage et des instruments. Lé magasin à paille est
placé près de chambres propres à faire les mélanges de paille ou de
foin hachés, de racines lavées et coupées, etc ; et devant, au Sud, s'é-
tendent quatre corps de bâtiments parallèles servant au logement des
animaux.—Entre ces bâtiments sont des cours où se fait et se recueille
le fumier, où sont les citernes, etc.
., Au sud se trouvent des cottages ou logements d'ouvriers, et à droite,
la maison du régisseur. — On n'a pas cherché à faire entrer ce dernier
bâtiment dans le cercle des autres constructions, ce qui rend la surveil-
lance peut-être moins facile ; mais ceci est de peu d'importance dans
une exploitation bien dirigée, où chaque chose est à sa place, où chaque
homme a sa besogne et peut la faire le mieux possible, sans fatigue
corporelle abrutissante.
Ayant indiqué d'une manière sommaire la disposition générale des
bâtiments, nous donnons une légende des diverses parties. La fig. 2 est
le plan, et la fig. 1, une perspective de la ferme de M. Harold
LlTTLEDALE.
ED. VIANKE,
Directeur de la Cie Gle du Drainage économique,
11, rue des Beaux-Arts.
NOTICE
sur le régime de la (Saronne à Toulouse,
Par M. MAITROT DE VARENNES, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Dans les Questions à traiter du mois de Décembre 1856, nous avons
fait appel à l'obligeance de ceux de nos lecteurs qui pourraient avoir
quelques renseignements sur le débit des principaux cours d'eau, et sur
leur régime en des points déterminés.
Le travail suivant répond, pour la Garonne en particulier, à la ques-
tion dont il s'agit. Il serait bien désirable d'avoir pour le Rhin, pour le
Rhône, pour la Loire et pour la Seine des travaux analogues et des
résultats aussi complets et aussi scientifiquement établis (1).
Bassin hydrographique. — Régime général. — Jaugeages divers.
BASSIN HYDROGRAPHIQUE. — La Garonne prend sa source au point
culminant des Pyrénées, le pic de Nethou et la Maladetfa, et reçoit
successivement, avant de couler dans les murs de Toulouse, la Neste,
le Salât et l'Ariége, qui proviennent également des montagnes princi-
pales de la chaîne. Son bassin hydrographique, déterminé sur les car-
tes de Cassini, est de 10,240 kilomètres quarrés,ou 10,240 myriamètres
quarrés, ou 1,024,000 hectares, suivant qu'on prend pour unité de sur-
face le kilomètre quarré, le myriamètre quarré ou l'hectomètre quarré
(hectare); nous adopterons le kilomètre quarré, à l'exemple de M. BEL-
GRAND, dans ses remarquables études hydrologiques.
Les 10.240 kilomètres quarrés se divisent, ainsi qui suit, en plaines et
en montagnes. Les plaines renferment toutes les collines qui se trouvent
en dehors des chaînes principales et secondaires des Pyrénées :
RIVIÈRES. PLAINES. MONTAGNES. TOTABI.
k q. \.q. k.q.
Neste. . » 772 T,2
Garonne et Salât 2,436 2,604 5,040
Ariége. . . '. 2,525 1,903 4,428
totaux 4,961 5,279 10,240
HAUTEURS D'EAU DANS LA GARONNE A TOULOUSE.—Nous avons exa-
miné les hauteurs de la Garonne relevées à l'échelle de l'embouchure
(1) Voir la note 2, colonne 103, pour quelques chiffres sommaires.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97.01%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97.01%.
- Collections numériques similaires Corpus : Art de l'ingénieur Corpus : Art de l'ingénieur /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp15"Cosmos (1852) /ark:/12148/bd6t51143731d.highres Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences, les arts et les manufactures, tant en France que dans les pays étrangers pendant l'année ... : avec l'indication succincte des principaux produits de l'industrie française ; la liste des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, accordés par le gouvernement pendant la même année, et des notices sur les prix proposés ou décernés par différentes sociétés savantes, françaises et étrangères, pour l'encouragement des sciences et des arts /ark:/12148/bd6t53887780b.highresThématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"
- Auteurs similaires Oppermann Charles Alfred Oppermann Charles Alfred /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Oppermann Charles Alfred" or dc.contributor adj "Oppermann Charles Alfred")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 6/8
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k56657781/f6.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k56657781/f6.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k56657781/f6.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k56657781
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k56657781
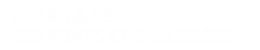


Facebook
Twitter