Titre : Nouvelles annales de la construction : publication rapide et économique des documents les plus récents et les plus intéressants relatifs à la construction française et étrangère... / C.-A. Oppermann
Titre : New annals of the construction
Titre : Neue Annalen der Baukunst
Éditeur : V. Dalmont (Paris)
Éditeur : V. DalmontV. Dalmont (Paris)
Éditeur : DunodDunod (Paris)
Éditeur : J. BaudryJ. Baudry (Paris)
Éditeur : C. BérangerC. Béranger (Paris)
Date d'édition : 1855-11-01
Contributeur : Oppermann, Charles Alfred (18..-18.. ; ingénieur des Ponts et chaussées). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32826369p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5529 Nombre total de vues : 5529
Description : 01 novembre 1855 01 novembre 1855
Description : 1855/11/01 (N11)-1855/11/30. 1855/11/01 (N11)-1855/11/30.
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k55770647
Source : Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, V-3528
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/11/2010
NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. — NOVEMBRE 18 55.
tention des constructeurs sur les fondations tubulaires et sur l'utilité de
leur emploi dans un grand nombre de circonstances,
Nous venons aujourd'hui ouvrir une autre série d'articles sur un sujet
qui présente, avec celui des fondations tubulaires, les plus grandes
analogies. Nous voulons parler des pieux à vis et des amarres hélicoï-
dales en fer et en fonte. Ces éléments s'emploient beaucoup, depuis
quelque temps, en Angleterre, en Amérique, et dans les colonies de ces
deux pays.
Il est étonnant, il faut le dire, il est regrettable pour la France,
qu'un système connu de l'autre côté de la Manche depuis près de vingt
ans déjà , recommandé et appliqué fréquemment par les hommes les
plus éminents de la construction anglaise (BRONEL, CUBITT, STEPHEN-
SON , etc ) ne soit encore représenté chez nous que par quelques expé-
riences inédites faites au port du Havre de 1841 à 1849.
On se demande comment il a pu se faire que ce procédé de fondation
et d'amarre, aussi simple qu'économique et expéditif dans tous les ter-
rains sableux, vaseux, argileux, etc., n'ait pas encore conquis assez
l'estime dés ingénieurs français pour devenir, dans notre pays, d'une
application journalière. Quoi qu'il en soit, voici les documents les plus
récents que nous ayons pu nous procurer sur cette question. Puisse leur
publication contribuer, pour si peu que ce soit, au progrès d'une mé-
thode qui mérite toutes les sympathies des praticiens lorsqu'elle est
appliquée dans des circonstances convenables de terrain et pression.
HISTORIQUE.
Le premier exemple de l'emploi des amarres ou corps morts à vis,
est celui des bouées du port de Belfast, lieu de naissance de l'inventeur.
Elles ont été établies en l'année 1833. De 1834 à 1838, quelques ten-
tatives furent inutilement faites pour obtenir l'autorisation d'appliquer
le système des pieux à vis dans diverses localités. En 1838 , sur l'invi-
tation de M. BEAUFORT, maintenant amiral, M. MITCHELL fit le projet
d'un phare à établir sur le Maplin Sand (planche 50. fig. i et 2), qui
fut approuvé par la Corporation de Trinity-House sur l'avis favorable
de M. WALKER, son ingénieur. La fondation de ce phare, le premier
travail pour lequel on se servit de pieux à vis, fut commencée en
août 1838; mais les travaux ayant été interrompus pendant deux an-
nées, pour éprouver les pieux, le phare ne fut terminé qu'en 1841. —
C'est le 6 juin 1840 que fut allumé pour la première fois un phare fondé
sur des pieux à vis. Ce phare est situé à Fleefwood, sur la Wyre, dans
la baie de Morecambe. Les travaux, commencés à la fin de 1839, fu-
rent conduits par M. MITCHELL et par son fils, auteurs des projets. La
lanterne a été terminée en mars 1840, sauf le couronnement.
Voici, depuis lors, la liste des principaux ouvrages pour lesquels on
a fait usage de pieux et d'amarres à vis, avec l'indication des époques :
Amarres ou- corps morts placés dans les ports ci-àprès : Belfast (1833); Greenock,
Glasco'W (vers 1835); Newcastle (1846), moyennant une redevance de 62,000 fr. payée
par la corporation pour l'usage de la partie du brevet relative aux corps morts. —
En 1855, plus de trente ports d'Angleterre et d'autres pays se trouvèrent pourvus de
ce système.
Balisage de bancs de sable : Kishbank, près la baie de Dublin (1843); Arklow Bank
et Blaekvvater-Bank, sur la côte orientale d'Irlande (1846); Tongue Sand. à l'embou-
chure de la Tamise (1846) ; etc.
Phares construits sur les points suivants : Fleetwood-on-Wyre (1840); Maplin Sand
(1841) ; Belfast Lough (1844); Dundalk, baie et port (1849); Brandywine Bank, dans
la Dela-ware (1850); Spit Bank, dans le port de Cork (1851) ; Sand Key, dans la Flo-
ride (Amérique du Nord), fondé sur un roc de corail, à l'entrée du port de Key West
(1852). — De 1852 à 1855 : trois phares dans la baie de Galveston (Amérique); phare
de Morecambe (mer d'Irlande) ; phare de Gunfleet, à 25 kilomètres au large d'Hanvich.
Travaux maritimes. — Jetée de Gourtown (Wexford, Irlande), en 1847. — Brke-
lames de Portland, composé de deux jetées longues de 1,800 mètres fune et de
450 mètres l'autre, laissant entre elles un passage de 120 mètres de largeur; la pre-
mière pierre a été posée, le 25 juillet 1849, nar le prince Albert. — De 1352 à 1855 ■
Jetée de 180 mètres, à Porto-Espaûa (Trinidad) ; jetée de Victor-Bay (isthme de Pana-
ma); nouvelle jetée de Margate, fondée dans la craie.— En préparation: travaux
d'Adélaïde (Australie); de Eingstown (Jamaïque); de l'île de Java.
Bâtiments, viaducs, etc. — Pont-aqueduc de Well Creek, pour le drainage du
Middle Level (1849). — Hangars à Lincoln (Great Northern Raifway), etc., etc. — Té-
légraphe électrique sur poteaux, de Calcutta à Madras, à Bombay, etc. (40 000 po-
teaux à vis). .
DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI.
Les pieux et les amarres, à vis ou à hélice [screw piles, screw moor-
ings), sont deux applications distinctes de la vis réduite à quelques
spires dont la révolution supérieure, siège principal de la résistance,
est épandue en un disque aplati pouvant atteindre lm.20 de diamètre et
au delà. Il est facile, par un mouvement rotatoire, d'écarter les ob-
stacles à la descente, et de faire pénétrer cette f« à terrain dans la
plupart des sols à des profondeurs plus ou moins grandes, sans dislo-
cation des couches traversées. La vis, ainsi enfoncée, devient à la fois
une amarre résistant à la traction lorsque l'extrémité d'une chaîne d'a-
marrage est fixée à sa partie supérieure ; et une base résistant à la
compression, si l'on a boulonné sur sa tête une lige creuse ou pleine,
en bois ou en métal, qui vient affleurer le sol, et sur laquelle reposent
des constructions. — Les vis sont cylindriques ou coniques, générale-
ment en fonte, et très-exceptionnellement en fer forgé. Les tiges pleines
sont en bois, en fer ou en fonte. Les tiges creuses sont en tôle ou en
fonte. Il est des tiges où le fer est uni à la fonte.
Les vis cylindriques servent dans les terrains peu consistants; les vis
coniques s'emploient dans ceux qui présentent plus de résistance.—Les
vis ne peuvent traverser le roc compacte ; mais, par leur développement
hélicoïdal, elles se frayent un chemin entre les pierres et les cailloux de
moyenne grosseur, qu'elles déplacent; elles peuvent même perforer des
bancs de coraux et de madrépores. Leur emploi souffre peu d'exceptions
dans les ports, les vallées et les lits de rivière, où le terrain est ordi-
nairement formé d'ajluvions et ne contient que des roches de transport
en masses isolées.
Pour déterminer, dans chaque cas particulier, le diamètre à donner
au disque supérieur de la vis, et sa profondeur de fiche, on devra re-
connaître par des sondages la résistance du terrain, tenir compte des
difficultés de fabrication, et surtout de la puissance nécessaire pour faire
pénétrer la vis dans le sol. Les dimensions et les dispositions de détail
de la vis varient à l'infini, selon les circonstances de son emploi. Nous
avons réuni dans la planche 49 diverses figures de pieux et d'amarres
hélicoïdales dont voici l'explication :
■ Fig, 1. — Vis en fonte à tige pleine en fer forgé, pour jetées, ponts, etc. Poids ;
60 kilogrammes.
Fig. 2. — Vis en fonte à tige pleine en fer forgé, pour phares (280 kilos).
Fig. 3. — Vis à tarière, employée dans les rochers nie corail.
Fig. i et S. — Vis à tiges creuses en fonte.
Fig. 6. — Vis en fonte à tige en fer forgé, employée au brise-lames de Portland
(425 kilos). Sabot en fonte lié par une barre en fer forgé de 0m. 127 de diamètre, avec la
tige de lavis. Pieu en bois.
Fig. 7. — Vis à tige en bois, employée pour la fondation de l'aqueduc de WellCreek
(déjà cité), construit par MM. Walker et Burges (180 kilos).
Fig. 8. — Vis à tige en bois, employée pour divers viaducs de chemins de fer, etc.
(140 kilos).
Fig. 9. — Vis à tige en bois, pour ponts, viaducs, etc., employée avec sabots, par
M. Biddler, pour supports d'un chemin de.fer en Norwége (190 kilos).
Fig. 10. — Vis pour poteaux de clôtures, de barrières, etc.
Fig. il. — Vis pour poteaux de télégraphes électriques., signaux, etc. (25 kilos).
Fig. 12. — Amarre à vis pour balises, haubans, ancrages hors de l'eau, et pour tra-
vaux provisoires (60 kilos).
Fig. 13. — Amarre à vis pour forte chaîne de plus de 32 millimètres de diamètre
(545 kilos).
Fig. 14. — Amarre à vis pour terrains très-résislants (425 kilos).
Fig. 15. — Amarre à vis des haubans, employée au brise-lames de Portland.
Fig. 16. — Amarre à vis détentes, bâches pour produits agricoles, etc. (5k.44).
L'introduction des pieux et amarres à vis dans le sol s'opère, comme
les sondages et les percements de puits artésiens, par l'intermédiaire
d'une tête de cabestan exactement appliquée sur la tige définitive du
pieu, ou sur une tige volante provisoirement adaptée à l'amarre. Dans
les cas ordinaires, les hommes agissent directement sur les barres du
cabestan pour produire là rotation, et, par suite, la pénétration de la
vis. Avec un cabestan à huit barres de 6 mètres de longueur, garnies
chacune de quatre à cinq hommes, suivant la résistance du terrain, des
amarres de lm.22 de diamètre ont été vissées à lxm.60 de profondeur en
une heure et demie, et quelques-unes à 6m.40 en moins de 2 heures,
sous une profondeur d'eau variant de 4'".60 à 7m.30; le terrain était
composé de sable, puis d'argile, enfin de roche schisteuse, oùlapointe
de la vis, en fer forgé, pénétra généralement de O-OO. — Lorsque l'é-
tablissement de plates-formes fixes ou flottantes, pour la circulation des
ouvriers autour du pieu, est difficile ou impossible, la tête du cabestan
est convertie en une roue, en évidant les extrémités des barres, pour
former une gorge, et les amarrant entre elles. Les hommes agissent
alors sur une corde sans fin maintenue par cette roue et par une poulie
placée à peu de distance. C'est ainsi que les jetées sont construites de
palée en palée, dans des mers agitées auxquelles les pontons ne pour-
raient résister; à Gourtown, on vissait ordinairement, chaque jour,
2 pieux de 0m.127 de diamètre, en fer, armés de vis en fonte de 0m.61
de diamètre, pénétrant de 3 mètres à 4m.30 dans un sol d'argile bleue
compacte, recouverte d'une couche de sable et de gravier de 2m.40
d'épaisseur; temps mauvais; hautes eaux de 3m.60 au-dessus du fond-
Les chaînes des amarres à vis pénètrent dans le sol accolées à la tige
provisoire, si elle est pleine, ou logées dans son intérieur lorsqu'elle
est creuse.
Pour de faibles ancrages à sec, on se sert de la vis fig. 12 (planche 49),
portant une tige dont l'oeil terminal reçoit un barreau de fer pour l'opé-
ration du vissage. Pour faire pénétrer cette vis à 2m.40 de profondeur,
ou pour l'en retirer, il suffit de 2 hommes et de quatre ou cinq minutes.
RÉSISTANCE. — ÉPREUVES. — AVANTAGES.
Nous consignerons ici, d'abord, les résultats obtenus dans les épreuves
sur la résistance des amarres à vis pour corps morts, faites en 1844
sous la direction de la corporation de Newcastle-sur-Tyne. Les expé-
riences furent faites avec des amarres fabriquées exprès, de très-pe-
tites dimensions, vissées dans un sol sableux, à de faibles profondeurs,
afin de rendre leur extraction plus facile. — Des ancres ordinaires et
des ancres perfectionnées de Porter et de Rogers, pesant 94 kilogr.,
furent arrachées du sol par une force de traction à laquelle résista une
amarre à vis du poids de 3M7, vissée à 0m.76 de profondeur, en quelques
minutes, par 2 hommes. — Une autre amarre pesant 7k.25, enfoncée à
la même profondeur que la première, résista mieux que des ancres de
235 kilogrammes. — Dans une troisième épreuve, une amarre de 0m.46
de diamètre (le plus petit modèle usité pour les balises et bouées de
sauvetage) fut fixée à 0m.91 de profondeur; sa résistance fut supérieure
tention des constructeurs sur les fondations tubulaires et sur l'utilité de
leur emploi dans un grand nombre de circonstances,
Nous venons aujourd'hui ouvrir une autre série d'articles sur un sujet
qui présente, avec celui des fondations tubulaires, les plus grandes
analogies. Nous voulons parler des pieux à vis et des amarres hélicoï-
dales en fer et en fonte. Ces éléments s'emploient beaucoup, depuis
quelque temps, en Angleterre, en Amérique, et dans les colonies de ces
deux pays.
Il est étonnant, il faut le dire, il est regrettable pour la France,
qu'un système connu de l'autre côté de la Manche depuis près de vingt
ans déjà , recommandé et appliqué fréquemment par les hommes les
plus éminents de la construction anglaise (BRONEL, CUBITT, STEPHEN-
SON , etc ) ne soit encore représenté chez nous que par quelques expé-
riences inédites faites au port du Havre de 1841 à 1849.
On se demande comment il a pu se faire que ce procédé de fondation
et d'amarre, aussi simple qu'économique et expéditif dans tous les ter-
rains sableux, vaseux, argileux, etc., n'ait pas encore conquis assez
l'estime dés ingénieurs français pour devenir, dans notre pays, d'une
application journalière. Quoi qu'il en soit, voici les documents les plus
récents que nous ayons pu nous procurer sur cette question. Puisse leur
publication contribuer, pour si peu que ce soit, au progrès d'une mé-
thode qui mérite toutes les sympathies des praticiens lorsqu'elle est
appliquée dans des circonstances convenables de terrain et pression.
HISTORIQUE.
Le premier exemple de l'emploi des amarres ou corps morts à vis,
est celui des bouées du port de Belfast, lieu de naissance de l'inventeur.
Elles ont été établies en l'année 1833. De 1834 à 1838, quelques ten-
tatives furent inutilement faites pour obtenir l'autorisation d'appliquer
le système des pieux à vis dans diverses localités. En 1838 , sur l'invi-
tation de M. BEAUFORT, maintenant amiral, M. MITCHELL fit le projet
d'un phare à établir sur le Maplin Sand (planche 50. fig. i et 2), qui
fut approuvé par la Corporation de Trinity-House sur l'avis favorable
de M. WALKER, son ingénieur. La fondation de ce phare, le premier
travail pour lequel on se servit de pieux à vis, fut commencée en
août 1838; mais les travaux ayant été interrompus pendant deux an-
nées, pour éprouver les pieux, le phare ne fut terminé qu'en 1841. —
C'est le 6 juin 1840 que fut allumé pour la première fois un phare fondé
sur des pieux à vis. Ce phare est situé à Fleefwood, sur la Wyre, dans
la baie de Morecambe. Les travaux, commencés à la fin de 1839, fu-
rent conduits par M. MITCHELL et par son fils, auteurs des projets. La
lanterne a été terminée en mars 1840, sauf le couronnement.
Voici, depuis lors, la liste des principaux ouvrages pour lesquels on
a fait usage de pieux et d'amarres à vis, avec l'indication des époques :
Amarres ou- corps morts placés dans les ports ci-àprès : Belfast (1833); Greenock,
Glasco'W (vers 1835); Newcastle (1846), moyennant une redevance de 62,000 fr. payée
par la corporation pour l'usage de la partie du brevet relative aux corps morts. —
En 1855, plus de trente ports d'Angleterre et d'autres pays se trouvèrent pourvus de
ce système.
Balisage de bancs de sable : Kishbank, près la baie de Dublin (1843); Arklow Bank
et Blaekvvater-Bank, sur la côte orientale d'Irlande (1846); Tongue Sand. à l'embou-
chure de la Tamise (1846) ; etc.
Phares construits sur les points suivants : Fleetwood-on-Wyre (1840); Maplin Sand
(1841) ; Belfast Lough (1844); Dundalk, baie et port (1849); Brandywine Bank, dans
la Dela-ware (1850); Spit Bank, dans le port de Cork (1851) ; Sand Key, dans la Flo-
ride (Amérique du Nord), fondé sur un roc de corail, à l'entrée du port de Key West
(1852). — De 1852 à 1855 : trois phares dans la baie de Galveston (Amérique); phare
de Morecambe (mer d'Irlande) ; phare de Gunfleet, à 25 kilomètres au large d'Hanvich.
Travaux maritimes. — Jetée de Gourtown (Wexford, Irlande), en 1847. — Brke-
lames de Portland, composé de deux jetées longues de 1,800 mètres fune et de
450 mètres l'autre, laissant entre elles un passage de 120 mètres de largeur; la pre-
mière pierre a été posée, le 25 juillet 1849, nar le prince Albert. — De 1352 à 1855 ■
Jetée de 180 mètres, à Porto-Espaûa (Trinidad) ; jetée de Victor-Bay (isthme de Pana-
ma); nouvelle jetée de Margate, fondée dans la craie.— En préparation: travaux
d'Adélaïde (Australie); de Eingstown (Jamaïque); de l'île de Java.
Bâtiments, viaducs, etc. — Pont-aqueduc de Well Creek, pour le drainage du
Middle Level (1849). — Hangars à Lincoln (Great Northern Raifway), etc., etc. — Té-
légraphe électrique sur poteaux, de Calcutta à Madras, à Bombay, etc. (40 000 po-
teaux à vis). .
DESCRIPTION ET MODE D'EMPLOI.
Les pieux et les amarres, à vis ou à hélice [screw piles, screw moor-
ings), sont deux applications distinctes de la vis réduite à quelques
spires dont la révolution supérieure, siège principal de la résistance,
est épandue en un disque aplati pouvant atteindre lm.20 de diamètre et
au delà. Il est facile, par un mouvement rotatoire, d'écarter les ob-
stacles à la descente, et de faire pénétrer cette f« à terrain dans la
plupart des sols à des profondeurs plus ou moins grandes, sans dislo-
cation des couches traversées. La vis, ainsi enfoncée, devient à la fois
une amarre résistant à la traction lorsque l'extrémité d'une chaîne d'a-
marrage est fixée à sa partie supérieure ; et une base résistant à la
compression, si l'on a boulonné sur sa tête une lige creuse ou pleine,
en bois ou en métal, qui vient affleurer le sol, et sur laquelle reposent
des constructions. — Les vis sont cylindriques ou coniques, générale-
ment en fonte, et très-exceptionnellement en fer forgé. Les tiges pleines
sont en bois, en fer ou en fonte. Les tiges creuses sont en tôle ou en
fonte. Il est des tiges où le fer est uni à la fonte.
Les vis cylindriques servent dans les terrains peu consistants; les vis
coniques s'emploient dans ceux qui présentent plus de résistance.—Les
vis ne peuvent traverser le roc compacte ; mais, par leur développement
hélicoïdal, elles se frayent un chemin entre les pierres et les cailloux de
moyenne grosseur, qu'elles déplacent; elles peuvent même perforer des
bancs de coraux et de madrépores. Leur emploi souffre peu d'exceptions
dans les ports, les vallées et les lits de rivière, où le terrain est ordi-
nairement formé d'ajluvions et ne contient que des roches de transport
en masses isolées.
Pour déterminer, dans chaque cas particulier, le diamètre à donner
au disque supérieur de la vis, et sa profondeur de fiche, on devra re-
connaître par des sondages la résistance du terrain, tenir compte des
difficultés de fabrication, et surtout de la puissance nécessaire pour faire
pénétrer la vis dans le sol. Les dimensions et les dispositions de détail
de la vis varient à l'infini, selon les circonstances de son emploi. Nous
avons réuni dans la planche 49 diverses figures de pieux et d'amarres
hélicoïdales dont voici l'explication :
■ Fig, 1. — Vis en fonte à tige pleine en fer forgé, pour jetées, ponts, etc. Poids ;
60 kilogrammes.
Fig. 2. — Vis en fonte à tige pleine en fer forgé, pour phares (280 kilos).
Fig. 3. — Vis à tarière, employée dans les rochers nie corail.
Fig. i et S. — Vis à tiges creuses en fonte.
Fig. 6. — Vis en fonte à tige en fer forgé, employée au brise-lames de Portland
(425 kilos). Sabot en fonte lié par une barre en fer forgé de 0m. 127 de diamètre, avec la
tige de lavis. Pieu en bois.
Fig. 7. — Vis à tige en bois, employée pour la fondation de l'aqueduc de WellCreek
(déjà cité), construit par MM. Walker et Burges (180 kilos).
Fig. 8. — Vis à tige en bois, employée pour divers viaducs de chemins de fer, etc.
(140 kilos).
Fig. 9. — Vis à tige en bois, pour ponts, viaducs, etc., employée avec sabots, par
M. Biddler, pour supports d'un chemin de.fer en Norwége (190 kilos).
Fig. 10. — Vis pour poteaux de clôtures, de barrières, etc.
Fig. il. — Vis pour poteaux de télégraphes électriques., signaux, etc. (25 kilos).
Fig. 12. — Amarre à vis pour balises, haubans, ancrages hors de l'eau, et pour tra-
vaux provisoires (60 kilos).
Fig. 13. — Amarre à vis pour forte chaîne de plus de 32 millimètres de diamètre
(545 kilos).
Fig. 14. — Amarre à vis pour terrains très-résislants (425 kilos).
Fig. 15. — Amarre à vis des haubans, employée au brise-lames de Portland.
Fig. 16. — Amarre à vis détentes, bâches pour produits agricoles, etc. (5k.44).
L'introduction des pieux et amarres à vis dans le sol s'opère, comme
les sondages et les percements de puits artésiens, par l'intermédiaire
d'une tête de cabestan exactement appliquée sur la tige définitive du
pieu, ou sur une tige volante provisoirement adaptée à l'amarre. Dans
les cas ordinaires, les hommes agissent directement sur les barres du
cabestan pour produire là rotation, et, par suite, la pénétration de la
vis. Avec un cabestan à huit barres de 6 mètres de longueur, garnies
chacune de quatre à cinq hommes, suivant la résistance du terrain, des
amarres de lm.22 de diamètre ont été vissées à lxm.60 de profondeur en
une heure et demie, et quelques-unes à 6m.40 en moins de 2 heures,
sous une profondeur d'eau variant de 4'".60 à 7m.30; le terrain était
composé de sable, puis d'argile, enfin de roche schisteuse, oùlapointe
de la vis, en fer forgé, pénétra généralement de O-OO. — Lorsque l'é-
tablissement de plates-formes fixes ou flottantes, pour la circulation des
ouvriers autour du pieu, est difficile ou impossible, la tête du cabestan
est convertie en une roue, en évidant les extrémités des barres, pour
former une gorge, et les amarrant entre elles. Les hommes agissent
alors sur une corde sans fin maintenue par cette roue et par une poulie
placée à peu de distance. C'est ainsi que les jetées sont construites de
palée en palée, dans des mers agitées auxquelles les pontons ne pour-
raient résister; à Gourtown, on vissait ordinairement, chaque jour,
2 pieux de 0m.127 de diamètre, en fer, armés de vis en fonte de 0m.61
de diamètre, pénétrant de 3 mètres à 4m.30 dans un sol d'argile bleue
compacte, recouverte d'une couche de sable et de gravier de 2m.40
d'épaisseur; temps mauvais; hautes eaux de 3m.60 au-dessus du fond-
Les chaînes des amarres à vis pénètrent dans le sol accolées à la tige
provisoire, si elle est pleine, ou logées dans son intérieur lorsqu'elle
est creuse.
Pour de faibles ancrages à sec, on se sert de la vis fig. 12 (planche 49),
portant une tige dont l'oeil terminal reçoit un barreau de fer pour l'opé-
ration du vissage. Pour faire pénétrer cette vis à 2m.40 de profondeur,
ou pour l'en retirer, il suffit de 2 hommes et de quatre ou cinq minutes.
RÉSISTANCE. — ÉPREUVES. — AVANTAGES.
Nous consignerons ici, d'abord, les résultats obtenus dans les épreuves
sur la résistance des amarres à vis pour corps morts, faites en 1844
sous la direction de la corporation de Newcastle-sur-Tyne. Les expé-
riences furent faites avec des amarres fabriquées exprès, de très-pe-
tites dimensions, vissées dans un sol sableux, à de faibles profondeurs,
afin de rendre leur extraction plus facile. — Des ancres ordinaires et
des ancres perfectionnées de Porter et de Rogers, pesant 94 kilogr.,
furent arrachées du sol par une force de traction à laquelle résista une
amarre à vis du poids de 3M7, vissée à 0m.76 de profondeur, en quelques
minutes, par 2 hommes. — Une autre amarre pesant 7k.25, enfoncée à
la même profondeur que la première, résista mieux que des ancres de
235 kilogrammes. — Dans une troisième épreuve, une amarre de 0m.46
de diamètre (le plus petit modèle usité pour les balises et bouées de
sauvetage) fut fixée à 0m.91 de profondeur; sa résistance fut supérieure
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 96.44%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 96.44%.
- Collections numériques similaires Corpus : Art de l'ingénieur Corpus : Art de l'ingénieur /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp15"Cosmos (1852) /ark:/12148/bd6t51143731d.highres Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences, les arts et les manufactures, tant en France que dans les pays étrangers pendant l'année ... : avec l'indication succincte des principaux produits de l'industrie française ; la liste des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, accordés par le gouvernement pendant la même année, et des notices sur les prix proposés ou décernés par différentes sociétés savantes, françaises et étrangères, pour l'encouragement des sciences et des arts /ark:/12148/bd6t53887780b.highresThématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"
- Auteurs similaires Oppermann Charles Alfred Oppermann Charles Alfred /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Oppermann Charles Alfred" or dc.contributor adj "Oppermann Charles Alfred")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 3/4
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k55770647/f3.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k55770647/f3.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k55770647/f3.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k55770647
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k55770647
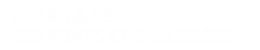


Facebook
Twitter