Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1858-12-10
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 10 décembre 1858 10 décembre 1858
Description : 1858/12/10 (A3,N60). 1858/12/10 (A3,N60).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203106f
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/05/2012
VENDREDI 10 DÉCEMBRE.
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS.
611
mises sous les yeux du Conseil, et qui seront aussi an-
nexées au procès-verbal.
Le Conseil reconnaît que les terrains placés au-dessus
des inondations pourront, dans quelques circonstances
particulières, être fertilisés par l'irrigation aitificielle;
mais ces terrains n'auront jamais, sans doute, assez
d'étendue pour qu'il y ait lieu de s'en préoccuper actuel-
lement. On doit admettre qu'ils seront presque exclusi-
vemcnt utilisés par des semis analogues à ceux des
landes de Gascogne.
Quant aux 63,000 hectares de terrains inondables et
qui sont, à plus forte raison, susceptibles d'irrigation,
les eaux devront y être portées, soit directement par le
canal d'eau douce, soit par des dérivations de ce canal,
soit par le prolongement de la branche pélusiaque de
Salaïeh. Ces dérivations et ce prolongement, pour l'avant-
projet desquels on pourrait, à la rigueur, trouver les
éléments les plus essentiels sur les plans cadastraux, ne
paraissent pas devoir figurer dans les dépenses de pre-
mier établissement, mais rentrer dans les frais de cul-
ture des terrains concédés, soit que la Compagnie
veuille ultérieurement les exploiter elle-même, soit
qu'elle se décide à les aliéner.
Des considérations qui précèdent, il résulte que le seul
projet dont on ait à s'occuper est celui du canal d'eau
douce entre le Nil et le lac Timsah.
La question ainsi posée, M. Mougel explique que dans
cette partie de l'Égypte, les terrains peuvent être ferti-
lisés, soit par l'irrigation, soit par l'inondation seule-
ment; que, dans le premier cas, un volume d'eau de
50 mètres cubes par jour et par hectare doit en moyenne
être considéré comme suffisant, et qu'on obtient de
bons résultats en recouvrant les terrains inondables
d'une couche d'eau de 0,70.
Après avoir enlendu ces explications, le Conseil ad-
met que le canal définitif et ses dérivations auront à
pourvoir à l'arrosage de 44,000 hectares pendant les
eaux basses, mais que pendant un certain temps il suf-
fira d'assurer l'irrigation de 22,000 hectares, en affec-
tant d'ailleurs aux inondations tout le surplus des eaux
qui pourront être introduites dans le canal pendant les
crues du Nil.
Le Conseil examine ensuite quel système de prise
d'eau doit être adopté. Un membre fait remarquer que
la Commission internationale a évité de se prononcer sur
ce point, parce qu'au moment où elle se réunissait, le
gouvernement égyptien devait exécuter à forfait le canal
d'eau douce. Mais aujourd'hui que cette combinaison est
abandonnée, il n'hésite pas à se prononcer contre le
système de l'avant-projet, qui consistait à porter les
eaux dans le canal par des machines élévatoires. Un
volume d'eau qui pendant l'étiage s'élèverait à 28 mètres
cubes environ par seconde pour le canal définitif, et ne
devraitpas aujourd'hui être inférieur à 15 mètres cubes,
semble exclure d'une manière presque absolue l'emploi
d'un pareil moyen, et pour y recourir, il faudrait que
l'introduction directe des eaux dans le canal présentât
les plus graves difficultés.
M. Mougel explique qu'il n'en est pas ainsi. En effet,
il existe au-dessous du Caire un canal séfi (c'est-à-dire
au-dessous du niveau d'étiage). Ce canal, qui porte le
nom de Cherkaouieh, s'est bien maintenu et n'exige que
des frais d'entretien assez modérés. En établissant la
prise d'eau du canal à peu de distance en amont, on est
à peu près assuré de ne rencontrer que des difficultés
ordinaires. Après un parcours de quelques kilomètres,
on rejoindrait le Zaffraniéh , canal dont le plafond est déjà
à la hauteur de l'étiage, et qu'on pourra emprunter en
lui donnant une largeur et une profondeurplus grandes.
Cette solution parait devoir être d'autant plus adoptée,
qu'elle épargne les difficultés qu'on rencontrerait aujour-
d'hui pour établir la prise d'eau près du Caire, à travers
des terrains précieux qu'il serait difficile d'exproprier ou
d'acquérir à l'amiable.
A l'appui de ces observations, un membre met sous
les yeux du Conseil trois profils de fouilles que AI. Li-
nant-Bey a fait ouvrir sur la ligne de ce nouveau tracé;
ces profils donnent lieu de penser que l'on ne rencon-
trera pas en creusant le canal les sables coulants dont
on redoutait la présence. (Ces profils resteront annexés
au procès-verbal.)
Après avoir entendu ces explications, le Conseil est
d'avis :
Que la prise d'eau du canal soit faite près et en amont
de celle de Cherkaouiéh, à la côte environ de 23, 32
(G,68 au-dessus du couronnement du quai de Suez),
sauf à relever cette prise d'eau près du Nil, en élargis-
sant le canal de manière à ne pas modifier le volume
d'eau qui serait introduit dans le canal, ni la pente gé-
nérale qui va être indiquée.
Que le tracé soit dirigé de manière à rejoindre auprès
de Mesteroud le canal Zarrraniéh, à suivre ce canal le
plus longtemps possible, à traverser rOuadée-Tou-
milat, pour se placer sur le versant gauche jusqu'au
désert;
Que le plafond du canal soit réglé suivant une pente
de 0,045 par kilomètre ;
Qu'il y ait quatre écluses ; l'une à la prise d'eau, les
trois autres à peu près dans les emplacements indiqués
par le projet primitifen remontant à partir du lac Timsah;
Que le canal définitif soit établi conformément au
profil annexé;
Que la largeur du canal, qui serait exécuté immédia-
tement, soit réduite à 10 mètres au plafond;
Que les écluses soient construites sur les dimensions
du projet primitif, de telle sorte que les bateaux à va-
peur puissent être conduits du Nil au canal maritime;
Qu'enfin, on emploiera, pour consolider les talus sur
toute la surface comprise entre le niveau d'étiage et le
niveau d'inondation, des iplantations d'halpha ou toutes
autres qui pourraient réussir dans les conditions où elles
se trouveront placées.
Le Conseil invite MAI. les ingénieurs à faire l'estima-
tion des dépenses qu'entraîneraient l'exécution du canal
définitif et celle du canal réduit à 10 mètres au plafond.
Sur l'invitation du Conseil, M. Mougel explique que
JOURNAL DE L'UNION DES DEUX MERS.
611
mises sous les yeux du Conseil, et qui seront aussi an-
nexées au procès-verbal.
Le Conseil reconnaît que les terrains placés au-dessus
des inondations pourront, dans quelques circonstances
particulières, être fertilisés par l'irrigation aitificielle;
mais ces terrains n'auront jamais, sans doute, assez
d'étendue pour qu'il y ait lieu de s'en préoccuper actuel-
lement. On doit admettre qu'ils seront presque exclusi-
vemcnt utilisés par des semis analogues à ceux des
landes de Gascogne.
Quant aux 63,000 hectares de terrains inondables et
qui sont, à plus forte raison, susceptibles d'irrigation,
les eaux devront y être portées, soit directement par le
canal d'eau douce, soit par des dérivations de ce canal,
soit par le prolongement de la branche pélusiaque de
Salaïeh. Ces dérivations et ce prolongement, pour l'avant-
projet desquels on pourrait, à la rigueur, trouver les
éléments les plus essentiels sur les plans cadastraux, ne
paraissent pas devoir figurer dans les dépenses de pre-
mier établissement, mais rentrer dans les frais de cul-
ture des terrains concédés, soit que la Compagnie
veuille ultérieurement les exploiter elle-même, soit
qu'elle se décide à les aliéner.
Des considérations qui précèdent, il résulte que le seul
projet dont on ait à s'occuper est celui du canal d'eau
douce entre le Nil et le lac Timsah.
La question ainsi posée, M. Mougel explique que dans
cette partie de l'Égypte, les terrains peuvent être ferti-
lisés, soit par l'irrigation, soit par l'inondation seule-
ment; que, dans le premier cas, un volume d'eau de
50 mètres cubes par jour et par hectare doit en moyenne
être considéré comme suffisant, et qu'on obtient de
bons résultats en recouvrant les terrains inondables
d'une couche d'eau de 0,70.
Après avoir enlendu ces explications, le Conseil ad-
met que le canal définitif et ses dérivations auront à
pourvoir à l'arrosage de 44,000 hectares pendant les
eaux basses, mais que pendant un certain temps il suf-
fira d'assurer l'irrigation de 22,000 hectares, en affec-
tant d'ailleurs aux inondations tout le surplus des eaux
qui pourront être introduites dans le canal pendant les
crues du Nil.
Le Conseil examine ensuite quel système de prise
d'eau doit être adopté. Un membre fait remarquer que
la Commission internationale a évité de se prononcer sur
ce point, parce qu'au moment où elle se réunissait, le
gouvernement égyptien devait exécuter à forfait le canal
d'eau douce. Mais aujourd'hui que cette combinaison est
abandonnée, il n'hésite pas à se prononcer contre le
système de l'avant-projet, qui consistait à porter les
eaux dans le canal par des machines élévatoires. Un
volume d'eau qui pendant l'étiage s'élèverait à 28 mètres
cubes environ par seconde pour le canal définitif, et ne
devraitpas aujourd'hui être inférieur à 15 mètres cubes,
semble exclure d'une manière presque absolue l'emploi
d'un pareil moyen, et pour y recourir, il faudrait que
l'introduction directe des eaux dans le canal présentât
les plus graves difficultés.
M. Mougel explique qu'il n'en est pas ainsi. En effet,
il existe au-dessous du Caire un canal séfi (c'est-à-dire
au-dessous du niveau d'étiage). Ce canal, qui porte le
nom de Cherkaouieh, s'est bien maintenu et n'exige que
des frais d'entretien assez modérés. En établissant la
prise d'eau du canal à peu de distance en amont, on est
à peu près assuré de ne rencontrer que des difficultés
ordinaires. Après un parcours de quelques kilomètres,
on rejoindrait le Zaffraniéh , canal dont le plafond est déjà
à la hauteur de l'étiage, et qu'on pourra emprunter en
lui donnant une largeur et une profondeurplus grandes.
Cette solution parait devoir être d'autant plus adoptée,
qu'elle épargne les difficultés qu'on rencontrerait aujour-
d'hui pour établir la prise d'eau près du Caire, à travers
des terrains précieux qu'il serait difficile d'exproprier ou
d'acquérir à l'amiable.
A l'appui de ces observations, un membre met sous
les yeux du Conseil trois profils de fouilles que AI. Li-
nant-Bey a fait ouvrir sur la ligne de ce nouveau tracé;
ces profils donnent lieu de penser que l'on ne rencon-
trera pas en creusant le canal les sables coulants dont
on redoutait la présence. (Ces profils resteront annexés
au procès-verbal.)
Après avoir entendu ces explications, le Conseil est
d'avis :
Que la prise d'eau du canal soit faite près et en amont
de celle de Cherkaouiéh, à la côte environ de 23, 32
(G,68 au-dessus du couronnement du quai de Suez),
sauf à relever cette prise d'eau près du Nil, en élargis-
sant le canal de manière à ne pas modifier le volume
d'eau qui serait introduit dans le canal, ni la pente gé-
nérale qui va être indiquée.
Que le tracé soit dirigé de manière à rejoindre auprès
de Mesteroud le canal Zarrraniéh, à suivre ce canal le
plus longtemps possible, à traverser rOuadée-Tou-
milat, pour se placer sur le versant gauche jusqu'au
désert;
Que le plafond du canal soit réglé suivant une pente
de 0,045 par kilomètre ;
Qu'il y ait quatre écluses ; l'une à la prise d'eau, les
trois autres à peu près dans les emplacements indiqués
par le projet primitifen remontant à partir du lac Timsah;
Que le canal définitif soit établi conformément au
profil annexé;
Que la largeur du canal, qui serait exécuté immédia-
tement, soit réduite à 10 mètres au plafond;
Que les écluses soient construites sur les dimensions
du projet primitif, de telle sorte que les bateaux à va-
peur puissent être conduits du Nil au canal maritime;
Qu'enfin, on emploiera, pour consolider les talus sur
toute la surface comprise entre le niveau d'étiage et le
niveau d'inondation, des iplantations d'halpha ou toutes
autres qui pourraient réussir dans les conditions où elles
se trouveront placées.
Le Conseil invite MAI. les ingénieurs à faire l'estima-
tion des dépenses qu'entraîneraient l'exécution du canal
définitif et celle du canal réduit à 10 mètres au plafond.
Sur l'invitation du Conseil, M. Mougel explique que
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.88%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.88%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 11/24
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6203106f/f11.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6203106f/f11.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6203106f/f11.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6203106f
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6203106f
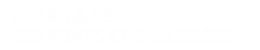


Facebook
Twitter