Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1858-03-10
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 10 mars 1858 10 mars 1858
Description : 1858/03/10 (A3,N42). 1858/03/10 (A3,N42).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203088z
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/10/2012
126 L'ISTHME DE SUEZ, MERCREDI 10 MARS.
confirmés par le Roi. Toutes les autres présidences durent
obéir au gouverneur général, qui ne pouvait d'ailleurs, sans
son conseil, ni déclarer la guerre, ni passer aucun traité. Les
vingt-quatre directeurs devaient fonctionner chacun pendant
quatre ans. Malgré tous ces changements, les affaires finan-
cières de la Compagnie ne s'amélioraient point, et le gouver-
nement dut venir encore à son aide, en lui faisant une avance
de plus de 30 millions de livres, et en lui remettant des dettes
considérables.
Sous l'administration de lord Cornwallis et du niarquis de
Wellesley, gouverneurs généraux des Indes, les recettes de la
Compagnie s'augmentèrent d'une manière notable, par suite
de la conquête des États de Ti.ppoo-Saïb et de la prise de
Dehli. La rente territoriale qui en 1797 était de 8 millions
de livres, ou 200 millions de francs, se trouva être en 1815 de
15 millions de livres; mais, néanmoins, la dette générale de
la Compagnie s'accroissait toujours.
En 1793, la charte de la Compagnie fut prolongée de vingt
ans (jusqu'en 1814), et en 1813 de vingt autres années (jus-
qu'en 1834). Depuis cette époque, le commerce avec les Indes
orientales fut déclaré libre, et la Compagnie ne conserva que
le monopole du commerce avec la Chine.
En 1832 et 1833, on discuta de nouveau la question du
renouvellement du privilège, qui fut accordé pour vingt ans,
c'est-à-dire jusqu'en 1854. C'est, on peut dire, la fin de
l'existence commerciale de la Compagnie. A dater de cette épo-
que, elle neJut pllj qu'une administration politique chargée de
recouvrer les impôts et de régler les revenus de l'Empire,
sous la surveillance d'une Cour de vingt-quatre directeurs et
sous la direction du Bureau du contrôle créé par Pitt dès 1784.
Depuis 1854, le nombre des directeurs a été réduit à dix-
huit, dont six nommés par la Couronne.
L'administration locale des Indes fut confiée à trois gouver-
neurs, qui résidèrent aux chefs-lieux des trois présidences,
Calcutta, Madras, Bombay, plus un lieutenant gouverneur à
A g r a. Le gouverneur de Calcutta a le titre de gouverneur gé-
néral des Indes, et les autres dépendent de lui. Pour assister
le gouverneur général, il y a un conseil suprême qu'on ap-
pelle Conseil des Indes, composé de quatre membres et du
général commandant en chef les armées des trois présidences.
Le gouverneur général a, sous certains rapports, des pou-
voirs plus étendus que ceux dont jouissent bien des souverains
de l'Europe. Non-seulement il est le chef de l'Etat; mais il
commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre,
signe les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme
les employés, et peut aussi faire des lois et des règlements
nouveaux, abolir ou modifier les lois existantes; et quoique
ses ordonnances doivent être soumises à la révision du gou-
vernement supérieur de la Compagnie en Angleterre, elles
reçoivent leur exécution jusqu'à ce que la Cour des directeurs
et le Bureau de contrôle aient prononcé diversement.
Tous les princes indigènes qui régnent encore sur une
grande étendue de l'Inde ont une autorité absolue sur leurs
sujets. Dans les principautés tributaires, le gouvernement
peut être regardé comme se rapprochant de notre système
féodal. Deux cents royaumes, principautés et fiefs dépendent
ou sont tributaires de la Compagnie. En admettant la division
proposée par M. Warren, les princes assujettis à la protection
de la Compagnie ou dépendants de la Compagnie peuvent se
partager en quatre classes : 1° princes indépendants dans leur
administration intérieure, mais dépendants du gouvernement
anglais dans le sens politique; 2° princes dont les États sont
gouvernés par un ministre élu par la Compagnie et mis sous
la protection immédiate du représentant anglais; 3° princes
dont les États sont gouvernés en leur nom par le résident
anglais; 40 princes dépossédés et pensionnés, mais conser-
vant les prérogatives de la caste, inviolables dans leurs per-
sonnes et non assujettis aux cours ordinaires .de justice, ex-
cepté en matière politique.
La population générale de l'Empire indien est à peu près
de 200 millions d'habitants, comme nous l'avons dit ci-dessus.
Les recettes de l'année 1855-56, dans la présidence du
Bengale, ont été de 11,800,732 livres; pour Agra, de
5,800,800; pour le Pundjab, de 850,040; dans la présidence
de Madras , de 5,904,930 ; dans celle de Bombay, de
3,330, 442. En tout 27,692,942 livres, ou près de 700 millions
de francs.
Ces recettes proviennent de la rente territoriale pour
15,148,360 livres; de la douane, pour 1,900,479; des. sels,
pour 2,358,017; de l'opium, pour 4,842,579; de la poste et
du timbre, pour 697,593; des tributs, pour 3,745,896.
Les dépenses de la même année 1855-56 sont, pour le Ben-
gale, de 12,455,890 livres; pour Agra, de 2,970,051; pour
le Pundjab, de 1,264,123; pour Madras, de 4,805,900; pour
Bombay, de 4,877,240, et pour l'Angleterre, de 3,381,264.
En tout 29,754,468 livres ou 750,000,000 fr.
Sur ces dépenses, 428,935 lir. st. sont affectées au recou-
vrement des impôts, 2,266,897 à l'administration civile et
politique, 1,408,413 à l'administration de la justice,
11,247,034 pour l'armée de terre et de mer, 1,582,176 pour
les travaux publics, 9,379,149 pour pensions aux princes
indigènes et autres frais, et enfin les dépenses faites en An-
gleterre.
La dette publique, a partir de 1794 jusqu'en 1856, était
de 62,095,175 liv. st. pour l'ensemble des présidences; la
guerre actuelle l'augmentera encore de beaucoup.
L'armée anglo-indienne se compose de trois corps distincts
pour chacune des trois principales présidences, où ils sont
commandés par les trois généraux en chef. Le commandant
de l'armée du Bengale est le généralissime de toutes les forces.
Deux éléments concourent à former l'armée : ce sont les troupes
européennes et les troupes indigènes. Les premières sont des
troupes royales au service,de la Compagnie, et les Européens
des corps du génie et de l'artillerie et l'infanterie sont à la
solde de la Compagnie. L'armée royale, de 1813 à 1840, n'a
jamais dépassé le chiffre de 21,918 hommes ; mais, au début
de l'insurrection actuelle, elle était de 29,480. Les Européens
à la solde de la Compagnie, du temps de Georges III, n'excé-
daient pas 12,200 hommes.
L'élément indien prévalait dans l'armée du Bengale et dans
celle de Madras : l'infanterie comptait 30,000 radjapouttras;
et la cavalerie est recrutée , généralement parlant, parmi les
mahométans, dans les trois présidences de Bengale, Madras
et Bombay.
En 1737, après la prise dq,.Calcutta, l'on forma le premier
bataillon de cipayes. Lorsque le colonel Clive, en 1757, ren-
versa le nabab du Bengale avec 2,194 cipayes et 900 Euro-
péens, il gagna la célèbre bataille de Plassey contre une
armée indigène de 50,000 fantassins et 18,000 cavaliers. On
crut dès lors à l'utilité de telles troupes, et on organisa des
régiments réguliers de cipayes par ordre du gouvernement an-
glais , tant d'infanterie que de cavalerie irrégulière , appelées
SJdnner's horses, du nom du colonel Skinner, qui en fut le
fondateur. L'armée anglo-indienne, en 1852, se composait
de 29,480 hommes de troupes royales anglaises, de 19,928
Européens, de 240,121 indigènes, en tout 289,529 hommes.
Il y avait dans cette armée 2,569 hommes du génie, dont
2,248 indigènes; 16,110 artilleurs, dont 9,004 indigènes;
confirmés par le Roi. Toutes les autres présidences durent
obéir au gouverneur général, qui ne pouvait d'ailleurs, sans
son conseil, ni déclarer la guerre, ni passer aucun traité. Les
vingt-quatre directeurs devaient fonctionner chacun pendant
quatre ans. Malgré tous ces changements, les affaires finan-
cières de la Compagnie ne s'amélioraient point, et le gouver-
nement dut venir encore à son aide, en lui faisant une avance
de plus de 30 millions de livres, et en lui remettant des dettes
considérables.
Sous l'administration de lord Cornwallis et du niarquis de
Wellesley, gouverneurs généraux des Indes, les recettes de la
Compagnie s'augmentèrent d'une manière notable, par suite
de la conquête des États de Ti.ppoo-Saïb et de la prise de
Dehli. La rente territoriale qui en 1797 était de 8 millions
de livres, ou 200 millions de francs, se trouva être en 1815 de
15 millions de livres; mais, néanmoins, la dette générale de
la Compagnie s'accroissait toujours.
En 1793, la charte de la Compagnie fut prolongée de vingt
ans (jusqu'en 1814), et en 1813 de vingt autres années (jus-
qu'en 1834). Depuis cette époque, le commerce avec les Indes
orientales fut déclaré libre, et la Compagnie ne conserva que
le monopole du commerce avec la Chine.
En 1832 et 1833, on discuta de nouveau la question du
renouvellement du privilège, qui fut accordé pour vingt ans,
c'est-à-dire jusqu'en 1854. C'est, on peut dire, la fin de
l'existence commerciale de la Compagnie. A dater de cette épo-
que, elle neJut pllj qu'une administration politique chargée de
recouvrer les impôts et de régler les revenus de l'Empire,
sous la surveillance d'une Cour de vingt-quatre directeurs et
sous la direction du Bureau du contrôle créé par Pitt dès 1784.
Depuis 1854, le nombre des directeurs a été réduit à dix-
huit, dont six nommés par la Couronne.
L'administration locale des Indes fut confiée à trois gouver-
neurs, qui résidèrent aux chefs-lieux des trois présidences,
Calcutta, Madras, Bombay, plus un lieutenant gouverneur à
A g r a. Le gouverneur de Calcutta a le titre de gouverneur gé-
néral des Indes, et les autres dépendent de lui. Pour assister
le gouverneur général, il y a un conseil suprême qu'on ap-
pelle Conseil des Indes, composé de quatre membres et du
général commandant en chef les armées des trois présidences.
Le gouverneur général a, sous certains rapports, des pou-
voirs plus étendus que ceux dont jouissent bien des souverains
de l'Europe. Non-seulement il est le chef de l'Etat; mais il
commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre,
signe les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme
les employés, et peut aussi faire des lois et des règlements
nouveaux, abolir ou modifier les lois existantes; et quoique
ses ordonnances doivent être soumises à la révision du gou-
vernement supérieur de la Compagnie en Angleterre, elles
reçoivent leur exécution jusqu'à ce que la Cour des directeurs
et le Bureau de contrôle aient prononcé diversement.
Tous les princes indigènes qui régnent encore sur une
grande étendue de l'Inde ont une autorité absolue sur leurs
sujets. Dans les principautés tributaires, le gouvernement
peut être regardé comme se rapprochant de notre système
féodal. Deux cents royaumes, principautés et fiefs dépendent
ou sont tributaires de la Compagnie. En admettant la division
proposée par M. Warren, les princes assujettis à la protection
de la Compagnie ou dépendants de la Compagnie peuvent se
partager en quatre classes : 1° princes indépendants dans leur
administration intérieure, mais dépendants du gouvernement
anglais dans le sens politique; 2° princes dont les États sont
gouvernés par un ministre élu par la Compagnie et mis sous
la protection immédiate du représentant anglais; 3° princes
dont les États sont gouvernés en leur nom par le résident
anglais; 40 princes dépossédés et pensionnés, mais conser-
vant les prérogatives de la caste, inviolables dans leurs per-
sonnes et non assujettis aux cours ordinaires .de justice, ex-
cepté en matière politique.
La population générale de l'Empire indien est à peu près
de 200 millions d'habitants, comme nous l'avons dit ci-dessus.
Les recettes de l'année 1855-56, dans la présidence du
Bengale, ont été de 11,800,732 livres; pour Agra, de
5,800,800; pour le Pundjab, de 850,040; dans la présidence
de Madras , de 5,904,930 ; dans celle de Bombay, de
3,330, 442. En tout 27,692,942 livres, ou près de 700 millions
de francs.
Ces recettes proviennent de la rente territoriale pour
15,148,360 livres; de la douane, pour 1,900,479; des. sels,
pour 2,358,017; de l'opium, pour 4,842,579; de la poste et
du timbre, pour 697,593; des tributs, pour 3,745,896.
Les dépenses de la même année 1855-56 sont, pour le Ben-
gale, de 12,455,890 livres; pour Agra, de 2,970,051; pour
le Pundjab, de 1,264,123; pour Madras, de 4,805,900; pour
Bombay, de 4,877,240, et pour l'Angleterre, de 3,381,264.
En tout 29,754,468 livres ou 750,000,000 fr.
Sur ces dépenses, 428,935 lir. st. sont affectées au recou-
vrement des impôts, 2,266,897 à l'administration civile et
politique, 1,408,413 à l'administration de la justice,
11,247,034 pour l'armée de terre et de mer, 1,582,176 pour
les travaux publics, 9,379,149 pour pensions aux princes
indigènes et autres frais, et enfin les dépenses faites en An-
gleterre.
La dette publique, a partir de 1794 jusqu'en 1856, était
de 62,095,175 liv. st. pour l'ensemble des présidences; la
guerre actuelle l'augmentera encore de beaucoup.
L'armée anglo-indienne se compose de trois corps distincts
pour chacune des trois principales présidences, où ils sont
commandés par les trois généraux en chef. Le commandant
de l'armée du Bengale est le généralissime de toutes les forces.
Deux éléments concourent à former l'armée : ce sont les troupes
européennes et les troupes indigènes. Les premières sont des
troupes royales au service,de la Compagnie, et les Européens
des corps du génie et de l'artillerie et l'infanterie sont à la
solde de la Compagnie. L'armée royale, de 1813 à 1840, n'a
jamais dépassé le chiffre de 21,918 hommes ; mais, au début
de l'insurrection actuelle, elle était de 29,480. Les Européens
à la solde de la Compagnie, du temps de Georges III, n'excé-
daient pas 12,200 hommes.
L'élément indien prévalait dans l'armée du Bengale et dans
celle de Madras : l'infanterie comptait 30,000 radjapouttras;
et la cavalerie est recrutée , généralement parlant, parmi les
mahométans, dans les trois présidences de Bengale, Madras
et Bombay.
En 1737, après la prise dq,.Calcutta, l'on forma le premier
bataillon de cipayes. Lorsque le colonel Clive, en 1757, ren-
versa le nabab du Bengale avec 2,194 cipayes et 900 Euro-
péens, il gagna la célèbre bataille de Plassey contre une
armée indigène de 50,000 fantassins et 18,000 cavaliers. On
crut dès lors à l'utilité de telles troupes, et on organisa des
régiments réguliers de cipayes par ordre du gouvernement an-
glais , tant d'infanterie que de cavalerie irrégulière , appelées
SJdnner's horses, du nom du colonel Skinner, qui en fut le
fondateur. L'armée anglo-indienne, en 1852, se composait
de 29,480 hommes de troupes royales anglaises, de 19,928
Européens, de 240,121 indigènes, en tout 289,529 hommes.
Il y avait dans cette armée 2,569 hommes du génie, dont
2,248 indigènes; 16,110 artilleurs, dont 9,004 indigènes;
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 22/24
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6203088z/f22.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6203088z/f22.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6203088z/f22.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6203088z
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6203088z
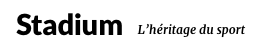


Facebook
Twitter