Titre : L'Isthme de Suez : journal de l'union des deux mers / gérant Ernest Desplaces
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1858-01-25
Contributeur : Desplaces, Ernest (1828-1893?). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34430392j
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 4673 Nombre total de vues : 4673
Description : 25 janvier 1858 25 janvier 1858
Description : 1858/01/25 (A3,N39). 1858/01/25 (A3,N39).
Description : Collection numérique : Bibliothèques d'Orient Collection numérique : Bibliothèques d'Orient
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Description : Collection numérique : Corpus : canaux, écluses,... Collection numérique : Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure
Description : Collection numérique : Corpus : ports et travaux... Collection numérique : Corpus : ports et travaux maritimes
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k6203085q
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-O3b-240
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 24/10/2012
54 L'ISTHME DE SUEZ, LUNDI 25 JANVIER.
Nous nous bornons aujourd'hui à donner à nos lec-
teurs le préambule par lequel s'ouvre l'ouvrage de
M. Merruau et une grande portion du premier chapitre.
Barthélémy SAINT-HILAIRE.
L'Europe occidentale attache un grand prix à l'intégrité de
l'Empire Ottoman. Elle vient de faire un effort suprême; elle
a prodigué ses trésors et son sang pour sauver cet empire,
1 attaqué par un puissant voisin. La cause si vaillamment dé-
fendue a pu trouver dans le principe les opinions partagées.
Aujourd'hui, en France et en Angleterre surtout, elle ne peut
plus être envisagée que sous un seul. et même aspect. Les
sacrifices qu'elle nous a imposés l'ont grandie, nous l'ont
rendue chère, et l'ont mise en quelque sorte au-dessus de
toute discussion; seulement il est bien entendu que l'Empire
Ottoman doit s'aider lui-même, et ce n'est que par une trans-
formation chaque jour plus complète qu'il se mettra en mesure
de maUriser ses destinées, sans avoir à faire de constants
appels à l'Europe.
Cette œuvre de transformation a été commencée heureuse-
ment depuis près d'un demi-siècle déjà; elle a été entreprise
à la fois au nord et au midi de l'Empire par deux hommes
dont les noms seront toujours honorés dans les annales de la
Turquie. L'un de ces hommes était le sultan Mahmoud, l'autre
le pacha d'Egypte Méhèmet-Ali. Quand ils prirent en main
simultanément la réforme des institutions de l'Orient, la Tur-
quie et l'Égypte étaient en pleine dissolution. Leurs efforts
n'ont pas été infructueux; on dirait que le vieil arbre veut
reverdir. Il y a certainement beaucoup à faire encore pour
lui rendre la vigueur, il renferme toujours bien des éléments
de corruption et de mort; mais les héritiers de Mahmoud et
de Méhémet-Ali paraissent comprendre l'étendue de la tâche
qui leur est confiée : ils semblent décidés à poursuivre l'œuvre
réformatrice, et l'Europe ne saurait leur refuser ni ses encou-
ragements ni ses éloges.
Un récent séjour en Egypte nous a permis d'étudier un des
aspects de la réforme orientale, celui auquel est attaché le
nom de Méhémet-Ali, et dont l'Europe ne s'est peut-être pas
assez préoccupée depuis la mort de ce prince. Nous voudrions
montrer ce que trois années d'un bon gouvernement peuvent
faire pour la prospérité d'un pays obligé à la fois de réformer
ses mœurs et ses institutions. La question mériterait à tous
égards d'être examinée, quand même nous n'aurions pas à
signaler là un des éléments du grand problème de la transfor-
mation de la Turquie.
Chaque jour nous voyons grandir l'intérêt qui s'attache à
la stabilité et à la prospérité de l'Égypte. Ce n'est pas seule-
ment un intérêt politique, c'est quelque chose de plus intime,
de plus individuel. En effet, des négociants, des industriels,
des hommes exerçant des professions libérales ne cessent de
porter leurs capitaux, leur activité, leur expérience dans
cette belle vallée du Nil, l'une des plus fertiles du monde.
Par suite il existe de tels liens entre nous et cette partie de
l'Orient, que sa prospérité est la nôtre, comme sa ruine ou
son seul dépérissement serait une calamité pour nous.
Il est donc satisfaisant de savoir que les destinées de l'Egypte
sont confiées à un prince animé des intentions les plus libé-
rales et qui, en trois années de règne, a prouvé, par les actes
les plus éclatants, sa ferme résolution de développer, non-
seulement les ressources matérielles du pays, mais encore le
génie particulier et le bonheur de son peuple.
La réforme égyptienne a dû embrasser trois ordres de faits:
l'administration d'abord, puis le système de la propriété,
enfin le développement de la vie intellectuelle et des forces
productrices du pays. C'est dans cette triple direction aussi
que se sont portées les recherches dont se grouperont ici les
principaux résultats.
CHAPITRE 1.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE.
Le hatti-schérif de 1841, qui assurait à Méhémet-Ali et à
ses descendants le gouvernement héréditaire de l'Egypte, a
détaché de ce gouvernement les provinces conquises par les
armes du chef de la famille, c'est-à-dire l'Arabie et la Syrie.
L'Egypte proprement dite forme la totalité de l'apanage que
les puissances, après le traité de 1840, ont réservé à la famille
du Vice-roi, sous la souveraineté de la Porte. Toutefois, le
même hatti-schérif y a joint les provinces de l'intérieur : la
Nubie, le Kordofan, le Sennaar, et autres territoires situés
aux environs du point de jpnction du Nil bleu et du Nil blanc
avec le fleuve qui traverse l'Egypte et qui la féconde. Tel est
le territoire sur lequel s'étend aujourd'hui l'autorité du Pacha
d'Egypte, et que, dans les dernières années de son règne,
Méhémet-Ali divisa en soixante-quatre départements, sans
comprendre les provinces du Soudan, et abstraction faite du
Caire, de Damiette et de Rosette, qui devaient être administrés.
à part.
La vie d'un monarque est bien courte, surtout quand il
s'agit de fonder un empire. Méhémet-Ali n'eût-il fait cepen-
dant que conquérir l'hérédité pour ses descendants, c'eût été
déjà beaucoup, car il assurait ainsi à l'Egypte la contyiuité
d'un gouvernement qui est identifié à ses destinées, et qui ne
peut manquer de prendre intérêt à sa prospérité. Autre chose
est une sorte de souveraineté héréditaire, autre chose une
succession de gouverneurs qui ne songent qu'à leur intérêt
personnel pendant leur court passage à la tête de l'administra-
tion d'un pays. L'Egypte, plus qu'aucun autre peut-être, sait
ce que vaut le gouvernement des proconsuls.
Malheureusement, une fois l'hérédité obtenue, Méhémet-
Ali crut sa tâche accomplie. Dès que les traités de 1841 eurent
décidé du sort de l'Egypte et limité le pouvoir du Vice-roi,
Méhémet-Ali laissa tomber une à une toutes les institutions qu'il
avait empruntées à la civilisation occidentale. C'est qu'il n'avait
jamais aimé cette civilisation pour elle-même. L'avait-il jamais
adoptée en vue de changer le sort du peuple égyptien, ou
seulement pour favoriser ses desseins politiques? Enfin n'avait-
il pas de justes sujets de découragement? L'Angleterre, en se
déclarant contre l'Égypte, n'avait-elle pas déserté la cause de
la civilisation et n'en avait-elle pas frappé le véritable repré-
sentant en Orient?
Le successeur immédiat de Méhémet-Ali, son petit-fils
Abbas-Pacha, qui tint le sceptre de l'Égypte comme héritier
direct d'Ibrahim-Pacha, à qui cette succession devait d'abord
échoir, prit assez peu de sguci du bonheur des Egyptiens. Il
n'y avait en lui aucune étincelle de la noble ambition de son
prédécesseur, nulle trace de son génie; aussi ne montra-t-il
nul désir de favoriser le progrès et d'introduire des réformes.
Ce fut un vrai prince de l'ancien Orient. Défiant, sombre,
insoucieux des destinées du pays que Dieu avait confié à ses
soins, il aimait à se retirer dans le secret de ses palais et à
s'isoler au milieu de ses gardes pour vivre de cette vie des
despotes ombrageux et voluptueux de l'Orient, où le sang se
mêle à l'orgie. Le palais de Bar-el-Béda, qu'il a fait construire
sur la route de Suez, en plein désert! un palais sans eau, qui se
dresse dans la solitude comme le muet témoin d'une existence
inutile, souillée, et d'une mort tragique, frappe le voyageur à
la fois d'étonnement et d'une sorte de crainte. Et l'imagination
se représente cet édifice hanté par l'esprit inquiet et énervé de
Nous nous bornons aujourd'hui à donner à nos lec-
teurs le préambule par lequel s'ouvre l'ouvrage de
M. Merruau et une grande portion du premier chapitre.
Barthélémy SAINT-HILAIRE.
L'Europe occidentale attache un grand prix à l'intégrité de
l'Empire Ottoman. Elle vient de faire un effort suprême; elle
a prodigué ses trésors et son sang pour sauver cet empire,
1 attaqué par un puissant voisin. La cause si vaillamment dé-
fendue a pu trouver dans le principe les opinions partagées.
Aujourd'hui, en France et en Angleterre surtout, elle ne peut
plus être envisagée que sous un seul. et même aspect. Les
sacrifices qu'elle nous a imposés l'ont grandie, nous l'ont
rendue chère, et l'ont mise en quelque sorte au-dessus de
toute discussion; seulement il est bien entendu que l'Empire
Ottoman doit s'aider lui-même, et ce n'est que par une trans-
formation chaque jour plus complète qu'il se mettra en mesure
de maUriser ses destinées, sans avoir à faire de constants
appels à l'Europe.
Cette œuvre de transformation a été commencée heureuse-
ment depuis près d'un demi-siècle déjà; elle a été entreprise
à la fois au nord et au midi de l'Empire par deux hommes
dont les noms seront toujours honorés dans les annales de la
Turquie. L'un de ces hommes était le sultan Mahmoud, l'autre
le pacha d'Egypte Méhèmet-Ali. Quand ils prirent en main
simultanément la réforme des institutions de l'Orient, la Tur-
quie et l'Égypte étaient en pleine dissolution. Leurs efforts
n'ont pas été infructueux; on dirait que le vieil arbre veut
reverdir. Il y a certainement beaucoup à faire encore pour
lui rendre la vigueur, il renferme toujours bien des éléments
de corruption et de mort; mais les héritiers de Mahmoud et
de Méhémet-Ali paraissent comprendre l'étendue de la tâche
qui leur est confiée : ils semblent décidés à poursuivre l'œuvre
réformatrice, et l'Europe ne saurait leur refuser ni ses encou-
ragements ni ses éloges.
Un récent séjour en Egypte nous a permis d'étudier un des
aspects de la réforme orientale, celui auquel est attaché le
nom de Méhémet-Ali, et dont l'Europe ne s'est peut-être pas
assez préoccupée depuis la mort de ce prince. Nous voudrions
montrer ce que trois années d'un bon gouvernement peuvent
faire pour la prospérité d'un pays obligé à la fois de réformer
ses mœurs et ses institutions. La question mériterait à tous
égards d'être examinée, quand même nous n'aurions pas à
signaler là un des éléments du grand problème de la transfor-
mation de la Turquie.
Chaque jour nous voyons grandir l'intérêt qui s'attache à
la stabilité et à la prospérité de l'Égypte. Ce n'est pas seule-
ment un intérêt politique, c'est quelque chose de plus intime,
de plus individuel. En effet, des négociants, des industriels,
des hommes exerçant des professions libérales ne cessent de
porter leurs capitaux, leur activité, leur expérience dans
cette belle vallée du Nil, l'une des plus fertiles du monde.
Par suite il existe de tels liens entre nous et cette partie de
l'Orient, que sa prospérité est la nôtre, comme sa ruine ou
son seul dépérissement serait une calamité pour nous.
Il est donc satisfaisant de savoir que les destinées de l'Egypte
sont confiées à un prince animé des intentions les plus libé-
rales et qui, en trois années de règne, a prouvé, par les actes
les plus éclatants, sa ferme résolution de développer, non-
seulement les ressources matérielles du pays, mais encore le
génie particulier et le bonheur de son peuple.
La réforme égyptienne a dû embrasser trois ordres de faits:
l'administration d'abord, puis le système de la propriété,
enfin le développement de la vie intellectuelle et des forces
productrices du pays. C'est dans cette triple direction aussi
que se sont portées les recherches dont se grouperont ici les
principaux résultats.
CHAPITRE 1.
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE.
Le hatti-schérif de 1841, qui assurait à Méhémet-Ali et à
ses descendants le gouvernement héréditaire de l'Egypte, a
détaché de ce gouvernement les provinces conquises par les
armes du chef de la famille, c'est-à-dire l'Arabie et la Syrie.
L'Egypte proprement dite forme la totalité de l'apanage que
les puissances, après le traité de 1840, ont réservé à la famille
du Vice-roi, sous la souveraineté de la Porte. Toutefois, le
même hatti-schérif y a joint les provinces de l'intérieur : la
Nubie, le Kordofan, le Sennaar, et autres territoires situés
aux environs du point de jpnction du Nil bleu et du Nil blanc
avec le fleuve qui traverse l'Egypte et qui la féconde. Tel est
le territoire sur lequel s'étend aujourd'hui l'autorité du Pacha
d'Egypte, et que, dans les dernières années de son règne,
Méhémet-Ali divisa en soixante-quatre départements, sans
comprendre les provinces du Soudan, et abstraction faite du
Caire, de Damiette et de Rosette, qui devaient être administrés.
à part.
La vie d'un monarque est bien courte, surtout quand il
s'agit de fonder un empire. Méhémet-Ali n'eût-il fait cepen-
dant que conquérir l'hérédité pour ses descendants, c'eût été
déjà beaucoup, car il assurait ainsi à l'Egypte la contyiuité
d'un gouvernement qui est identifié à ses destinées, et qui ne
peut manquer de prendre intérêt à sa prospérité. Autre chose
est une sorte de souveraineté héréditaire, autre chose une
succession de gouverneurs qui ne songent qu'à leur intérêt
personnel pendant leur court passage à la tête de l'administra-
tion d'un pays. L'Egypte, plus qu'aucun autre peut-être, sait
ce que vaut le gouvernement des proconsuls.
Malheureusement, une fois l'hérédité obtenue, Méhémet-
Ali crut sa tâche accomplie. Dès que les traités de 1841 eurent
décidé du sort de l'Egypte et limité le pouvoir du Vice-roi,
Méhémet-Ali laissa tomber une à une toutes les institutions qu'il
avait empruntées à la civilisation occidentale. C'est qu'il n'avait
jamais aimé cette civilisation pour elle-même. L'avait-il jamais
adoptée en vue de changer le sort du peuple égyptien, ou
seulement pour favoriser ses desseins politiques? Enfin n'avait-
il pas de justes sujets de découragement? L'Angleterre, en se
déclarant contre l'Égypte, n'avait-elle pas déserté la cause de
la civilisation et n'en avait-elle pas frappé le véritable repré-
sentant en Orient?
Le successeur immédiat de Méhémet-Ali, son petit-fils
Abbas-Pacha, qui tint le sceptre de l'Égypte comme héritier
direct d'Ibrahim-Pacha, à qui cette succession devait d'abord
échoir, prit assez peu de sguci du bonheur des Egyptiens. Il
n'y avait en lui aucune étincelle de la noble ambition de son
prédécesseur, nulle trace de son génie; aussi ne montra-t-il
nul désir de favoriser le progrès et d'introduire des réformes.
Ce fut un vrai prince de l'ancien Orient. Défiant, sombre,
insoucieux des destinées du pays que Dieu avait confié à ses
soins, il aimait à se retirer dans le secret de ses palais et à
s'isoler au milieu de ses gardes pour vivre de cette vie des
despotes ombrageux et voluptueux de l'Orient, où le sang se
mêle à l'orgie. Le palais de Bar-el-Béda, qu'il a fait construire
sur la route de Suez, en plein désert! un palais sans eau, qui se
dresse dans la solitude comme le muet témoin d'une existence
inutile, souillée, et d'une mort tragique, frappe le voyageur à
la fois d'étonnement et d'une sorte de crainte. Et l'imagination
se représente cet édifice hanté par l'esprit inquiet et énervé de
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Collections numériques similaires Thématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure Corpus : canaux, écluses, navigation intérieure /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp11" Corpus : ports et travaux maritimes Corpus : ports et travaux maritimes /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp16"
- Auteurs similaires Desplaces Ernest Desplaces Ernest /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Desplaces Ernest" or dc.contributor adj "Desplaces Ernest")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 22/24
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k6203085q/f22.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k6203085q/f22.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k6203085q/f22.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k6203085q
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k6203085q
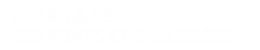


Facebook
Twitter