Titre : Nouvelles annales de la construction : publication rapide et économique des documents les plus récents et les plus intéressants relatifs à la construction française et étrangère... / C.-A. Oppermann
Titre : New annals of the construction
Titre : Neue Annalen der Baukunst
Éditeur : V. Dalmont (Paris)
Éditeur : V. DalmontV. Dalmont (Paris)
Éditeur : DunodDunod (Paris)
Éditeur : J. BaudryJ. Baudry (Paris)
Éditeur : C. BérangerC. Béranger (Paris)
Date d'édition : 1858-11-01
Contributeur : Oppermann, Charles Alfred (18..-18.. ; ingénieur des Ponts et chaussées). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32826369p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5529 Nombre total de vues : 5529
Description : 01 novembre 1858 01 novembre 1858
Description : 1858/11/01 (T4,N11)-1858/11/30. 1858/11/01 (T4,N11)-1858/11/30.
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5665781h
Source : Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, V-3528
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/11/2010
loi
NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. — NOVEMBRE 1858.
152
rénées-Orientales, autrefois province de Roussillon, M. JAUBERT DE
PASSA, mentionne dans son mémoire sur les canaux d'arrosage de ce
département plus de 80 ruisseaux ou petits canaux qui ont leurs prin-
cipales dérivations dans les rivières du Tech, de la Tezt et de l'Agi y. Le
ruisseau du Vernet, celui d'Els Molissont dérivés du Tech, rivière d'un
volume assez abondant et régulier. Le ruisseau de las Ganals -, ou de
Perpignan, est dérivé de la Tech; il a 4 mètres de largeur moyenne,
30 kilomètres de longueur, et des pentes très-fortes, de 2 à 4 mètres
par-kilomètre; on peut compter sur un volume de 2m.62 par seconde,
arrosant 2,800 hectares^ mais dans les sécheresses, l'irrigation est en
-souffrance, et les arrosants ont de fréquentes contestations avec l'au-
torité militaire de Perpignan. Ce canal présente plusieurs ouvrages
d'art considérables, entre autres deux ponts-aqueducs et deux souter-
rains. Malgré le grand nombre de.petits canaux, M. NADAULT DE
-BUFFON ne pense pas qu'on doive porter à plus de 12,590 hectares la
surface arrosée par les canaux anciens, dont nous venons de nous
occuper. ■ .
Parmi les nouveaux canaux de l'ancien Roussillon, on peut signaler
le canal de Fouriniguières, d'une portée de lm.10, exécuté au moyen
d'une association de propriétaires autorisée par une ordonnance du
9 janvier 1840, et le canal de Foupédronne, qui dépend d'une associa-
tion analogue, et qui a une assez faible portée; les entreprises récentes
•ne comprennent en tout que quelques centaines d'hectares.
-CANAUX DES HAUTES ET BASSES-PYRÉNÉES. — Dans les Hautes et
'Basses-Pyrénées, M, NADAULT DE BUFFON évalue l'irrigation à 8,546
•hectares,; savoir v 3,000 pour les,Basses-Pyrénées j et 5,546 pour les
■Hautes-Pyrénées, une dérivation de l'Adour sur la rive droite, à 4 kilo-
mètres en aval de Bagnerre-de-Bigorre ; sa portée ordinaire est d'en-
viron 3 mètres-, et il arrose 2,200 hectares. Le canal-de la Gepse, situé
entre Baguerre etïarbes, sur la rive gauche de l'Adour, arrose environ
4,400 hectares; enfin les deux canaux de Tarbes font mouvoir des
mines et irriguent environ 1,946 hectares.
On travaille en ce moment, dans les Hautes-Pyrénées, à un canal de
dérivation de la Neste, qui peut intéresser le département de la Haute-
Garonne; nous n'avons pas à cet égard de renseignements bien précis;
mais il paraît que le volume d'eau serait de -7 mètres par seconde, et
se prendrait au moyen d'un barrage dans la Neste, à quelques kilomè-
tres au-dessus de la -Bar-the. Une certaine portion de ce canal est déjà
exécutée, mais le barrage n'est pas encore terminé.
Quoique, ainsi que nous le disons, la pénurie d'eau ne soit généra-
lement pas à craindre,-la Garonne, recevant les eaux de la Neste, peut
se trouver appauvrie en temps d'étiage, au moyen de cette prise d'eau.
Cependant, dans le projet de M. MONTET, dont celui-ci est à la fois un .
démembrement et une modification, il était bien entendu que le débit
de la Neste à l'étiage devait être maintenu dans toute circonstance, et
que les eaux de dérivaiiou du côté des Hautes-Pyrénées seraient alors
empruntées à des réservoirs construits dans les montagnes. Nous ne
saurions dire si les intérêts du département de la Haute-Garonne sont
entièrement sauvegardés.
CANAUX DE LA HAUTE-GARONNE. — Ce Département n'est pas plus
pauvre que les autres en petites dérivations pour arroser les prairies;
nous avons déjà dit que du côté des montagnes, l'irrigation était gé-
néralement pratiquée. -
Dans la plaine de Saint-Gaudens jusqu'à Saint-Martory, il y a un
assez grand nombre de petits canaux, parmi lesquels nous pouvons
citer ceux de Sainte-Arroiuans, de M. MARTIN-LACOSTE , des minés
de Valentin, du Prince de Bergues, etc. Mais, en général, ils sont
très-peu de portée et ne peuvent arroser qu'un très-petit nombre
d'hectares de prairies. Il serait bien facile cependant d'arroser la
plaine entre Valentine et la Broquère, au moyen d'un canal dérivé de
la Garonne.
CANAL DU BAZER. — M. MARE DE MONTRÉJEAN eut l'idée d'ouvrir, à
ses frais, le canal dont nous venons de parler, et, après enquête et for-
malités d'usage, il y fut autorisé par une Ordonnance de janvier 1843,
Le canal pouvait avoir une portée de 2 mètres cubes à 2mc.50, en
dehors des temps de bas étiage, où il était réduit à 1 mètre cube; sa
longueur principale était de 22 kilomètres, à ses deux embranchements
de 18 kilomètres; le maximum du prix d'arrosage avait été fixé à
31f. 50 l'hectare, et la dépense totale.évaluée à 320,000 fr. Cette
entreprise était parfaitement accueillie par le pays; lés deux communes
de Marlre et de la Barthe avaient souscrit pour 20,000 fr., et les pro-
priétaires auraient largement utilisé les eaux; malheureusement, le
concessionnaire ne semble pas avoir eu une capacité à ]a hauteur de
son dévouement, les ressources surlout lui manquèrent; la première
année de sa concession, il dépensa 60,000 fr., et en resta là. Les six ans
accordés pour l'exécution des travaux étant expirés en 1849, il demanda
et obtint, nous le croyons, une prolongation de temps; mais, étant
mort sur ces entrelaites, les choses sont toujours dans le même
état, ce qui est très-fâcheux, parce que le pays tirerait un grand
avantage de l'exécution du canal. Pour arriver au but final, les pro-
priétaires pouvaient s'associer comme ont fait ceux d'Estelle, petite
commune près de Saint-Martory, qui sont aujourd'hui dans l'attente
d'un décret d'organisation pour l'établissement d'un syndicat qui exé-
cuterait un canal d'irrigation empruntant environ 0mo.50 aux eaux
de la Garonne.
SUPERFICIE ARROSÉE SUR LE. VERSANT DES ALPES ET DES PYRÉNÉES. —
En additionnant les surfaces arrosées sur le versant français des Py-
rénées, on doit trouver un total de 25,000 hectares environ, qui ajoutés
aux 80,000 dont nous avons parlé au sujet des Alpes, donnent une su-
perficie déplus 10,000 hectares qui sont arrosés, ou du moins peuvent
l'être chaque année; si ces arrosages ne s'appliquaient pas générale-
ment, soit d'une manière spéciale aux prairies, soit à la petite culture,
ils devraient se rapporter à une surface arrosable d'une étendue plus
considérable, le triple environ. Pour les causes que nous venons d'an-
noncer, cette proportion n'est pas atteinte, mais il faut néanmoins sous-
entendre que la surface pouvant être arrosée est supérieure à 10,000
hectares.
MAITROT DE VARENNE.
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
EXPERIENCES ET APPLICATIONS NOUVELLES.
Application du siphon à. l'élévation des eaux.
Employer la chute d'eau d'un siphon à élever à une hauteur plu-
sieurs fois égale à elle-même une quantité d'eau qui soit la fraction
la plus grande possible : du débit du siphon, tel est le problème ingé-
nieux que s'est posé M. BARBELOT, chef de section au chemin de fer
de Lyon à la Méditerranée, et dont il perfectionue ence moment la
solution pratique.
On comprend en effet qu'il y ait, dans la chute d'eau d'un siphon
dont les deux orifices sont à une différence de hauteur assez grande
l'un de l'autre, un moyen d'alimenter, par une aspiration intermittente,
un réservoir situé a la partie supérieure, vers le coude du tube.
Il suffit, en effet, lorsque le siphon est rempli, de le boucher à ses
deux extrémités inférieures, et d'ouvrir un orifice à sa partie supé-
rieure, au moyen duquel on recueille une portion d'eau qui est
remplacée par de l'air, mais pas en trop grande quantité pour qu'en
renfermant ensuite le robinet supérieur et rouvrant les orifices inférieurs,
le siphon ne puisse aspirer de nouveau l'eau dans la parlie vide, et l'air
redescendre par la plus longue branche pour recommencer l'opéra-
tion.
Un calcul très simple permet de déterminer le maximum d'eau
qu'on puisse retirer du sommet d'un siphon sans interrompre sa cir-
culation, une fois que l'orifice supérieur est refermé.
On ne peut naturellement appliquer ce procédé par un seul siphon
à des hauteurs supérieures à 10 mètres (limite d'action d'un siphon à
eau ), mais une hauteur moindre suffit en général pour les applications
agricoles que l'auteur paraît surtout avoir eues en vue. D'ailleurs, s'il le
fallait, on pourrait encore, avec plusieurs siphons superposés ', faire
franchir une hauteur quelconque à une quaniité d'eau qui serait en
raison directe du débit du siphon et de sa chute, et en raison inverse
de la hauteur à laquelle on voudrait monter.
M. BARBELOT s'occupe en ce moment de rendre l'appareil automo-
teur, c'est-à-dire de lui permettre de manoeuvrer ses robinets lui-
même.
Il suffirait alors de produire, dans un cours d'eau quelconque, par
un barrage ou un canal de dérivation , une chute assez faible, pour
faire monter le liquide à une hauteur beaucoup plus grande, et lui
permettre ainsi de se répandre sur des terrains auxquels il n'aurait pu
accéder naturellement en suivant les courbes de niveau.
C.-A. OPPERMAiNN, DIRECTEUR,
11, rue des Beaux-Arts, à Paris.
Paris. — Imprimé par E. THUNOT et C°, rué Racine, 46.
NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. — NOVEMBRE 1858.
152
rénées-Orientales, autrefois province de Roussillon, M. JAUBERT DE
PASSA, mentionne dans son mémoire sur les canaux d'arrosage de ce
département plus de 80 ruisseaux ou petits canaux qui ont leurs prin-
cipales dérivations dans les rivières du Tech, de la Tezt et de l'Agi y. Le
ruisseau du Vernet, celui d'Els Molissont dérivés du Tech, rivière d'un
volume assez abondant et régulier. Le ruisseau de las Ganals -, ou de
Perpignan, est dérivé de la Tech; il a 4 mètres de largeur moyenne,
30 kilomètres de longueur, et des pentes très-fortes, de 2 à 4 mètres
par-kilomètre; on peut compter sur un volume de 2m.62 par seconde,
arrosant 2,800 hectares^ mais dans les sécheresses, l'irrigation est en
-souffrance, et les arrosants ont de fréquentes contestations avec l'au-
torité militaire de Perpignan. Ce canal présente plusieurs ouvrages
d'art considérables, entre autres deux ponts-aqueducs et deux souter-
rains. Malgré le grand nombre de.petits canaux, M. NADAULT DE
-BUFFON ne pense pas qu'on doive porter à plus de 12,590 hectares la
surface arrosée par les canaux anciens, dont nous venons de nous
occuper. ■ .
Parmi les nouveaux canaux de l'ancien Roussillon, on peut signaler
le canal de Fouriniguières, d'une portée de lm.10, exécuté au moyen
d'une association de propriétaires autorisée par une ordonnance du
9 janvier 1840, et le canal de Foupédronne, qui dépend d'une associa-
tion analogue, et qui a une assez faible portée; les entreprises récentes
•ne comprennent en tout que quelques centaines d'hectares.
-CANAUX DES HAUTES ET BASSES-PYRÉNÉES. — Dans les Hautes et
'Basses-Pyrénées, M, NADAULT DE BUFFON évalue l'irrigation à 8,546
•hectares,; savoir v 3,000 pour les,Basses-Pyrénées j et 5,546 pour les
■Hautes-Pyrénées, une dérivation de l'Adour sur la rive droite, à 4 kilo-
mètres en aval de Bagnerre-de-Bigorre ; sa portée ordinaire est d'en-
viron 3 mètres-, et il arrose 2,200 hectares. Le canal-de la Gepse, situé
entre Baguerre etïarbes, sur la rive gauche de l'Adour, arrose environ
4,400 hectares; enfin les deux canaux de Tarbes font mouvoir des
mines et irriguent environ 1,946 hectares.
On travaille en ce moment, dans les Hautes-Pyrénées, à un canal de
dérivation de la Neste, qui peut intéresser le département de la Haute-
Garonne; nous n'avons pas à cet égard de renseignements bien précis;
mais il paraît que le volume d'eau serait de -7 mètres par seconde, et
se prendrait au moyen d'un barrage dans la Neste, à quelques kilomè-
tres au-dessus de la -Bar-the. Une certaine portion de ce canal est déjà
exécutée, mais le barrage n'est pas encore terminé.
Quoique, ainsi que nous le disons, la pénurie d'eau ne soit généra-
lement pas à craindre,-la Garonne, recevant les eaux de la Neste, peut
se trouver appauvrie en temps d'étiage, au moyen de cette prise d'eau.
Cependant, dans le projet de M. MONTET, dont celui-ci est à la fois un .
démembrement et une modification, il était bien entendu que le débit
de la Neste à l'étiage devait être maintenu dans toute circonstance, et
que les eaux de dérivaiiou du côté des Hautes-Pyrénées seraient alors
empruntées à des réservoirs construits dans les montagnes. Nous ne
saurions dire si les intérêts du département de la Haute-Garonne sont
entièrement sauvegardés.
CANAUX DE LA HAUTE-GARONNE. — Ce Département n'est pas plus
pauvre que les autres en petites dérivations pour arroser les prairies;
nous avons déjà dit que du côté des montagnes, l'irrigation était gé-
néralement pratiquée. -
Dans la plaine de Saint-Gaudens jusqu'à Saint-Martory, il y a un
assez grand nombre de petits canaux, parmi lesquels nous pouvons
citer ceux de Sainte-Arroiuans, de M. MARTIN-LACOSTE , des minés
de Valentin, du Prince de Bergues, etc. Mais, en général, ils sont
très-peu de portée et ne peuvent arroser qu'un très-petit nombre
d'hectares de prairies. Il serait bien facile cependant d'arroser la
plaine entre Valentine et la Broquère, au moyen d'un canal dérivé de
la Garonne.
CANAL DU BAZER. — M. MARE DE MONTRÉJEAN eut l'idée d'ouvrir, à
ses frais, le canal dont nous venons de parler, et, après enquête et for-
malités d'usage, il y fut autorisé par une Ordonnance de janvier 1843,
Le canal pouvait avoir une portée de 2 mètres cubes à 2mc.50, en
dehors des temps de bas étiage, où il était réduit à 1 mètre cube; sa
longueur principale était de 22 kilomètres, à ses deux embranchements
de 18 kilomètres; le maximum du prix d'arrosage avait été fixé à
31f. 50 l'hectare, et la dépense totale.évaluée à 320,000 fr. Cette
entreprise était parfaitement accueillie par le pays; lés deux communes
de Marlre et de la Barthe avaient souscrit pour 20,000 fr., et les pro-
priétaires auraient largement utilisé les eaux; malheureusement, le
concessionnaire ne semble pas avoir eu une capacité à ]a hauteur de
son dévouement, les ressources surlout lui manquèrent; la première
année de sa concession, il dépensa 60,000 fr., et en resta là. Les six ans
accordés pour l'exécution des travaux étant expirés en 1849, il demanda
et obtint, nous le croyons, une prolongation de temps; mais, étant
mort sur ces entrelaites, les choses sont toujours dans le même
état, ce qui est très-fâcheux, parce que le pays tirerait un grand
avantage de l'exécution du canal. Pour arriver au but final, les pro-
priétaires pouvaient s'associer comme ont fait ceux d'Estelle, petite
commune près de Saint-Martory, qui sont aujourd'hui dans l'attente
d'un décret d'organisation pour l'établissement d'un syndicat qui exé-
cuterait un canal d'irrigation empruntant environ 0mo.50 aux eaux
de la Garonne.
SUPERFICIE ARROSÉE SUR LE. VERSANT DES ALPES ET DES PYRÉNÉES. —
En additionnant les surfaces arrosées sur le versant français des Py-
rénées, on doit trouver un total de 25,000 hectares environ, qui ajoutés
aux 80,000 dont nous avons parlé au sujet des Alpes, donnent une su-
perficie déplus 10,000 hectares qui sont arrosés, ou du moins peuvent
l'être chaque année; si ces arrosages ne s'appliquaient pas générale-
ment, soit d'une manière spéciale aux prairies, soit à la petite culture,
ils devraient se rapporter à une surface arrosable d'une étendue plus
considérable, le triple environ. Pour les causes que nous venons d'an-
noncer, cette proportion n'est pas atteinte, mais il faut néanmoins sous-
entendre que la surface pouvant être arrosée est supérieure à 10,000
hectares.
MAITROT DE VARENNE.
Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
EXPERIENCES ET APPLICATIONS NOUVELLES.
Application du siphon à. l'élévation des eaux.
Employer la chute d'eau d'un siphon à élever à une hauteur plu-
sieurs fois égale à elle-même une quantité d'eau qui soit la fraction
la plus grande possible : du débit du siphon, tel est le problème ingé-
nieux que s'est posé M. BARBELOT, chef de section au chemin de fer
de Lyon à la Méditerranée, et dont il perfectionue ence moment la
solution pratique.
On comprend en effet qu'il y ait, dans la chute d'eau d'un siphon
dont les deux orifices sont à une différence de hauteur assez grande
l'un de l'autre, un moyen d'alimenter, par une aspiration intermittente,
un réservoir situé a la partie supérieure, vers le coude du tube.
Il suffit, en effet, lorsque le siphon est rempli, de le boucher à ses
deux extrémités inférieures, et d'ouvrir un orifice à sa partie supé-
rieure, au moyen duquel on recueille une portion d'eau qui est
remplacée par de l'air, mais pas en trop grande quantité pour qu'en
renfermant ensuite le robinet supérieur et rouvrant les orifices inférieurs,
le siphon ne puisse aspirer de nouveau l'eau dans la parlie vide, et l'air
redescendre par la plus longue branche pour recommencer l'opéra-
tion.
Un calcul très simple permet de déterminer le maximum d'eau
qu'on puisse retirer du sommet d'un siphon sans interrompre sa cir-
culation, une fois que l'orifice supérieur est refermé.
On ne peut naturellement appliquer ce procédé par un seul siphon
à des hauteurs supérieures à 10 mètres (limite d'action d'un siphon à
eau ), mais une hauteur moindre suffit en général pour les applications
agricoles que l'auteur paraît surtout avoir eues en vue. D'ailleurs, s'il le
fallait, on pourrait encore, avec plusieurs siphons superposés ', faire
franchir une hauteur quelconque à une quaniité d'eau qui serait en
raison directe du débit du siphon et de sa chute, et en raison inverse
de la hauteur à laquelle on voudrait monter.
M. BARBELOT s'occupe en ce moment de rendre l'appareil automo-
teur, c'est-à-dire de lui permettre de manoeuvrer ses robinets lui-
même.
Il suffirait alors de produire, dans un cours d'eau quelconque, par
un barrage ou un canal de dérivation , une chute assez faible, pour
faire monter le liquide à une hauteur beaucoup plus grande, et lui
permettre ainsi de se répandre sur des terrains auxquels il n'aurait pu
accéder naturellement en suivant les courbes de niveau.
C.-A. OPPERMAiNN, DIRECTEUR,
11, rue des Beaux-Arts, à Paris.
Paris. — Imprimé par E. THUNOT et C°, rué Racine, 46.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 91.08%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 91.08%.
- Collections numériques similaires Corpus : Art de l'ingénieur Corpus : Art de l'ingénieur /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp15"Cosmos (1852) /ark:/12148/bd6t51143731d.highres Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences, les arts et les manufactures, tant en France que dans les pays étrangers pendant l'année ... : avec l'indication succincte des principaux produits de l'industrie française ; la liste des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, accordés par le gouvernement pendant la même année, et des notices sur les prix proposés ou décernés par différentes sociétés savantes, françaises et étrangères, pour l'encouragement des sciences et des arts /ark:/12148/bd6t53887780b.highresThématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"
- Auteurs similaires Oppermann Charles Alfred Oppermann Charles Alfred /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Oppermann Charles Alfred" or dc.contributor adj "Oppermann Charles Alfred")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 8/8
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k5665781h/f8.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k5665781h/f8.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k5665781h/f8.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k5665781h
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k5665781h
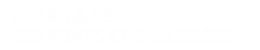


Facebook
Twitter