Titre : Nouvelles annales de la construction : publication rapide et économique des documents les plus récents et les plus intéressants relatifs à la construction française et étrangère... / C.-A. Oppermann
Titre : New annals of the construction
Titre : Neue Annalen der Baukunst
Éditeur : V. Dalmont (Paris)
Éditeur : V. DalmontV. Dalmont (Paris)
Éditeur : DunodDunod (Paris)
Éditeur : J. BaudryJ. Baudry (Paris)
Éditeur : C. BérangerC. Béranger (Paris)
Date d'édition : 1858-08-01
Contributeur : Oppermann, Charles Alfred (18..-18.. ; ingénieur des Ponts et chaussées). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32826369p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5529 Nombre total de vues : 5529
Description : 01 août 1858 01 août 1858
Description : 1858/08/01 (T4,N8)-1858/08/31. 1858/08/01 (T4,N8)-1858/08/31.
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k56657781
Source : Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, V-3528
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/11/2010
103
NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. — AOUT 1858.
104
adopté par les ingénieurs du Rhône et que nous croyons convenable (1 ).
Nous avons ainsi obtenu :
Le 18 février 1854, l'échelle marquant lm.iO, un débit de 70 mètres cubes.
Le 28 janvier 1854, — lm.20, — 83 —
Le 6 mars 1854, — im.30, — 100 —
Ce dernier chiffre de 100 mètres cubes concorde avec les jaugeages
que nous avons faits de la même manière, le 3 mars 1854, de la Ga-
ronne à Saint-Marlory, et le lendemain, 4 mars, de l'Ariége à Cintega-
belle, immédiatement en aval du Grand-Lhers : la Garonne débitait
40 mètres cubes à Saint-Martory, et l'Ariége 34 mètres cubes à Cinte-
gabelle; or le Salât, dont le débit, d'après des jaugeages antérieurs,
est à celui de la Garonne dans le rapport de 12 à 28, devait écouler
4T) x H —17 mètres cubes; la Rize observée donnait environ imètres
cubes, d'où il devait rester 3 mètres cubes pour les autres cours d'eau,
ce qui représente assez bien, quoiqu'un peu facilement, la situation des
choses.
Comme nous ne pouvions conserver d'échelle en rivière vis-à-vis le
ramier de Blagnac, où nous avons installé une échelle sur la culée gau-
che du pont, cet emplacement était commode pour les jaugeages, et
le lit se trouvait tellement régulier aux abords, en aval surtout, que
l'eau se trouvant au zéro de notre échelle ou à l'affleurement des
pieux d'enceinte de la culée de la rive gauche ; on avait sous le pont
une section de 318oeq-.20, tandis qu'en aval à 68m.20 on obtenait
306mq-.20; c'est là que nous avons fait plusieurs jaugeages, et que nous
avons observé la crue du 3 juin 1855.
Nous donnons ici quelques-uns 4es résultats obtenus à des dates et
des hauteurs différentes:
DATE DÉB]T HAUTEUR D'EAtI
DE JAUGEAGE. A L'ÉCHELLE DE L'EMBOUCHURE,
m.c. I
1" octobre 1855 200 1.65 j
„.„„,.,. „„„ / Entre notre échelle et celle de
9-mai 1855 200 1.85 t „ ,
) 1 embouchure, il y avait une dif-
13 mai 1855 . 220 2.65 l férence constante de 1.87 à 1.90.
2'juin 1855. 1.660 4.40 '
La dernière observation a été faite au flotteur.
MODULE- DE LA GARONNE. —Le débit moyen par seconde de la Ga-
ronne à Toulouse, débit qu'on appelle module, s'obtient en divisant le
débit moyen annuel ou 7,598 millions de mètres cubes par le nombre de
secondes contenues dans une année ou 31,536,000, ce qui donne
2-^0 mètres cubes. M. BAUMGARTEN obtient pour débit moyen de la
Garonne, en aval du Lot, de 20,816 millions de mètres cubes, ce qui
correspond à une module de 659m- c-.70. Le rapport entre ces deux mo-
dules étant 0.36, tandis que celui entre les bassins est 0.20, on voit
de suite l'influence qui résulte d'une proportion plus ou moins grande
de plaine ou de montagne dans la totalité d'un bassin (2).
Parmi les débits calculés ci-dessus, les deux plus forts sont ceux de
1810 et de 1853, donnant 9,071 et 9,084 millions de mètres cubes,
tandis que le plus faible est celui de 1854, correspondant à 5,956 mil-
lions de mètres cubes. Les deux années exceptionnelles, sous le rap-
(1) M. BAUMGARTEN adopte le coefficient 0Tn.842; les ingénieurs allemands 0».90, et
M. DEFONTAIN-E, sur le Rhin, O^.SS.
(2) Le débit moyen du Pô, est de 1,720 mètres cubes donnant 186 mètres cubes au
plus bas étiage, et 5,156 lors des grandes crues; son débit annuel est aussi de
64,242 millions de mètres cubes et correspond à un bassin de 69,382 kilom. quarrés,
dont 28,226 en plaine et 41,056 en montagne; la-couche d'eau sur le bassin, repré-
sentée par le débit, serait de 0.78 ou les 3/4- de la pluie qui tombe à Milan et qui est
de 1.05.
Le débit moyen de l'Aida est 184 mètres cubes correspondant à un débit annuel de
5,S14 millions de mètres cubes, pour un bassin de 4,486 kilom. quarrés presque tout
en montagne; la couche d'eau sur le bassin, d'après le débit, serait lm.295, c'est-à-
dire plus considérable que la pluie observée à Milan ; c'est ce qui est en rapport avec
la loi annoncée ci-dessous.
Le module de la Seine, à Paris, est de 249 mètres cubes et son débit annuel de
7,852 millions demètres cubes donnant lieu, pour un bassin de 44,375 kilom. quarrés,
à une couche d'eau de 0™.177 ou le 1/3 de la quantité tombée qui est de 0m.53 à
Paris.
La Saône, qui a pour bassin 30,600 kilom. quarrés, a débité annuellement en
moyenne à Trévoux pour les années 1844—45—46, 15,666 millions de mètres cubes,
se rapportant à une quantité moyenne d'eau tombée de 27,333 millions de mètres
cubes ; ainsi, le débit aurait été les 0".55 de la pluie et le module de 496 mètres
cubes ; mais, appliqué généralement, ce module serait probablement trop fort à cause
des années pluvieuses qui ont servi aux observations.
Le Rhône, près de son embouchure qui a pour bassin 97,750 kilom. quarrés, dé-
bite environ 2,000 mètres cubes en moyenne; le Nil, 2,850; le Rhin à Bâte, d'après
M. DEFOSTAINE, 941 mètres cubes et 1,643 mètres cubes, à Emmerick avant son entrée
en Hollande,
port du plus fort et du plus faible débit, nous paraissent être, pour le
premier cas, 1845, et pour le second, 1832. Nous avons trouvé, pour
1845 un débit de 11,250 millions de mètres cubes, dont le module est
357 mètres cubes, et pour 1832 un débit de 5,150 millions de mètres
cubes, dont le module est 163mo-.30 pour les mêmes années. M. BAUM-
GARTEN a trouvé, savoir : en 1845, 31,334 millions de mètres cubes,
donnant pour modules 993 mètres cubes, et pour 1832, 8,373 millions
de mètres cubes et un module de 565 mètres cubes.
Si l'on examine les quantités d'eau tombées à Toulouse, on trouve,
pour 1845, une hauteur de 0m.81 et une de 0,n.52 pour 1832; en 1854,
les pluies n'ont pas dépassé cette dernière hauteur, et même il est des
années, comme 1840, où le chiffre 0m.50 n'a pas été atteint et où le
débit de la Garonne n'est cependant pas descendu bien bas; cela tient,
d'abord à ce que la quantité de pluie tombée à Toulouse ne correspond
pas toujours, mais proportionnellement, à celle tombée sur le reste du
bassin, et ensuite à ce que le réservoir des montagnes est alimenté par
les pluies qui tombent depuis novembre jusqu'en juillet, et principale-
ment par celles générales qui ont lieu dans le mois de mai ou commen-
cement de juin. On peut remarquer, en effet, qu'en 1832, les pluies
tombées depuis novembre 1831 jusqu'en juillet suivant, représentent une
hauteur de 30Cimt-.76, tandis qu'en 1854 elles s'élevaient à 34cent\97,
en 1840 à 35C6n\60, et enfin, en 1845, à 58cent-.58, Toutes les années
signalées par de grandes crues printanières dans la Garonne corres-
pondent à des débits très-forts, et il n'y a pas de bas étiage ou il n'y en
a que très-tard; cela tient probablement à ce que lorsque la pluie est
générale, la distribution entre les montagnes et les plaines présente UB
rapport plus considérable que celui établi plus haut sur l'ensemble, et
qu'une partie notable reste sur les montagnes à l'état de neige pour
fondre au fur et à mesure que la température augmente, fusion qui est
en rapport avec la hauteur de ces mêmes montagnes (1).
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
Note sur le passage do Ltbrou par les systèmes MAGUÈS et
SERRIN.—Brochure in-8°de 8 pages avec une planche, par M. TEIL-
LEAD, ingénieur civil. Chez l'auteur, 48, Faubourg Saint-Denis, à Paris.
On a pu voir, à l'Exposition universelle de 1855 , un modèle repré-
sentant une série de petits aqueducs roulants en tôle , destinés à inter-
cepter et à rouvrir alternativement le passage à niveau du torrent du
Libron à travers le canal du Midi.
Ce système, projeté et exécuté en ce moment même par M.. l'Ingé-
nieur en chef MAGUÈS , est mis en parallèle par l'auteur de la brochure
avec une autre combinaison, consistant en deux aqueducs flottants, à
pivot latéral, pouvant se replier dans une chambre spéciale ménagée
dans la maçonnerie du canal.
M. SERRIN, auteur de ce dernier système, s'est proposé surtout de
simplifier le mécanisme et la manoeuvre des aqueducs, et de diminuer
les chances d'ensablement que l'on doit craindre d'autant plus que le
nombre des points morts est plus grand et que les surfaces de frotte-
ment sont plus multipliées.
Il remplace un ensemble de quarante-huit pièces par deux pièces seu-
lement. Il a deux axes de rotation au lieu de quatre-vingt-seize, et
quatre joints de raccord au lieu de soixante.
M. TRiLLEAUémet un avis favorable au système SERRiN,et en propose,
l'adoption pour tous les cas où l'on voudra empêcher qu'un torrent
coupé à niveau par un canal, ne dépose dans ce dernierdes sables et des
graviers qui peuvent devenir un obstacle à la navigation ou au libre
écoulement des eaux.
On peut craindre toutefois dans le système Serrin les difficultés de
manoeuvre résultant des ensablements momentanés et des variations du
poids moyen des deux grands aqueducs flottants.
(1) M. GALLAUP, ingénieur des Ponts et Chaussées, chargé de l'arrondissement de
Saint-Girons, qui a étudié, il y a quelques années, un projet de passage de France en
Espagne par le col du Salan, a bien voulu nous adresser le résultat de trente années
d'observations sur la durée des neiges à diverses hauteurs. Les montagnes sur les-
quelles ces observations ont été faites sont situées sur le versant français des Pyré-
nées et exposées au nord-est (vallée duSallat, d'Aleth, de l'Arac, du"Garbet, départe-
ment de l'Ariége).
Les résultats moyens établissent que la neige reste un mois à 650 mètres de hauteur
au-dessus du niveau de la mer, 2 mois à 930 mètres, 3 mois à 1,170 mètres, 4 mois
à 1,370 mètres, 5 mois à 1,530 mètres, 6 mois à 1,650 mètres, 7 mois à 1,750 mètres,
8 mois à 1,830 mètres, 9 mois à 1,950 mètres, 10 mois à 2,090 mètres, 11.mois à
2,240 mètres et 12 mois (neiges éternelles) à 2,450 mètres.
C.-A. OPPERMAMN, DIRECTEUR,
11, rue des Beaux-Arts, à Paris.
Paris. — Imprimé par E. ÏUUKOT et C", rue Racine, 26.
NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. — AOUT 1858.
104
adopté par les ingénieurs du Rhône et que nous croyons convenable (1 ).
Nous avons ainsi obtenu :
Le 18 février 1854, l'échelle marquant lm.iO, un débit de 70 mètres cubes.
Le 28 janvier 1854, — lm.20, — 83 —
Le 6 mars 1854, — im.30, — 100 —
Ce dernier chiffre de 100 mètres cubes concorde avec les jaugeages
que nous avons faits de la même manière, le 3 mars 1854, de la Ga-
ronne à Saint-Marlory, et le lendemain, 4 mars, de l'Ariége à Cintega-
belle, immédiatement en aval du Grand-Lhers : la Garonne débitait
40 mètres cubes à Saint-Martory, et l'Ariége 34 mètres cubes à Cinte-
gabelle; or le Salât, dont le débit, d'après des jaugeages antérieurs,
est à celui de la Garonne dans le rapport de 12 à 28, devait écouler
4T) x H —17 mètres cubes; la Rize observée donnait environ imètres
cubes, d'où il devait rester 3 mètres cubes pour les autres cours d'eau,
ce qui représente assez bien, quoiqu'un peu facilement, la situation des
choses.
Comme nous ne pouvions conserver d'échelle en rivière vis-à-vis le
ramier de Blagnac, où nous avons installé une échelle sur la culée gau-
che du pont, cet emplacement était commode pour les jaugeages, et
le lit se trouvait tellement régulier aux abords, en aval surtout, que
l'eau se trouvant au zéro de notre échelle ou à l'affleurement des
pieux d'enceinte de la culée de la rive gauche ; on avait sous le pont
une section de 318oeq-.20, tandis qu'en aval à 68m.20 on obtenait
306mq-.20; c'est là que nous avons fait plusieurs jaugeages, et que nous
avons observé la crue du 3 juin 1855.
Nous donnons ici quelques-uns 4es résultats obtenus à des dates et
des hauteurs différentes:
DATE DÉB]T HAUTEUR D'EAtI
DE JAUGEAGE. A L'ÉCHELLE DE L'EMBOUCHURE,
m.c. I
1" octobre 1855 200 1.65 j
„.„„,.,. „„„ / Entre notre échelle et celle de
9-mai 1855 200 1.85 t „ ,
) 1 embouchure, il y avait une dif-
13 mai 1855 . 220 2.65 l férence constante de 1.87 à 1.90.
2'juin 1855. 1.660 4.40 '
La dernière observation a été faite au flotteur.
MODULE- DE LA GARONNE. —Le débit moyen par seconde de la Ga-
ronne à Toulouse, débit qu'on appelle module, s'obtient en divisant le
débit moyen annuel ou 7,598 millions de mètres cubes par le nombre de
secondes contenues dans une année ou 31,536,000, ce qui donne
2-^0 mètres cubes. M. BAUMGARTEN obtient pour débit moyen de la
Garonne, en aval du Lot, de 20,816 millions de mètres cubes, ce qui
correspond à une module de 659m- c-.70. Le rapport entre ces deux mo-
dules étant 0.36, tandis que celui entre les bassins est 0.20, on voit
de suite l'influence qui résulte d'une proportion plus ou moins grande
de plaine ou de montagne dans la totalité d'un bassin (2).
Parmi les débits calculés ci-dessus, les deux plus forts sont ceux de
1810 et de 1853, donnant 9,071 et 9,084 millions de mètres cubes,
tandis que le plus faible est celui de 1854, correspondant à 5,956 mil-
lions de mètres cubes. Les deux années exceptionnelles, sous le rap-
(1) M. BAUMGARTEN adopte le coefficient 0Tn.842; les ingénieurs allemands 0».90, et
M. DEFONTAIN-E, sur le Rhin, O^.SS.
(2) Le débit moyen du Pô, est de 1,720 mètres cubes donnant 186 mètres cubes au
plus bas étiage, et 5,156 lors des grandes crues; son débit annuel est aussi de
64,242 millions de mètres cubes et correspond à un bassin de 69,382 kilom. quarrés,
dont 28,226 en plaine et 41,056 en montagne; la-couche d'eau sur le bassin, repré-
sentée par le débit, serait de 0.78 ou les 3/4- de la pluie qui tombe à Milan et qui est
de 1.05.
Le débit moyen de l'Aida est 184 mètres cubes correspondant à un débit annuel de
5,S14 millions de mètres cubes, pour un bassin de 4,486 kilom. quarrés presque tout
en montagne; la couche d'eau sur le bassin, d'après le débit, serait lm.295, c'est-à-
dire plus considérable que la pluie observée à Milan ; c'est ce qui est en rapport avec
la loi annoncée ci-dessous.
Le module de la Seine, à Paris, est de 249 mètres cubes et son débit annuel de
7,852 millions demètres cubes donnant lieu, pour un bassin de 44,375 kilom. quarrés,
à une couche d'eau de 0™.177 ou le 1/3 de la quantité tombée qui est de 0m.53 à
Paris.
La Saône, qui a pour bassin 30,600 kilom. quarrés, a débité annuellement en
moyenne à Trévoux pour les années 1844—45—46, 15,666 millions de mètres cubes,
se rapportant à une quantité moyenne d'eau tombée de 27,333 millions de mètres
cubes ; ainsi, le débit aurait été les 0".55 de la pluie et le module de 496 mètres
cubes ; mais, appliqué généralement, ce module serait probablement trop fort à cause
des années pluvieuses qui ont servi aux observations.
Le Rhône, près de son embouchure qui a pour bassin 97,750 kilom. quarrés, dé-
bite environ 2,000 mètres cubes en moyenne; le Nil, 2,850; le Rhin à Bâte, d'après
M. DEFOSTAINE, 941 mètres cubes et 1,643 mètres cubes, à Emmerick avant son entrée
en Hollande,
port du plus fort et du plus faible débit, nous paraissent être, pour le
premier cas, 1845, et pour le second, 1832. Nous avons trouvé, pour
1845 un débit de 11,250 millions de mètres cubes, dont le module est
357 mètres cubes, et pour 1832 un débit de 5,150 millions de mètres
cubes, dont le module est 163mo-.30 pour les mêmes années. M. BAUM-
GARTEN a trouvé, savoir : en 1845, 31,334 millions de mètres cubes,
donnant pour modules 993 mètres cubes, et pour 1832, 8,373 millions
de mètres cubes et un module de 565 mètres cubes.
Si l'on examine les quantités d'eau tombées à Toulouse, on trouve,
pour 1845, une hauteur de 0m.81 et une de 0,n.52 pour 1832; en 1854,
les pluies n'ont pas dépassé cette dernière hauteur, et même il est des
années, comme 1840, où le chiffre 0m.50 n'a pas été atteint et où le
débit de la Garonne n'est cependant pas descendu bien bas; cela tient,
d'abord à ce que la quantité de pluie tombée à Toulouse ne correspond
pas toujours, mais proportionnellement, à celle tombée sur le reste du
bassin, et ensuite à ce que le réservoir des montagnes est alimenté par
les pluies qui tombent depuis novembre jusqu'en juillet, et principale-
ment par celles générales qui ont lieu dans le mois de mai ou commen-
cement de juin. On peut remarquer, en effet, qu'en 1832, les pluies
tombées depuis novembre 1831 jusqu'en juillet suivant, représentent une
hauteur de 30Cimt-.76, tandis qu'en 1854 elles s'élevaient à 34cent\97,
en 1840 à 35C6n\60, et enfin, en 1845, à 58cent-.58, Toutes les années
signalées par de grandes crues printanières dans la Garonne corres-
pondent à des débits très-forts, et il n'y a pas de bas étiage ou il n'y en
a que très-tard; cela tient probablement à ce que lorsque la pluie est
générale, la distribution entre les montagnes et les plaines présente UB
rapport plus considérable que celui établi plus haut sur l'ensemble, et
qu'une partie notable reste sur les montagnes à l'état de neige pour
fondre au fur et à mesure que la température augmente, fusion qui est
en rapport avec la hauteur de ces mêmes montagnes (1).
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
Note sur le passage do Ltbrou par les systèmes MAGUÈS et
SERRIN.—Brochure in-8°de 8 pages avec une planche, par M. TEIL-
LEAD, ingénieur civil. Chez l'auteur, 48, Faubourg Saint-Denis, à Paris.
On a pu voir, à l'Exposition universelle de 1855 , un modèle repré-
sentant une série de petits aqueducs roulants en tôle , destinés à inter-
cepter et à rouvrir alternativement le passage à niveau du torrent du
Libron à travers le canal du Midi.
Ce système, projeté et exécuté en ce moment même par M.. l'Ingé-
nieur en chef MAGUÈS , est mis en parallèle par l'auteur de la brochure
avec une autre combinaison, consistant en deux aqueducs flottants, à
pivot latéral, pouvant se replier dans une chambre spéciale ménagée
dans la maçonnerie du canal.
M. SERRIN, auteur de ce dernier système, s'est proposé surtout de
simplifier le mécanisme et la manoeuvre des aqueducs, et de diminuer
les chances d'ensablement que l'on doit craindre d'autant plus que le
nombre des points morts est plus grand et que les surfaces de frotte-
ment sont plus multipliées.
Il remplace un ensemble de quarante-huit pièces par deux pièces seu-
lement. Il a deux axes de rotation au lieu de quatre-vingt-seize, et
quatre joints de raccord au lieu de soixante.
M. TRiLLEAUémet un avis favorable au système SERRiN,et en propose,
l'adoption pour tous les cas où l'on voudra empêcher qu'un torrent
coupé à niveau par un canal, ne dépose dans ce dernierdes sables et des
graviers qui peuvent devenir un obstacle à la navigation ou au libre
écoulement des eaux.
On peut craindre toutefois dans le système Serrin les difficultés de
manoeuvre résultant des ensablements momentanés et des variations du
poids moyen des deux grands aqueducs flottants.
(1) M. GALLAUP, ingénieur des Ponts et Chaussées, chargé de l'arrondissement de
Saint-Girons, qui a étudié, il y a quelques années, un projet de passage de France en
Espagne par le col du Salan, a bien voulu nous adresser le résultat de trente années
d'observations sur la durée des neiges à diverses hauteurs. Les montagnes sur les-
quelles ces observations ont été faites sont situées sur le versant français des Pyré-
nées et exposées au nord-est (vallée duSallat, d'Aleth, de l'Arac, du"Garbet, départe-
ment de l'Ariége).
Les résultats moyens établissent que la neige reste un mois à 650 mètres de hauteur
au-dessus du niveau de la mer, 2 mois à 930 mètres, 3 mois à 1,170 mètres, 4 mois
à 1,370 mètres, 5 mois à 1,530 mètres, 6 mois à 1,650 mètres, 7 mois à 1,750 mètres,
8 mois à 1,830 mètres, 9 mois à 1,950 mètres, 10 mois à 2,090 mètres, 11.mois à
2,240 mètres et 12 mois (neiges éternelles) à 2,450 mètres.
C.-A. OPPERMAMN, DIRECTEUR,
11, rue des Beaux-Arts, à Paris.
Paris. — Imprimé par E. ÏUUKOT et C", rue Racine, 26.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97.01%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97.01%.
- Collections numériques similaires Corpus : Art de l'ingénieur Corpus : Art de l'ingénieur /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp15"Cosmos (1852) /ark:/12148/bd6t51143731d.highres Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences, les arts et les manufactures, tant en France que dans les pays étrangers pendant l'année ... : avec l'indication succincte des principaux produits de l'industrie française ; la liste des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, accordés par le gouvernement pendant la même année, et des notices sur les prix proposés ou décernés par différentes sociétés savantes, françaises et étrangères, pour l'encouragement des sciences et des arts /ark:/12148/bd6t53887780b.highresThématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"
- Auteurs similaires Oppermann Charles Alfred Oppermann Charles Alfred /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Oppermann Charles Alfred" or dc.contributor adj "Oppermann Charles Alfred")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 8/8
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k56657781/f8.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k56657781/f8.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k56657781/f8.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k56657781
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k56657781
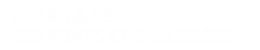


Facebook
Twitter