Titre : Nouvelles annales de la construction : publication rapide et économique des documents les plus récents et les plus intéressants relatifs à la construction française et étrangère... / C.-A. Oppermann
Titre : New annals of the construction
Titre : Neue Annalen der Baukunst
Éditeur : V. Dalmont (Paris)
Éditeur : V. DalmontV. Dalmont (Paris)
Éditeur : DunodDunod (Paris)
Éditeur : J. BaudryJ. Baudry (Paris)
Éditeur : C. BérangerC. Béranger (Paris)
Date d'édition : 1858-05-01
Contributeur : Oppermann, Charles Alfred (18..-18.. ; ingénieur des Ponts et chaussées). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32826369p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5529 Nombre total de vues : 5529
Description : 01 mai 1858 01 mai 1858
Description : 1858/05/01 (T4,N5)-1858/05/31. 1858/05/01 (T4,N5)-1858/05/31.
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k56657714
Source : Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, V-3528
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/11/2010
61
NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. -^MAI 1858.
62
2°Si, au contraire, le terrain à assainir ne doitson excès d'humidité qu'à,
la présence des sources, il faut abandonner le système des drains paral-
lèles, rechercher les sources et les enlever au moyen d'un drainage ver- '
tical (1). H est le plus souvent nécessaire d'établir Un drain collecteur
qui reçoit les diverses sources; mais il est prudent de ne déterminer le
diamètre des tuyaux du collecteur et même de ne les poser qu'après-
jaugeage des eaux; sans cette précaution, il arriverait qu'on emploie-
rait souvent des tuyaux trop petits pour recevoir lés eaux, ce qui obli-
gerait de recommencer le travail.
3° Lorsque l'humidité est occasionnée par l'infiltration des eaux pro-
venant des terrains supérieurs, l'étude du terrain devient beaucoup:
plus compliquée et plus sérieuse; car, dans ce cas, il est souvent
possible dé drainer très-économiquement, c'est-à-dire qu'on peut
assainir une grande surface de terres avec un petit nombre de drains ;
un seul drain de ceinture suffit quelquefois pour assainir toute une
pièce.
Il faut, lorsqu'on a à opérer sur des terres de cette nature, pra-
tiquer dans la pièce a assainir-un grand: nombre de saignées à une
profondeur plus grande que .celle que l'on suppose devoir être at-
teinte par les drains, et étudier sérieusement et très-attentivement le
régime dés eaux; on peut néanmoins commencer par établir un drain
de ceinture, en le faisant descendre jusqu'à la couche imperméable du
sous-sol, à moins toutefois que cette couche ne se trouve à une trop
grande profondeur. Après^la pose du drain de ceinture, il est prudent
d'attendre quelques jours avant d'ouvrir les autres drains, afin d'étu-
dier de nouveau l'effet que ce drain produit sur la nappe d'eau qui se
trouve en contre-bas; c'est d'après l'effet que ce drain aura produit
qu'on jugera la distance que peuvent avoir entre elles les files des
drains, qui, dans ce cas, doivent être disposées en écharpe sur les lignes
de la plus grande pente, et non perpendiculairement à ces lignes, puis-
qu'ils sont destinés à arrêter lés eaux venant des parties supérieures.
L'écartement varie dans des terres ayant cette disposition ; il est en
rapport avec l'épaisseur et la perméabilité de la couche arable, et la
distance de la couche imperméable de la surface. .
Il est toujours bon et souvent fort utile de se faire indiquer par le
cultivateur ou par lès Ouvriers habitués à travailler la pièce de terre à
drainer, les parties les plus humides et celles qui sont soi-disant saines.
Il arrive presque toujours, dans des terres qui reçoivent les eaux des
terrains supérieurs, que l'humidité affleure sur .différentes parties du
sol, tandis que les autres parties paraissent relativement saines ; il est
nécessaire, lorsque ce cas se présente, de se rendre compte des causes
de cette différence : elles sont généralement dues à un renflement du
sous-sol imperméable qui arrête les eaux comme dans un bassin et ne
les laisse filtrer qu'avec lenteur. On conçoit que, dans ce cas, il suffit
d'ouvrir un drain en travers la partie humide pour l'assainir complète-
ment, car n'étant pas humide de sa nature, ce qu'il fallait, c'était un
écoulement.
Lorsqu'on draine des terrains en pente, il est toujours utile de les
isoler des terres "supérieures par un petit fossé, afin d'empêcher l'écou-
lement sur la surface du sol des eaux pluviales.
4° Si l'on doit opérer sur un sol argileux, compacte et tenace, retenant
fortement l'eau, l'opération devient plus simple : il suffit dé lever le
plan du terrain, de le niveler, de tracer sur le plan des courbes hori-
zontales de niveau, en ayant soin d'étudier les points d'écoulement.
Avec ces renseignements, le tracé peut parfaitement se faire, dans
le cabinet; mais c'est le seul cas qui n'exige pas une étude complète. Et
en effet, que veut-on dans des terres de cette nature? les rendre meu-
bles et perméables sur toute leur surface. Ce résultat s'obtient en pla-
çant des drains parallèles suivant là plus grande pente du terrain; par
économie, il convient d'étudier le tracé de manière à diminuer autant
que possible ledéveloppement des drains collecteurs.
Ce système, qui "est le plus généralement suivi, est aussi le plus
onéreux; on l'applique indifféremment dans tous les cas, et il suit
de là qu'on augmenté inutilement les dépenses, et que le drainage
revient à un prix trop élevé. Il lié s'agit pas, pour opérer convena-
blement, de placer un grand nombre de mètres de drains par hectare,
mais bien de faire le moins de dépense possible tout en obtenant un ré-
sultat complet.
De plus, on.ne se préoccupe pas toujours suffisamment des rapports
d'épaisseur qui existent entre le spl et le sous-sol. Le premier étant
toujours plus perméable que le second, il est évident, en supposant
même un sous-spl partout de-même nature,.que là où la couche arable
augmente, les drains peuvent être plus distancés tout en produisant
autant d'effet ; car leur force attractive augmentera et s'étendra d'au-
tant plus que le sol superficiel sera plus perméable : ainsi donc, dans
une pièce de terre dont le sol est. perméable et le sous-sol imper-
(I) Voir l'explication du drainage vertical dans le firaineur, tome II, pages 0 à 49.
méable, l'écartement des drains> devra être d'autant plus grand que
la couche perméable du sol sera plus épuisée.
Un moyen pratique de vérifier la distance limite àvlaquelle l'effet
d'un drain se fait sentir, consiste à creuser, à côté d'un fossé déjà exé-
cuté, une sérié dé trous dé plus en plus éloignés, et à voir jusqu'à quelle
hauteur l'eau persiste à s'y maintenir.
ED. VIANNE.
Directeur de la'Cie Gie du Drainage économique.
.11, rue des Beaux-Arts.
RE¥UE BIBLIOGRAPHIQUE.
Traité théorique et pratique de la construction
des ponts métalliques,
Par MM. L. MOLINOS et C. PRONNIER, Ingénieurs civils. —Fort volume
in-4° avec figures intercalées dans les textes, accompagné d'un atlas
de 48 planches j demi-grand aigle. Chez Morel, 18, rue Vivienne, à
Paris. — Prix 125 fr.
La multiplication des ponts et tranaux en fer a été une des consé-
quences les plus caractéristiques de l'établissement des chemins de fer
dans tous les pays du monde.
La nécessité de construire des ponts avec des portées inconnues jus-
qu'alors, celle de couvrir les vastes enceintes,dèsgares et des entrepôts
sans points-d'appui intermédiaires jiout;donné naissance aux premiers
essais de ponts et de charpentes métalliques.
La fonte fut employée d'abord, et l'on en fit des voussoirs creux et
des pièces de charpentes évidées; puis, les: progrès de la métallurgie
aidant, les constructions en tôle, ayant pour point de départ lé. gigan-
tesque pont-tube du Menai, se substituèrent, progressivement aux ou-
vrages en fonte. -:,..,
On reconnut qu'à poids égal, la tôle était bien plus résistante aux
tensions, aux flexions et aux trépidations auxquelles les ponts sont
constamment exposés.
L'expérience prouva qu'il y avait ample compensation entre l'aug-
mentation de prix par unité de poids, et la diminution des sections au-
torisée par la meilleure qualité delà matière.
La tôle seule pouvait d'ailleurs se prêter à l'exécution de travées tu^
bulaires d'Une aussi grande portée que celle des ponts du Menai, dU Saint-
Laurent et de qUelqùes autres travaux du même genre exécutés depuis;
Enfin pour les solutions.économiques et courantes, le développement
dé la; 'fabrication des fers spéciaux, a complété, de la manière la plus
heureuse., l'ensemble des ressources matérielles qui sont aujourd'hui^
la disposition du constructeur. . : ,;
En publiant leur important ouvrage sur la construction des ponts métal-
liques, MM. MOLIKOS et PKONKIKK se sont surtout proposé deux objets s
L'un, de développer la théorie complète des ponts dont il s'agit, et
l'autre d'arriver, par l'étude détaillée des conditions mécaniques de
chaque système, à une discussion générale qui en fît ressortir.les avan-r
tages et les inconvénients, et qui permît de les classer et de leschoisir
suivant la nature des problèmes à résoudre.
L'ensemble de leur travail se divise eu. trois parties :: i
Dans la première partie, après avoir rappelé les résultats généraux
des nombreuses expériences sur la résistance du fer et de la fonte qui
ont précédé en Angleterre l'application du métal dans les grands tra-
vaux d'art, on trouve Texposé d'une série de méthodes dé calcul pour
les différents systèmes de ponts, en indiquant les simplifications qui
permettent de les abréger.
Dans la deuxième partie, la construction est traitée d'une manière
spéciale. Les assemblages y sont étudiés avec beaucoup de détail, ainsi
que les expériences auxquelles ils Ont donné lieu. .
Les auteurs ont également indiqué les points principaux de là fabri-
cation des matières premières, l'étal' actuel de la métallurgie, et les
ressources qu'elle offre pour l'exécution des travaux d'art.
Enfin, dans la troisième partie,, on trouve une série d'applications
numériques des formules à des travaux devenus célèbres (pont de
Langon,pontde Britannia,pont d'Asnières, pont de Newarck-Dyke, etc;)
et une discussion générale des différents systèmes de ponts, suivie de là
comparaison delèurs avantages respectifs.. ;. . .. ;
; Les applications numériquesdes formules, faites par les auteurs aux
ouvrages d'art les plus intéressants, sont de nature à ôter toute incer~
titude sur lemode d'emploi des méthodes de calcul. On ne trouve que
trop souvent dansles mémoires exclusivement théoriques faits sur les
ponts en fer ou en fonte, des formules d'une complication tout à fait
inacceptable en pratique. - - -. ■■ -;:- - • :.■■■'*.
La discussion des: avantages et des inconvénients de chaque mode de
NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. -^MAI 1858.
62
2°Si, au contraire, le terrain à assainir ne doitson excès d'humidité qu'à,
la présence des sources, il faut abandonner le système des drains paral-
lèles, rechercher les sources et les enlever au moyen d'un drainage ver- '
tical (1). H est le plus souvent nécessaire d'établir Un drain collecteur
qui reçoit les diverses sources; mais il est prudent de ne déterminer le
diamètre des tuyaux du collecteur et même de ne les poser qu'après-
jaugeage des eaux; sans cette précaution, il arriverait qu'on emploie-
rait souvent des tuyaux trop petits pour recevoir lés eaux, ce qui obli-
gerait de recommencer le travail.
3° Lorsque l'humidité est occasionnée par l'infiltration des eaux pro-
venant des terrains supérieurs, l'étude du terrain devient beaucoup:
plus compliquée et plus sérieuse; car, dans ce cas, il est souvent
possible dé drainer très-économiquement, c'est-à-dire qu'on peut
assainir une grande surface de terres avec un petit nombre de drains ;
un seul drain de ceinture suffit quelquefois pour assainir toute une
pièce.
Il faut, lorsqu'on a à opérer sur des terres de cette nature, pra-
tiquer dans la pièce a assainir-un grand: nombre de saignées à une
profondeur plus grande que .celle que l'on suppose devoir être at-
teinte par les drains, et étudier sérieusement et très-attentivement le
régime dés eaux; on peut néanmoins commencer par établir un drain
de ceinture, en le faisant descendre jusqu'à la couche imperméable du
sous-sol, à moins toutefois que cette couche ne se trouve à une trop
grande profondeur. Après^la pose du drain de ceinture, il est prudent
d'attendre quelques jours avant d'ouvrir les autres drains, afin d'étu-
dier de nouveau l'effet que ce drain produit sur la nappe d'eau qui se
trouve en contre-bas; c'est d'après l'effet que ce drain aura produit
qu'on jugera la distance que peuvent avoir entre elles les files des
drains, qui, dans ce cas, doivent être disposées en écharpe sur les lignes
de la plus grande pente, et non perpendiculairement à ces lignes, puis-
qu'ils sont destinés à arrêter lés eaux venant des parties supérieures.
L'écartement varie dans des terres ayant cette disposition ; il est en
rapport avec l'épaisseur et la perméabilité de la couche arable, et la
distance de la couche imperméable de la surface. .
Il est toujours bon et souvent fort utile de se faire indiquer par le
cultivateur ou par lès Ouvriers habitués à travailler la pièce de terre à
drainer, les parties les plus humides et celles qui sont soi-disant saines.
Il arrive presque toujours, dans des terres qui reçoivent les eaux des
terrains supérieurs, que l'humidité affleure sur .différentes parties du
sol, tandis que les autres parties paraissent relativement saines ; il est
nécessaire, lorsque ce cas se présente, de se rendre compte des causes
de cette différence : elles sont généralement dues à un renflement du
sous-sol imperméable qui arrête les eaux comme dans un bassin et ne
les laisse filtrer qu'avec lenteur. On conçoit que, dans ce cas, il suffit
d'ouvrir un drain en travers la partie humide pour l'assainir complète-
ment, car n'étant pas humide de sa nature, ce qu'il fallait, c'était un
écoulement.
Lorsqu'on draine des terrains en pente, il est toujours utile de les
isoler des terres "supérieures par un petit fossé, afin d'empêcher l'écou-
lement sur la surface du sol des eaux pluviales.
4° Si l'on doit opérer sur un sol argileux, compacte et tenace, retenant
fortement l'eau, l'opération devient plus simple : il suffit dé lever le
plan du terrain, de le niveler, de tracer sur le plan des courbes hori-
zontales de niveau, en ayant soin d'étudier les points d'écoulement.
Avec ces renseignements, le tracé peut parfaitement se faire, dans
le cabinet; mais c'est le seul cas qui n'exige pas une étude complète. Et
en effet, que veut-on dans des terres de cette nature? les rendre meu-
bles et perméables sur toute leur surface. Ce résultat s'obtient en pla-
çant des drains parallèles suivant là plus grande pente du terrain; par
économie, il convient d'étudier le tracé de manière à diminuer autant
que possible ledéveloppement des drains collecteurs.
Ce système, qui "est le plus généralement suivi, est aussi le plus
onéreux; on l'applique indifféremment dans tous les cas, et il suit
de là qu'on augmenté inutilement les dépenses, et que le drainage
revient à un prix trop élevé. Il lié s'agit pas, pour opérer convena-
blement, de placer un grand nombre de mètres de drains par hectare,
mais bien de faire le moins de dépense possible tout en obtenant un ré-
sultat complet.
De plus, on.ne se préoccupe pas toujours suffisamment des rapports
d'épaisseur qui existent entre le spl et le sous-sol. Le premier étant
toujours plus perméable que le second, il est évident, en supposant
même un sous-spl partout de-même nature,.que là où la couche arable
augmente, les drains peuvent être plus distancés tout en produisant
autant d'effet ; car leur force attractive augmentera et s'étendra d'au-
tant plus que le sol superficiel sera plus perméable : ainsi donc, dans
une pièce de terre dont le sol est. perméable et le sous-sol imper-
(I) Voir l'explication du drainage vertical dans le firaineur, tome II, pages 0 à 49.
méable, l'écartement des drains> devra être d'autant plus grand que
la couche perméable du sol sera plus épuisée.
Un moyen pratique de vérifier la distance limite àvlaquelle l'effet
d'un drain se fait sentir, consiste à creuser, à côté d'un fossé déjà exé-
cuté, une sérié dé trous dé plus en plus éloignés, et à voir jusqu'à quelle
hauteur l'eau persiste à s'y maintenir.
ED. VIANNE.
Directeur de la'Cie Gie du Drainage économique.
.11, rue des Beaux-Arts.
RE¥UE BIBLIOGRAPHIQUE.
Traité théorique et pratique de la construction
des ponts métalliques,
Par MM. L. MOLINOS et C. PRONNIER, Ingénieurs civils. —Fort volume
in-4° avec figures intercalées dans les textes, accompagné d'un atlas
de 48 planches j demi-grand aigle. Chez Morel, 18, rue Vivienne, à
Paris. — Prix 125 fr.
La multiplication des ponts et tranaux en fer a été une des consé-
quences les plus caractéristiques de l'établissement des chemins de fer
dans tous les pays du monde.
La nécessité de construire des ponts avec des portées inconnues jus-
qu'alors, celle de couvrir les vastes enceintes,dèsgares et des entrepôts
sans points-d'appui intermédiaires jiout;donné naissance aux premiers
essais de ponts et de charpentes métalliques.
La fonte fut employée d'abord, et l'on en fit des voussoirs creux et
des pièces de charpentes évidées; puis, les: progrès de la métallurgie
aidant, les constructions en tôle, ayant pour point de départ lé. gigan-
tesque pont-tube du Menai, se substituèrent, progressivement aux ou-
vrages en fonte. -:,..,
On reconnut qu'à poids égal, la tôle était bien plus résistante aux
tensions, aux flexions et aux trépidations auxquelles les ponts sont
constamment exposés.
L'expérience prouva qu'il y avait ample compensation entre l'aug-
mentation de prix par unité de poids, et la diminution des sections au-
torisée par la meilleure qualité delà matière.
La tôle seule pouvait d'ailleurs se prêter à l'exécution de travées tu^
bulaires d'Une aussi grande portée que celle des ponts du Menai, dU Saint-
Laurent et de qUelqùes autres travaux du même genre exécutés depuis;
Enfin pour les solutions.économiques et courantes, le développement
dé la; 'fabrication des fers spéciaux, a complété, de la manière la plus
heureuse., l'ensemble des ressources matérielles qui sont aujourd'hui^
la disposition du constructeur. . : ,;
En publiant leur important ouvrage sur la construction des ponts métal-
liques, MM. MOLIKOS et PKONKIKK se sont surtout proposé deux objets s
L'un, de développer la théorie complète des ponts dont il s'agit, et
l'autre d'arriver, par l'étude détaillée des conditions mécaniques de
chaque système, à une discussion générale qui en fît ressortir.les avan-r
tages et les inconvénients, et qui permît de les classer et de leschoisir
suivant la nature des problèmes à résoudre.
L'ensemble de leur travail se divise eu. trois parties :: i
Dans la première partie, après avoir rappelé les résultats généraux
des nombreuses expériences sur la résistance du fer et de la fonte qui
ont précédé en Angleterre l'application du métal dans les grands tra-
vaux d'art, on trouve Texposé d'une série de méthodes dé calcul pour
les différents systèmes de ponts, en indiquant les simplifications qui
permettent de les abréger.
Dans la deuxième partie, la construction est traitée d'une manière
spéciale. Les assemblages y sont étudiés avec beaucoup de détail, ainsi
que les expériences auxquelles ils Ont donné lieu. .
Les auteurs ont également indiqué les points principaux de là fabri-
cation des matières premières, l'étal' actuel de la métallurgie, et les
ressources qu'elle offre pour l'exécution des travaux d'art.
Enfin, dans la troisième partie,, on trouve une série d'applications
numériques des formules à des travaux devenus célèbres (pont de
Langon,pontde Britannia,pont d'Asnières, pont de Newarck-Dyke, etc;)
et une discussion générale des différents systèmes de ponts, suivie de là
comparaison delèurs avantages respectifs.. ;. . .. ;
; Les applications numériquesdes formules, faites par les auteurs aux
ouvrages d'art les plus intéressants, sont de nature à ôter toute incer~
titude sur lemode d'emploi des méthodes de calcul. On ne trouve que
trop souvent dansles mémoires exclusivement théoriques faits sur les
ponts en fer ou en fonte, des formules d'une complication tout à fait
inacceptable en pratique. - - -. ■■ -;:- - • :.■■■'*.
La discussion des: avantages et des inconvénients de chaque mode de
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 95.56%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 95.56%.
- Collections numériques similaires Corpus : Art de l'ingénieur Corpus : Art de l'ingénieur /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp15"Cosmos (1852) /ark:/12148/bd6t51143731d.highres Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences, les arts et les manufactures, tant en France que dans les pays étrangers pendant l'année ... : avec l'indication succincte des principaux produits de l'industrie française ; la liste des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, accordés par le gouvernement pendant la même année, et des notices sur les prix proposés ou décernés par différentes sociétés savantes, françaises et étrangères, pour l'encouragement des sciences et des arts /ark:/12148/bd6t53887780b.highresThématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"
- Auteurs similaires Oppermann Charles Alfred Oppermann Charles Alfred /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Oppermann Charles Alfred" or dc.contributor adj "Oppermann Charles Alfred")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 7/8
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k56657714/f7.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k56657714/f7.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k56657714/f7.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k56657714
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k56657714
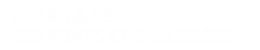


Facebook
Twitter