Titre : Nouvelles annales de la construction : publication rapide et économique des documents les plus récents et les plus intéressants relatifs à la construction française et étrangère... / C.-A. Oppermann
Titre : New annals of the construction
Titre : Neue Annalen der Baukunst
Éditeur : V. Dalmont (Paris)
Éditeur : V. DalmontV. Dalmont (Paris)
Éditeur : DunodDunod (Paris)
Éditeur : J. BaudryJ. Baudry (Paris)
Éditeur : C. BérangerC. Béranger (Paris)
Date d'édition : 1857-10-01
Contributeur : Oppermann, Charles Alfred (18..-18.. ; ingénieur des Ponts et chaussées). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32826369p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5529 Nombre total de vues : 5529
Description : 01 octobre 1857 01 octobre 1857
Description : 1857/10/01 (A3,N10)-1857/10/31. 1857/10/01 (A3,N10)-1857/10/31.
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k5577515g
Source : Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, V-3528
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/11/2010
119 NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. —OCTOBRE 1857. 120
0,028 par mètre. Les expériences donnèrent des résultats tellement
favorables, qu'ils amenèrent une révolution dans le tracé des lignes à
construire.
L'on ne recula plus devant des rampes de beaucoup supérieures à
0,005.
Les chemins de fer, les plus récemment construits, ont mis à profit
l'expérience des Anglais et des Américains, et aujourd'hui l'on ren-
contre fréquemment des rampes et des pentes de 0,008, 0,010 et même
0,025.
Le tableau suivant, en indiquant le maximum des rampes sur les che-
mins de fer construits en Allemagne, va en donner de nombreuses
preuves :
Chemin de fer de Cdlogne-Minden 0,010
— de Berg-Marche 0,012
— de Brunswick-Lunebourg. . . 0,020
De Geislingen à TJlm, sur la ligne de Wur-
temberg, sur une longueur de 5,058 mètres, se
trouve un plan incliné de 0,022
De Neuemarkt à Markschorgast, ligne bava-
roise, il existe un plan incliné de 2,489 mètres
avec une pente de . 0,025
Enfin, au passage du Semmering, en Autriche, la pente s'élève éga-
lement à 0m.025, et toutes ces lignes sont exploitées par des loco-
motives ayant seulement un poids plus considérable que les locomotives
ordinaires, et une plus grande surface de chauffe.
REVUE TECHNOLOGIQUE.
Brique combustible de M. Tiget.
Cuire des briques avec d'autres briques pour combustible, c'est au
premier aspect une idée singulière, tel est cependant le problème ré-
solu par M. TIGET.
En effet, si l'on examine les choses plus attentivement, on reconnaît
que M. TIGET a simplement imaginé d'utiliser les cendres et résidus des
combustibles qui servent ordinairement à la cuisson des briques.
Jusqu'à présent le combustible employé à cet effet laissait des résidus
et cendres sans valeur, parce qu'ils étaient sans cohésion entre eux.
M. TIGET a su mélanger le combustible à la terre, de telle sorte et avec
de telles matières, que les résidus et cendres au lieu de se séparer par
l'action du feu en perdant ainsi toute valeur, sont réunis, soudés et
durcis pour ainsi dire par l'action même du feu, de manière à constituer
une brique résistante, pouvant être utilisée pour la construction des
édifices, ateliers, murs de cloisons, etc.
Une fois ce point de départ admis, l'opération est facile à compren-
dre : il fallait donner au combustible la forme de la brique en l'incor-
porant dans la terre argileuse qui doit constituer tout à la fois le sque-
lette et le moule de la brique de cendres et de résidus qui restera après
la combustion des matières susceptibles de brûler qui y sont mélangées;
il faut tle.plus que les proportions soient assez bien entendues pour que
celte combustion se maintienne pendant toute la durée de l'opération
d'une manière convenable.
Pour y arriver aussi complètement que possible, M. TIGET délaye
83 p. 100 environ d'argile et de marne avec des détritus de charbon de
bois, de coke, de tourbe carbonisée, et il ajoute à l'eau employée pour
cette opération, une solution de nitrate de potasse, de soude et d'alun.
La combinaison de ces diverses substances fournit par le mélange
une brique combustible, malgré la grande quantité d'argile qu'elle con-
tient. Four bien utiliser ce combustible à résidu industriel, on procède
à l'enfournement comme pour des briques ordinaires, en ayant soin
toutefois de placer les briques combustibles par lits de quatre à cinq
briques alternant avec les briques ordinaires; on allume ensuite un lé-
ger feu dans le four pour dessécher d'abord les briques et amener les
briques inférieures au rouge; arrivé à ce moment, on ferme les issues
de toute nature, et surtout les cheminées qui laisseraient pénétrer de
l'air froid.
Malgré cette occlusion complète, l'air pénètre cependant quoiqu'avec
de grandes difficultés, et suffit ainsi à la bonne combustion des briques
combustibles*, au bout de soixante heures environ, on peut défourner
autant de briques que l'on en a chargé, avec celte particularité cepen-
dant que les unes sont des briques ordinaires, et les autres des briques
rendues plus légères, et par conséquent préférables pour certains tra-
vaux; quant à leur résistance, il résulte d'expériences faites par M. Mt-
CHELOT, Ingénieur des Ponts et Chaussées, que ces briques, qui ne s'al-
tèrent pas par le sulfate de soude, et qui, par conséquent, ne sont pas
gélives, peuvent résister à une compression de 25 kilogrammes par
centimètre quarré, tout comme les briques ordinaires cuites dans le
même four.
Le procédé de M. TIGET peut s'appliquer à la fabrication des tuiles,
carreaux, poteries communes, terres cuites, tuyaux de drainage, etc.,
et fournit à l'industrie un nouveau moyen de mieux utiliser le com-
bustible en employant ses résidus.
ÉMUE BARRAULT, Ingénieur civil.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
lies Tramways, ou chemins de fer à traction de che-
vaux, par M. ALEXANDRE D'ADHÉMAR, ancien élève de l'École poly-
technique. In-8° de 102 pages avec 4 planches, chez Lacroix-Comon,
éditeur, 15, quai Malaquais.
Nous avons insisté plus d'une fois sur l'urgente nécessité de créer,
dans les vastes intervalles que comprend le réseau des chemins de fer
à locomotives, des voies ferrées économiques à traction de chevaux^ ou
chemins de fer américains.
M. d'ADHÉMAR, après avoir appelé l'attention sur les avantages com-
merciaux, industriels et agricoles de ces lignes secondaires, examine
successivement les divers systèmes proposés, et notamment le système
HENRY, à rail plat (voir les Nouvelles Annales de la construction d'août
1856), le système Loubat (voir id.), le système des rails en granit de
M. Bruschetti, et plusieurs autres systèmes de rails à ornières, soit con-
vexes, soit concaves.
Dans une partie spéciale de son travail, il examine les principales
questions relatives au frottement des roues dans les courbes, et au gra-
vissement des fortes rampes.
Il termine par des notes sur les prix de revient des matériaux adop-
tés, et sur la moyenne du revenu kilométrique des chemins de fer
Sardes, dont il tire plusieurs arguments économiques.
A part quelques observations et quelques réserves à faire sur la con-
formation des rails proposés par l'auteur pour résoudre les différents
cas de la pratique, on ne peut qu'applaudir aux efforts faits pour hâter
le triomphe d'une idée utile, et pour amener à bonne et prompte solu-
tion un des plus intéressants problèmes que puisse offrir l'étude des
voies de communication.
Manuel de la construction des chemins de fer, par
M. EM. WITH, 2 vol., avec atlas. Encyclopédie Roret. Paris, 1857.
Sous le titre de Manuel des chemins de fer, M. EM. WITH a ré-
sumé, dans un ouvrage en 2 volumes, accompagné d'un atlas, la théo-
rie et la pratique de l'établissement des chemins de fer.
La première partie de cet ouvrage contient des études comparatives
sur les divers systèmes de construction de la voie et du matériel; la
seconde renferme le formulaire des cahiers des charges, clauses et con-
ditions générales pour l'établissement des travaux, et des séries de
prix pour les diverses fournitures.
Les parties les plus nouvelles que l'on remarque dans la première
partie du travail de M. WITH, sont celles relatives à la .description des
divers systèmes de ponts en fer à treillis, du système des rails Vignole,
avec éclisses, et des différents moyens proposés pour éviter les acci-
dents.
Le même auteur a d'ailleurs déjà publié, en 1855, une brochure spé-
ciale relative aux accidents sur les chemins de fer.
La deuxième partie est de nature à rendre de grands services non-
seulement à tous les ingénieurs de chemins de fer, mais en général
à toutes les personnes chargées du projet et de la direction de grands
travaux de construction.
D'au nouveau mode d'essai des mortiers marins dans
le laboratoire, proposé par M. Vicat. Brochure in-8° de 8 pages,
par M. MINARD, Inspecteur général des Ponts et Chaussées. Paris,
Juillet 1857.
Dans cette note, pleine de judicieuses observations et d'exemples
empruntés à la pratique des plus récents travaux, M. MINARD critique
le principe des opérations de laboratoire substituées aux essais eu
grand et à mer libre, pour l'étude des propriétés hydrauliques et
chimiques des mortiers marins.
Il conclut que « le seul moyen rationnel de connaître l'action de la
mer sur un nouveau mortier est de l'immerger de fait, et dans les pa-
rages où il doit être employé, dans des circonstances aussi identiques
que possible à celles de l'application que l'on veut en faire. Vouloir
suppléer à la mer par des opérations chimiques de laboratoire serait
s'exposer immanquablement à de nouveaux mécomptes, à de nouveaux
désastres. »
C. A. OPPERMANN, DIRECTEUR,
11, rue des Beaux-Arts, à Paris.
Paris — Imprimé par E. THUNOÏ et C% 26, rue Racine.
0,028 par mètre. Les expériences donnèrent des résultats tellement
favorables, qu'ils amenèrent une révolution dans le tracé des lignes à
construire.
L'on ne recula plus devant des rampes de beaucoup supérieures à
0,005.
Les chemins de fer, les plus récemment construits, ont mis à profit
l'expérience des Anglais et des Américains, et aujourd'hui l'on ren-
contre fréquemment des rampes et des pentes de 0,008, 0,010 et même
0,025.
Le tableau suivant, en indiquant le maximum des rampes sur les che-
mins de fer construits en Allemagne, va en donner de nombreuses
preuves :
Chemin de fer de Cdlogne-Minden 0,010
— de Berg-Marche 0,012
— de Brunswick-Lunebourg. . . 0,020
De Geislingen à TJlm, sur la ligne de Wur-
temberg, sur une longueur de 5,058 mètres, se
trouve un plan incliné de 0,022
De Neuemarkt à Markschorgast, ligne bava-
roise, il existe un plan incliné de 2,489 mètres
avec une pente de . 0,025
Enfin, au passage du Semmering, en Autriche, la pente s'élève éga-
lement à 0m.025, et toutes ces lignes sont exploitées par des loco-
motives ayant seulement un poids plus considérable que les locomotives
ordinaires, et une plus grande surface de chauffe.
REVUE TECHNOLOGIQUE.
Brique combustible de M. Tiget.
Cuire des briques avec d'autres briques pour combustible, c'est au
premier aspect une idée singulière, tel est cependant le problème ré-
solu par M. TIGET.
En effet, si l'on examine les choses plus attentivement, on reconnaît
que M. TIGET a simplement imaginé d'utiliser les cendres et résidus des
combustibles qui servent ordinairement à la cuisson des briques.
Jusqu'à présent le combustible employé à cet effet laissait des résidus
et cendres sans valeur, parce qu'ils étaient sans cohésion entre eux.
M. TIGET a su mélanger le combustible à la terre, de telle sorte et avec
de telles matières, que les résidus et cendres au lieu de se séparer par
l'action du feu en perdant ainsi toute valeur, sont réunis, soudés et
durcis pour ainsi dire par l'action même du feu, de manière à constituer
une brique résistante, pouvant être utilisée pour la construction des
édifices, ateliers, murs de cloisons, etc.
Une fois ce point de départ admis, l'opération est facile à compren-
dre : il fallait donner au combustible la forme de la brique en l'incor-
porant dans la terre argileuse qui doit constituer tout à la fois le sque-
lette et le moule de la brique de cendres et de résidus qui restera après
la combustion des matières susceptibles de brûler qui y sont mélangées;
il faut tle.plus que les proportions soient assez bien entendues pour que
celte combustion se maintienne pendant toute la durée de l'opération
d'une manière convenable.
Pour y arriver aussi complètement que possible, M. TIGET délaye
83 p. 100 environ d'argile et de marne avec des détritus de charbon de
bois, de coke, de tourbe carbonisée, et il ajoute à l'eau employée pour
cette opération, une solution de nitrate de potasse, de soude et d'alun.
La combinaison de ces diverses substances fournit par le mélange
une brique combustible, malgré la grande quantité d'argile qu'elle con-
tient. Four bien utiliser ce combustible à résidu industriel, on procède
à l'enfournement comme pour des briques ordinaires, en ayant soin
toutefois de placer les briques combustibles par lits de quatre à cinq
briques alternant avec les briques ordinaires; on allume ensuite un lé-
ger feu dans le four pour dessécher d'abord les briques et amener les
briques inférieures au rouge; arrivé à ce moment, on ferme les issues
de toute nature, et surtout les cheminées qui laisseraient pénétrer de
l'air froid.
Malgré cette occlusion complète, l'air pénètre cependant quoiqu'avec
de grandes difficultés, et suffit ainsi à la bonne combustion des briques
combustibles*, au bout de soixante heures environ, on peut défourner
autant de briques que l'on en a chargé, avec celte particularité cepen-
dant que les unes sont des briques ordinaires, et les autres des briques
rendues plus légères, et par conséquent préférables pour certains tra-
vaux; quant à leur résistance, il résulte d'expériences faites par M. Mt-
CHELOT, Ingénieur des Ponts et Chaussées, que ces briques, qui ne s'al-
tèrent pas par le sulfate de soude, et qui, par conséquent, ne sont pas
gélives, peuvent résister à une compression de 25 kilogrammes par
centimètre quarré, tout comme les briques ordinaires cuites dans le
même four.
Le procédé de M. TIGET peut s'appliquer à la fabrication des tuiles,
carreaux, poteries communes, terres cuites, tuyaux de drainage, etc.,
et fournit à l'industrie un nouveau moyen de mieux utiliser le com-
bustible en employant ses résidus.
ÉMUE BARRAULT, Ingénieur civil.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
lies Tramways, ou chemins de fer à traction de che-
vaux, par M. ALEXANDRE D'ADHÉMAR, ancien élève de l'École poly-
technique. In-8° de 102 pages avec 4 planches, chez Lacroix-Comon,
éditeur, 15, quai Malaquais.
Nous avons insisté plus d'une fois sur l'urgente nécessité de créer,
dans les vastes intervalles que comprend le réseau des chemins de fer
à locomotives, des voies ferrées économiques à traction de chevaux^ ou
chemins de fer américains.
M. d'ADHÉMAR, après avoir appelé l'attention sur les avantages com-
merciaux, industriels et agricoles de ces lignes secondaires, examine
successivement les divers systèmes proposés, et notamment le système
HENRY, à rail plat (voir les Nouvelles Annales de la construction d'août
1856), le système Loubat (voir id.), le système des rails en granit de
M. Bruschetti, et plusieurs autres systèmes de rails à ornières, soit con-
vexes, soit concaves.
Dans une partie spéciale de son travail, il examine les principales
questions relatives au frottement des roues dans les courbes, et au gra-
vissement des fortes rampes.
Il termine par des notes sur les prix de revient des matériaux adop-
tés, et sur la moyenne du revenu kilométrique des chemins de fer
Sardes, dont il tire plusieurs arguments économiques.
A part quelques observations et quelques réserves à faire sur la con-
formation des rails proposés par l'auteur pour résoudre les différents
cas de la pratique, on ne peut qu'applaudir aux efforts faits pour hâter
le triomphe d'une idée utile, et pour amener à bonne et prompte solu-
tion un des plus intéressants problèmes que puisse offrir l'étude des
voies de communication.
Manuel de la construction des chemins de fer, par
M. EM. WITH, 2 vol., avec atlas. Encyclopédie Roret. Paris, 1857.
Sous le titre de Manuel des chemins de fer, M. EM. WITH a ré-
sumé, dans un ouvrage en 2 volumes, accompagné d'un atlas, la théo-
rie et la pratique de l'établissement des chemins de fer.
La première partie de cet ouvrage contient des études comparatives
sur les divers systèmes de construction de la voie et du matériel; la
seconde renferme le formulaire des cahiers des charges, clauses et con-
ditions générales pour l'établissement des travaux, et des séries de
prix pour les diverses fournitures.
Les parties les plus nouvelles que l'on remarque dans la première
partie du travail de M. WITH, sont celles relatives à la .description des
divers systèmes de ponts en fer à treillis, du système des rails Vignole,
avec éclisses, et des différents moyens proposés pour éviter les acci-
dents.
Le même auteur a d'ailleurs déjà publié, en 1855, une brochure spé-
ciale relative aux accidents sur les chemins de fer.
La deuxième partie est de nature à rendre de grands services non-
seulement à tous les ingénieurs de chemins de fer, mais en général
à toutes les personnes chargées du projet et de la direction de grands
travaux de construction.
D'au nouveau mode d'essai des mortiers marins dans
le laboratoire, proposé par M. Vicat. Brochure in-8° de 8 pages,
par M. MINARD, Inspecteur général des Ponts et Chaussées. Paris,
Juillet 1857.
Dans cette note, pleine de judicieuses observations et d'exemples
empruntés à la pratique des plus récents travaux, M. MINARD critique
le principe des opérations de laboratoire substituées aux essais eu
grand et à mer libre, pour l'étude des propriétés hydrauliques et
chimiques des mortiers marins.
Il conclut que « le seul moyen rationnel de connaître l'action de la
mer sur un nouveau mortier est de l'immerger de fait, et dans les pa-
rages où il doit être employé, dans des circonstances aussi identiques
que possible à celles de l'application que l'on veut en faire. Vouloir
suppléer à la mer par des opérations chimiques de laboratoire serait
s'exposer immanquablement à de nouveaux mécomptes, à de nouveaux
désastres. »
C. A. OPPERMANN, DIRECTEUR,
11, rue des Beaux-Arts, à Paris.
Paris — Imprimé par E. THUNOÏ et C% 26, rue Racine.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97.39%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 97.39%.
- Collections numériques similaires Corpus : Art de l'ingénieur Corpus : Art de l'ingénieur /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp15"Cosmos (1852) /ark:/12148/bd6t51143731d.highres Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences, les arts et les manufactures, tant en France que dans les pays étrangers pendant l'année ... : avec l'indication succincte des principaux produits de l'industrie française ; la liste des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, accordés par le gouvernement pendant la même année, et des notices sur les prix proposés ou décernés par différentes sociétés savantes, françaises et étrangères, pour l'encouragement des sciences et des arts /ark:/12148/bd6t53887780b.highresThématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"
- Auteurs similaires Oppermann Charles Alfred Oppermann Charles Alfred /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Oppermann Charles Alfred" or dc.contributor adj "Oppermann Charles Alfred")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 4/4
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k5577515g/f4.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k5577515g/f4.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k5577515g/f4.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k5577515g
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k5577515g
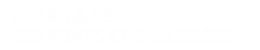


Facebook
Twitter