Titre : Nouvelles annales de la construction : publication rapide et économique des documents les plus récents et les plus intéressants relatifs à la construction française et étrangère... / C.-A. Oppermann
Titre : New annals of the construction
Titre : Neue Annalen der Baukunst
Éditeur : V. Dalmont (Paris)
Éditeur : V. DalmontV. Dalmont (Paris)
Éditeur : DunodDunod (Paris)
Éditeur : J. BaudryJ. Baudry (Paris)
Éditeur : C. BérangerC. Béranger (Paris)
Date d'édition : 1858-05-01
Contributeur : Oppermann, Charles Alfred (18..-18.. ; ingénieur des Ponts et chaussées). Éditeur scientifique
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32826369p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 5529 Nombre total de vues : 5529
Description : 01 mai 1858 01 mai 1858
Description : 1858/05/01 (T4,N5)-1858/05/31. 1858/05/01 (T4,N5)-1858/05/31.
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur Collection numérique : Corpus : Art de l'ingénieur
Description : Collection numérique : Thématique : ingénierie,... Collection numérique : Thématique : ingénierie, génie civil
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k56657714
Source : Bibliothèque nationale de France, département Littérature et art, V-3528
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 30/11/2010
55
NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. -- MAI 18.58.
5(5
dine est un obstacle incommode, et les clapets ne pouvant s'ouvrir
complètement,' le débouché offert à l'eau n'est pas complet. L'avantage
duconlre-dêbutemenl des clapets, qui est très-réel quand ceux-ci sont
entièrement à fond, devient tout à fait illusoire dès que l'on commence
à les ouvrir; aussi M. BONNIN n'a-t-il pu échapper à la nécessité
d'ajouter de petits clapets auxiliaires pour établir la contre-pression
derrière les clapets principaux avant de les ouvrir.
Aux avantages du robinet BONNIN, celui de M. DEVANNE (fig. 1,2,
3,4) ajoute ceux d'une grande simplicité et d'une construction plus
économique, puisqu'il n'y a qu'un clapet au lieu de quatre. Le dé-
bouché est très-large et la veine fluide n'a à subir qu'une déviation à
peine/sensible en franchissant le seuil formé par le bas du siège. Enfin,
l'écrou étant guidé, la vis travaille toujours dans le sens de son axe
sans avoir aucun effet latéral à supporter.
L'expérience a prouvé qu'il était indispensable, pour rendre le robinet
étanche, de dresser sur le tour le siège et le bord du clapet entre lesquels
le caoutchouc doit être pincé. Ce dernier est cousu sur le bord du clapet
avec un double fil de laiton que l'on enlace autour de dents venues à
la fonte tant en dedans qu'en dehors du clapet. Les trous par lesquels
on introduit la broche de la charnière du clapet sont fermés par des
bouchons en laiton rendus étanches au moyen d'un cordon de chanvre
suifé.
Cinq de ces robinets fonctionnent à Bordeaux de la manière la plus
satisfaisante.
Remplacement des réservoirs d'air des conduites d'eau
par des régulateurs à poids et à soupape.
On remplace ■économiquement depuis quelque temps, en Angleterre,
les réservoirs d'air destinés à s'opposer aux coups de bélier dans les
conduites d'eau, par des cylindres à poids et à soupape permettant
l'échappement de l'eau à air libre.
"L'eau, poussée.dansles tuyaux par les impulsions violentes auxquelles
donnent lieu toutes les distributions à grand développement, soulève un
piston chargé d'un poids calculé d'avance, et s'échappe jusqu'à ce que
la pression soit redevenue normale.
Ce système, qui ne présente pas les mêmes inconvénients matériels
que celui des réservoirs d'air, puisqu'il permet à l'eau excédante de se
déverser librement, fonctionne avec succès à la station du Great-
Western à Londres.
Appareil de lessivage et blancliisserie perfectionnée ■,
Système RENÉ DUVOIR.
PL. 25-24.
Nous avons publié dans une de nos dernières livraisons (Février 1858)
les dessins d'un bâtiment destiné à l'établissement d'une blanchisserie
économique à Saint-Dié (Vosges).
M. RENÉ DUYOIR, qui s'occupe d'une manière toute spéciale des éta-
blissements de ce genre, nous adresse le travail suivant que nous nous
faisons un plaisir de reproduire, quoiqu'un mémoire plus étendu sur le
même sujet ait déjà été publié par lui dans l'excellente Revue d'archi-
tecture de M. CÉSAR DALY. L'absence de lavoirs publics économiques
et de blanchisseries perfectionnées dans la plupart des villes, est la meil-
leure preuve que l'on ne saurait trop insister sur la nécessité de multi-
plier ces utiles établissements.
Observations générales sur le blanchissage.
Le blanchissage, envisagé d'une manière générale, peut être décom-
posé en neuf opérations successives :
1° Le triage, opération qui a pour but de distribuer le linge à blan-
chir en plusieurs tas, suivant son degré de finesse et de propreté.
2° Le trempage ou première imbibition d'eau froide que l'on fait
ordinairement subir au linge dans de grands baquets.
3° L'essaiigeage ou lavage du linge, aussi dans l'eau froide pour le
nettoyer une première fois. Cette opération , faite presque toujours
d'une manière brutale au moyen de battes en bois, est souvent nuisible
au linge.
4* Le coulage, qui consiste à faire passer à travers le linge une dis-
solution alcaline très-étendue de soude ou de potasse (les cendres de
bois servent aussi à cet usagé). Cette dissolution doit être'presque à
l'état d'ébullition pour que son effet soit complet. C'est là l'opération
capitale du blanchissage.
5° Le savonnage, dont le but est d'enlever complètement les taches
qui auraient résisté aux opérations précédentes.
6° Le rinçage, complément du savonnage pour enlever l'eau de savon.
7° Végoultage, dont le nom indique assez l'objet.
■"• 8° Le séchage, qui doit compléter l'évaporation de l'eau contenue
dans le linge.
9° Enfin, le pliage et le repassage, auquel se rattache le raccommo-
dage des .déchirures.
On conçoit de prime abord que ces travaux successifs doivent être
distribués dans une blanchisserie de telle façon que les pièces affectées
à leur usage se trouvent placées dans un ordre de succession analogue
à celui qui existe entre les diverses opérations, ainsi que nous venons
de l'indiquer, de manière que le service de l'une n'entrave pas le ser-
vice de l'autre. Ce n'est cependant pas ce que l'on rencontre dans
toutes les blanchisseries. Trop souvent, même dans des constructions
élevées spécialement pour cet usage, on voit les différents services con-
fondus ensemble ou trop écartés les uns des autres. Ainsi tous les ser-
vices relatifs au lessivage se trouvent dans un bâtiment, tandis que tous
ceux relatifs au séchage sont placés dans un autre ; de là perte de temps
pour les transports et complication dans le travail. Nous nous sommes
donc posé pour problème à résoudre, de construire une blanchisserie
disposée de telle façon que tous les travaux pussent se faire simultané-
ment, sans interruption, et de manière à employer le moins de bras et
de temps possible.
Mais la solution du problème général d'une bonne blanchisserie ren-
ferme celle d'un problème particulier, celui du coulage des lessives.
Nous examinerons d'abord ce détail isolément, et nous reprendrons
ensuite l'élude de l'ensemle d'une blanchisserie.
Description du nouvel appareil de lessivage par circulation.
PL. 23.
Le coulage des lessives, tel qu'il est fait ordinairement présente de
graves inconvénients : dans ce système, on fait chauffer la lessive dans
une chaudière en fonte, en tôle ou en cuivre, placée dans un massif
de maçonnerie au-dessus d'un foyer à bois ou à charbon; un robinet,
adapté à la partie inférieure de la chaudière, sert à faire couler la les-
sive, arrivée à l'état d'ébullition, dans des seaux que l'on vide ensuite
dans le cuvier où se trouve le linge déjà trempé. Ce cuvier, tout à fait
indépendant de la chaudière, placé à un niveau supérieur, est recou-
vert d'une toile grossière ou charrier, sur laquelle on place de la cendre
de bois.
L'eau chaude versée sur la cendre s'empare peu à peu des sels solu-
bles que celle-ci renferme, et forme une dissolution alcaline qu'on
nomme lessive, et qui n'agit, comme moyen de blanchiment, que par
le carbonate de potasse qu'elle contient. On forme, souvent et avec
avantage la lessive en mettant avec l'eau dans la chaudière une quantité
déterminée de sel de soude ou. de potasse pour donner à l'eau le même
degré alcalimétrique. La lessive filtre à travers la toile et tombe sur le
linge, qu'elle traverse avant d'arriver au fond du cuvier. Un robinet
placé au bas du cuvier lui donne issue'sur un conduit en bois ou en
tôle qui la verse dans la chaudière, où elle entre de nouveau en ébul-
lition pour être renversée ensuite dans le cuvier. Quelquefois la chau-
dière n'est pas même munie d'un robinet, et il faut puiser la lessive à la
main.
Ce système grossier présente les inconvénients suivants :
La vapeur qui se dégage de la lessive pendant le transvasement em-
plit la pièce destinée à ce service, obscurcit l'air, se condense sur les
plafonds et sur les murs, qu'elle détériore, et occasionne une perle de
chaleur, et, par suite, de combustible, qui devient considérable quand
on agit sur une grande échelle.
Le transport et le transvasement rendent le service pénible, occupent
des bras, sont l'occasion d'une écoulement d'eau qui salit le sol; nou-
velle perte de chaleur.
. Ensuite, quelque soin.qu'apportent à leur besogne les hommes
chargés du transvasement, la lessive arrive au cuvier à des températures
inégales, et trop souvent ils sont victimes d'accidents dus à leur im-
prudence.
Enfin, un coulage fait par ce procédé n'exige guère moins de dix à
douze heures de travail.
Dans l'appareil que nous allons décrire, ces inconvénients disparais-
sent, comme nous le verrons plus loin.
La PL. 25 représente deux de ces appareils placés l'un près de l'autre,
ainsi qu'ils doivent l'être dans la buanderie.
La fig. 1 donne l'élévation de l'une, et une coupe verticale de l'autre,
faite suivant la ligne brisée jklm de la fig. 2, de manière à montrer le
mode de circulation de la lessive. La fig. 2 représente le plan de ces
mêmes appareils à des hauteurs différentes.
A est une chaudière cylindrique en cuivre dont le couvercle est main-
tenu exactement fermé au moyen d'une vis de pression ; sur ce cou-
vercle est disposée une soupape à flotteur, qui ne s'ouvre que quand le
niveau du liquide est descendu à une certaine limite.
BB' (fig. 1), cuviers dont les douves, en bois de chêne épais, sont
maintenues par des cercles de fer. A une petite distance du fond de
chaque cuvier se trouve une grille en bois ee (fig. 1 et 2) supportée par
des morceaux de bois découpés en arcade, afin de ménager à la lessive
NOUVELLES ANNALES DE LA CONSTRUCTION. -- MAI 18.58.
5(5
dine est un obstacle incommode, et les clapets ne pouvant s'ouvrir
complètement,' le débouché offert à l'eau n'est pas complet. L'avantage
duconlre-dêbutemenl des clapets, qui est très-réel quand ceux-ci sont
entièrement à fond, devient tout à fait illusoire dès que l'on commence
à les ouvrir; aussi M. BONNIN n'a-t-il pu échapper à la nécessité
d'ajouter de petits clapets auxiliaires pour établir la contre-pression
derrière les clapets principaux avant de les ouvrir.
Aux avantages du robinet BONNIN, celui de M. DEVANNE (fig. 1,2,
3,4) ajoute ceux d'une grande simplicité et d'une construction plus
économique, puisqu'il n'y a qu'un clapet au lieu de quatre. Le dé-
bouché est très-large et la veine fluide n'a à subir qu'une déviation à
peine/sensible en franchissant le seuil formé par le bas du siège. Enfin,
l'écrou étant guidé, la vis travaille toujours dans le sens de son axe
sans avoir aucun effet latéral à supporter.
L'expérience a prouvé qu'il était indispensable, pour rendre le robinet
étanche, de dresser sur le tour le siège et le bord du clapet entre lesquels
le caoutchouc doit être pincé. Ce dernier est cousu sur le bord du clapet
avec un double fil de laiton que l'on enlace autour de dents venues à
la fonte tant en dedans qu'en dehors du clapet. Les trous par lesquels
on introduit la broche de la charnière du clapet sont fermés par des
bouchons en laiton rendus étanches au moyen d'un cordon de chanvre
suifé.
Cinq de ces robinets fonctionnent à Bordeaux de la manière la plus
satisfaisante.
Remplacement des réservoirs d'air des conduites d'eau
par des régulateurs à poids et à soupape.
On remplace ■économiquement depuis quelque temps, en Angleterre,
les réservoirs d'air destinés à s'opposer aux coups de bélier dans les
conduites d'eau, par des cylindres à poids et à soupape permettant
l'échappement de l'eau à air libre.
"L'eau, poussée.dansles tuyaux par les impulsions violentes auxquelles
donnent lieu toutes les distributions à grand développement, soulève un
piston chargé d'un poids calculé d'avance, et s'échappe jusqu'à ce que
la pression soit redevenue normale.
Ce système, qui ne présente pas les mêmes inconvénients matériels
que celui des réservoirs d'air, puisqu'il permet à l'eau excédante de se
déverser librement, fonctionne avec succès à la station du Great-
Western à Londres.
Appareil de lessivage et blancliisserie perfectionnée ■,
Système RENÉ DUVOIR.
PL. 25-24.
Nous avons publié dans une de nos dernières livraisons (Février 1858)
les dessins d'un bâtiment destiné à l'établissement d'une blanchisserie
économique à Saint-Dié (Vosges).
M. RENÉ DUYOIR, qui s'occupe d'une manière toute spéciale des éta-
blissements de ce genre, nous adresse le travail suivant que nous nous
faisons un plaisir de reproduire, quoiqu'un mémoire plus étendu sur le
même sujet ait déjà été publié par lui dans l'excellente Revue d'archi-
tecture de M. CÉSAR DALY. L'absence de lavoirs publics économiques
et de blanchisseries perfectionnées dans la plupart des villes, est la meil-
leure preuve que l'on ne saurait trop insister sur la nécessité de multi-
plier ces utiles établissements.
Observations générales sur le blanchissage.
Le blanchissage, envisagé d'une manière générale, peut être décom-
posé en neuf opérations successives :
1° Le triage, opération qui a pour but de distribuer le linge à blan-
chir en plusieurs tas, suivant son degré de finesse et de propreté.
2° Le trempage ou première imbibition d'eau froide que l'on fait
ordinairement subir au linge dans de grands baquets.
3° L'essaiigeage ou lavage du linge, aussi dans l'eau froide pour le
nettoyer une première fois. Cette opération , faite presque toujours
d'une manière brutale au moyen de battes en bois, est souvent nuisible
au linge.
4* Le coulage, qui consiste à faire passer à travers le linge une dis-
solution alcaline très-étendue de soude ou de potasse (les cendres de
bois servent aussi à cet usagé). Cette dissolution doit être'presque à
l'état d'ébullition pour que son effet soit complet. C'est là l'opération
capitale du blanchissage.
5° Le savonnage, dont le but est d'enlever complètement les taches
qui auraient résisté aux opérations précédentes.
6° Le rinçage, complément du savonnage pour enlever l'eau de savon.
7° Végoultage, dont le nom indique assez l'objet.
■"• 8° Le séchage, qui doit compléter l'évaporation de l'eau contenue
dans le linge.
9° Enfin, le pliage et le repassage, auquel se rattache le raccommo-
dage des .déchirures.
On conçoit de prime abord que ces travaux successifs doivent être
distribués dans une blanchisserie de telle façon que les pièces affectées
à leur usage se trouvent placées dans un ordre de succession analogue
à celui qui existe entre les diverses opérations, ainsi que nous venons
de l'indiquer, de manière que le service de l'une n'entrave pas le ser-
vice de l'autre. Ce n'est cependant pas ce que l'on rencontre dans
toutes les blanchisseries. Trop souvent, même dans des constructions
élevées spécialement pour cet usage, on voit les différents services con-
fondus ensemble ou trop écartés les uns des autres. Ainsi tous les ser-
vices relatifs au lessivage se trouvent dans un bâtiment, tandis que tous
ceux relatifs au séchage sont placés dans un autre ; de là perte de temps
pour les transports et complication dans le travail. Nous nous sommes
donc posé pour problème à résoudre, de construire une blanchisserie
disposée de telle façon que tous les travaux pussent se faire simultané-
ment, sans interruption, et de manière à employer le moins de bras et
de temps possible.
Mais la solution du problème général d'une bonne blanchisserie ren-
ferme celle d'un problème particulier, celui du coulage des lessives.
Nous examinerons d'abord ce détail isolément, et nous reprendrons
ensuite l'élude de l'ensemle d'une blanchisserie.
Description du nouvel appareil de lessivage par circulation.
PL. 23.
Le coulage des lessives, tel qu'il est fait ordinairement présente de
graves inconvénients : dans ce système, on fait chauffer la lessive dans
une chaudière en fonte, en tôle ou en cuivre, placée dans un massif
de maçonnerie au-dessus d'un foyer à bois ou à charbon; un robinet,
adapté à la partie inférieure de la chaudière, sert à faire couler la les-
sive, arrivée à l'état d'ébullition, dans des seaux que l'on vide ensuite
dans le cuvier où se trouve le linge déjà trempé. Ce cuvier, tout à fait
indépendant de la chaudière, placé à un niveau supérieur, est recou-
vert d'une toile grossière ou charrier, sur laquelle on place de la cendre
de bois.
L'eau chaude versée sur la cendre s'empare peu à peu des sels solu-
bles que celle-ci renferme, et forme une dissolution alcaline qu'on
nomme lessive, et qui n'agit, comme moyen de blanchiment, que par
le carbonate de potasse qu'elle contient. On forme, souvent et avec
avantage la lessive en mettant avec l'eau dans la chaudière une quantité
déterminée de sel de soude ou. de potasse pour donner à l'eau le même
degré alcalimétrique. La lessive filtre à travers la toile et tombe sur le
linge, qu'elle traverse avant d'arriver au fond du cuvier. Un robinet
placé au bas du cuvier lui donne issue'sur un conduit en bois ou en
tôle qui la verse dans la chaudière, où elle entre de nouveau en ébul-
lition pour être renversée ensuite dans le cuvier. Quelquefois la chau-
dière n'est pas même munie d'un robinet, et il faut puiser la lessive à la
main.
Ce système grossier présente les inconvénients suivants :
La vapeur qui se dégage de la lessive pendant le transvasement em-
plit la pièce destinée à ce service, obscurcit l'air, se condense sur les
plafonds et sur les murs, qu'elle détériore, et occasionne une perle de
chaleur, et, par suite, de combustible, qui devient considérable quand
on agit sur une grande échelle.
Le transport et le transvasement rendent le service pénible, occupent
des bras, sont l'occasion d'une écoulement d'eau qui salit le sol; nou-
velle perte de chaleur.
. Ensuite, quelque soin.qu'apportent à leur besogne les hommes
chargés du transvasement, la lessive arrive au cuvier à des températures
inégales, et trop souvent ils sont victimes d'accidents dus à leur im-
prudence.
Enfin, un coulage fait par ce procédé n'exige guère moins de dix à
douze heures de travail.
Dans l'appareil que nous allons décrire, ces inconvénients disparais-
sent, comme nous le verrons plus loin.
La PL. 25 représente deux de ces appareils placés l'un près de l'autre,
ainsi qu'ils doivent l'être dans la buanderie.
La fig. 1 donne l'élévation de l'une, et une coupe verticale de l'autre,
faite suivant la ligne brisée jklm de la fig. 2, de manière à montrer le
mode de circulation de la lessive. La fig. 2 représente le plan de ces
mêmes appareils à des hauteurs différentes.
A est une chaudière cylindrique en cuivre dont le couvercle est main-
tenu exactement fermé au moyen d'une vis de pression ; sur ce cou-
vercle est disposée une soupape à flotteur, qui ne s'ouvre que quand le
niveau du liquide est descendu à une certaine limite.
BB' (fig. 1), cuviers dont les douves, en bois de chêne épais, sont
maintenues par des cercles de fer. A une petite distance du fond de
chaque cuvier se trouve une grille en bois ee (fig. 1 et 2) supportée par
des morceaux de bois découpés en arcade, afin de ménager à la lessive
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 95.56%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 95.56%.
- Collections numériques similaires Corpus : Art de l'ingénieur Corpus : Art de l'ingénieur /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp15"Cosmos (1852) /ark:/12148/bd6t51143731d.highres Archives des découvertes et des inventions nouvelles faites dans les sciences, les arts et les manufactures, tant en France que dans les pays étrangers pendant l'année ... : avec l'indication succincte des principaux produits de l'industrie française ; la liste des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, accordés par le gouvernement pendant la même année, et des notices sur les prix proposés ou décernés par différentes sociétés savantes, françaises et étrangères, pour l'encouragement des sciences et des arts /ark:/12148/bd6t53887780b.highresThématique : ingénierie, génie civil Thématique : ingénierie, génie civil /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm02"
- Auteurs similaires Oppermann Charles Alfred Oppermann Charles Alfred /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Oppermann Charles Alfred" or dc.contributor adj "Oppermann Charles Alfred")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 4/8
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k56657714/f4.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k56657714/f4.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k56657714/f4.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k56657714
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k56657714
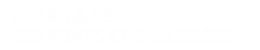


Facebook
Twitter