Titre : Annales des ponts et chaussées : mémoires et documents relatifs à l'art des constructions et au service de l'ingénieur
Auteur : École nationale des ponts et chaussées (France). Auteur du texte
Éditeur : Commission des Annales (Paris)
Éditeur : A. Dumas (Paris)
Éditeur : Commission des AnnalesCommission des Annales (Paris)
Éditeur : ESI publicationsESI publications (Paris)
Éditeur : SPPIFSPPIF (Paris)
Éditeur : LavoisierLavoisier (Paris)
Date d'édition : 1989-04-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34351991b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Description : 01 avril 1989 01 avril 1989
Description : 1989/04/01 (N50)-1989/06/30. 1989/04/01 (N50)-1989/06/30.
Description : Collection numérique : Collections de l’École... Collection numérique : Collections de l’École nationale des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Corpus : le corps des... Collection numérique : Corpus : le corps des ingénieurs des ponts et chaussées
Description : Collection numérique : Thématique :... Collection numérique : Thématique : administration publique, sciences humaines et sociales
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k13423331
Source : Ecole nationale des ponts et chaussées, P277
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 13/06/2021
4. LA DEFINITION DU TRACE
La définition du tracé a résulté de la prise en compte des contraintes géométriques d'un ouvrage ferroviaire
et des contraintes géotechniques.
Un ouvrage ferroviaire exploité par des trains circulant à une vitesse maximale de 200 kmh ~ 1 impose au
tracé des contraintes géométriques sévères tant en ce qui concerne les rayons de courbure que les pentes longi
tudinales. Ainsi pour les tunnels ferroviaires, les conditions géométriques sont les suivantes :
— rayon de courbure dans le plan horizontal > 4 200 m,
— rayon de courbure dans le plan vertical > 15 000 m,
— 1,8 %o < pente longitudinale < 1 %o.
Dès les premières études, la Craie Bleue a été considérée comme la formation la meilleure pour la réalisa
tion d'un tunnel foré, car elle présente une perméabilité faible tout en ayant des caractéristiques de résistance et
de déformabilité suffisamment élevées.
Des analyses même sommaires montrent que la résistance maximale de la Craie Bleue n'est jamais atteinte
autour des excavations.
Par contre, il est apparu nécessaire d'éviter de pénétrer dans l'Argile du Gault dont les caractéristiques méca
niques sont notoirement plus faibles et qui peut développer des pressions de gonflement. Ces pressions de gonfle
ment avaient bien été mises en évidence dans les tronçons expérimentaux revêtus de la Galerie de Sangatte.
Par ailleurs, il convenait d'éviter que la clef des ouvrages soit trop proche d'horizons beaucoup plus -oer
méables sus-jacents comme il a été indiqué ci-dessus.
Pour optimiser le tracé, le groupement d'entreprises Trans Manche Link s'est appuyé sur une étude géesta
tistique de l'ensemble des données géologiques. Cette étude réalisée par le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières et le Bureau d'Études Mott Hay Anderson a consisté à créer un fichier informatique donnant les cotes
des différentes couches géologiques avec une estimation des écart-types. L'écart-type sur la cote du toit de l'Argile
du Gault varie de 2 m à 6 m mais sur les 3/4 du tracé, il est seulement de 2 m à 3 m.
Le calage du tracé a été beaucoup plus aisé sur la partie anglaise, la plus grande complexité des structu-es,
et le pendage plus fort des couches l'a rendu plus délicat du côté français. Il a été par ailleurs inévitable dans la
partie sous-terrestre de traverser la Craie Grise et la Craie du Turonien beaucoup plus fracturées et per
méables (fig. 1).
5. LE CHOIX DES MODES DE CONSTRUCTION
Dès la fin du xixe siècle, les tunneliers du colonel Beaumont avaient montré que le creusement mécanique
de la craie était relativement aisé. La nécessité pour tenir les délais de construction d'obtenir à la fois des vite-ses
de creusement et une cadence de mise en place du revêtement rapides a conduit les entrepreneurs à faire appel à
des méthodes de creusement très mécanisées pour les tunnels ferroviaires et la galerie de service avec pose simulta
née d'anneaux de voussoirs préfabriqués.
Les modes de creusement ont également été définis en fonction des risques liés à la rencontre de zones aqui
fères sous forte charge hydrostatique (100 m d'eau). Une reconnaissance systématique à l'avancement par forages
était donc indispensable afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires alors que le front de taille se trouve
encore à une distance suffisante de la zone fracturée ou de la faille aquifère. Les vitesses d'avancement maximales
prévues étant élevées, de l'ordre de 60 m/jour, il est nécessaire de pouvoir réaliser un forage de 80 m à partir du
front de taille assurant par conséquent une garde minimum de 20 m. Sur le chantier français, cette opération est
prévue pendant le poste de maintenance de 6 heures. Il s'agit d'un forage destructif avec enregistrement de para
mètres, l'enfin de forage étant à demeure sur le tunnelier. Les tiges de forage sont en aluminium de manière à
pouvoir être éventuellement détruites par le tunnelier.
Le risque de traversée de zones aquifères étant beaucoup plus élevé sur le chantier français tant en ce «jui
concerne la partie sous-terrestre que la partie sous-marine, les choix des modes de creusement ont été différents
sur le site anglais et le site français.
Les entrepreneurs anglais ont choisi des tunneliers fonctionnant en mode ouvert, c'est-à-dire sans pression de
stabilisation du front de taille. Le revêtement n'est pas étanche ; il est constitué d'anneaux de voussoirs expansés
contre le terrain. Par conséquent, les zones aquifères éventuelles devront être traitées à l'avancement
par injections.
Les tunneliers sur le chantier français peuvent fonctionner en mode ouvert ou en mode fermé. Dans ce cas,
il s'établit dans la chambre de creusement qui est isolée une pression de stabilisation du front de taille égale à
la pression hydrostatique dans le terrain. De tels tunneliers ont déjà été utilisés mais pour des tunnels peu pro
fonds et fonctionnant par conséquent avec des pressions beaucoup plus faibles. Les revêtements sont alors consti
30
Annales de Ponts et Chaussées - 2e trim. 1989
La définition du tracé a résulté de la prise en compte des contraintes géométriques d'un ouvrage ferroviaire
et des contraintes géotechniques.
Un ouvrage ferroviaire exploité par des trains circulant à une vitesse maximale de 200 kmh ~ 1 impose au
tracé des contraintes géométriques sévères tant en ce qui concerne les rayons de courbure que les pentes longi
tudinales. Ainsi pour les tunnels ferroviaires, les conditions géométriques sont les suivantes :
— rayon de courbure dans le plan horizontal > 4 200 m,
— rayon de courbure dans le plan vertical > 15 000 m,
— 1,8 %o < pente longitudinale < 1 %o.
Dès les premières études, la Craie Bleue a été considérée comme la formation la meilleure pour la réalisa
tion d'un tunnel foré, car elle présente une perméabilité faible tout en ayant des caractéristiques de résistance et
de déformabilité suffisamment élevées.
Des analyses même sommaires montrent que la résistance maximale de la Craie Bleue n'est jamais atteinte
autour des excavations.
Par contre, il est apparu nécessaire d'éviter de pénétrer dans l'Argile du Gault dont les caractéristiques méca
niques sont notoirement plus faibles et qui peut développer des pressions de gonflement. Ces pressions de gonfle
ment avaient bien été mises en évidence dans les tronçons expérimentaux revêtus de la Galerie de Sangatte.
Par ailleurs, il convenait d'éviter que la clef des ouvrages soit trop proche d'horizons beaucoup plus -oer
méables sus-jacents comme il a été indiqué ci-dessus.
Pour optimiser le tracé, le groupement d'entreprises Trans Manche Link s'est appuyé sur une étude géesta
tistique de l'ensemble des données géologiques. Cette étude réalisée par le Bureau de Recherches Géologiques et
Minières et le Bureau d'Études Mott Hay Anderson a consisté à créer un fichier informatique donnant les cotes
des différentes couches géologiques avec une estimation des écart-types. L'écart-type sur la cote du toit de l'Argile
du Gault varie de 2 m à 6 m mais sur les 3/4 du tracé, il est seulement de 2 m à 3 m.
Le calage du tracé a été beaucoup plus aisé sur la partie anglaise, la plus grande complexité des structu-es,
et le pendage plus fort des couches l'a rendu plus délicat du côté français. Il a été par ailleurs inévitable dans la
partie sous-terrestre de traverser la Craie Grise et la Craie du Turonien beaucoup plus fracturées et per
méables (fig. 1).
5. LE CHOIX DES MODES DE CONSTRUCTION
Dès la fin du xixe siècle, les tunneliers du colonel Beaumont avaient montré que le creusement mécanique
de la craie était relativement aisé. La nécessité pour tenir les délais de construction d'obtenir à la fois des vite-ses
de creusement et une cadence de mise en place du revêtement rapides a conduit les entrepreneurs à faire appel à
des méthodes de creusement très mécanisées pour les tunnels ferroviaires et la galerie de service avec pose simulta
née d'anneaux de voussoirs préfabriqués.
Les modes de creusement ont également été définis en fonction des risques liés à la rencontre de zones aqui
fères sous forte charge hydrostatique (100 m d'eau). Une reconnaissance systématique à l'avancement par forages
était donc indispensable afin de pouvoir prendre les dispositions nécessaires alors que le front de taille se trouve
encore à une distance suffisante de la zone fracturée ou de la faille aquifère. Les vitesses d'avancement maximales
prévues étant élevées, de l'ordre de 60 m/jour, il est nécessaire de pouvoir réaliser un forage de 80 m à partir du
front de taille assurant par conséquent une garde minimum de 20 m. Sur le chantier français, cette opération est
prévue pendant le poste de maintenance de 6 heures. Il s'agit d'un forage destructif avec enregistrement de para
mètres, l'enfin de forage étant à demeure sur le tunnelier. Les tiges de forage sont en aluminium de manière à
pouvoir être éventuellement détruites par le tunnelier.
Le risque de traversée de zones aquifères étant beaucoup plus élevé sur le chantier français tant en ce «jui
concerne la partie sous-terrestre que la partie sous-marine, les choix des modes de creusement ont été différents
sur le site anglais et le site français.
Les entrepreneurs anglais ont choisi des tunneliers fonctionnant en mode ouvert, c'est-à-dire sans pression de
stabilisation du front de taille. Le revêtement n'est pas étanche ; il est constitué d'anneaux de voussoirs expansés
contre le terrain. Par conséquent, les zones aquifères éventuelles devront être traitées à l'avancement
par injections.
Les tunneliers sur le chantier français peuvent fonctionner en mode ouvert ou en mode fermé. Dans ce cas,
il s'établit dans la chambre de creusement qui est isolée une pression de stabilisation du front de taille égale à
la pression hydrostatique dans le terrain. De tels tunneliers ont déjà été utilisés mais pour des tunnels peu pro
fonds et fonctionnant par conséquent avec des pressions beaucoup plus faibles. Les revêtements sont alors consti
30
Annales de Ponts et Chaussées - 2e trim. 1989
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 98.73%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 98.73%.
- Collections numériques similaires Corpus : le corps des ingénieurs des ponts et chaussées Corpus : le corps des ingénieurs des ponts et chaussées /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCcorp08"Transactions philosophiques de la Société royale de Londres /ark:/12148/bd6t53888100j.highres Annales des arts et manufactures, ou Mémoires technologiques sur les découvertes modernes concernant les arts, les manufactures, l'agriculture et le commerce / par R. O'Reilly,... /ark:/12148/bd6t53888030b.highresThématique : administration publique, sciences humaines et sociales Thématique : administration publique, sciences humaines et sociales /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=colnum adj "EnPCthèm04"
- Auteurs similaires École nationale des ponts et chaussées École nationale des ponts et chaussées /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "École nationale des ponts et chaussées" or dc.contributor adj "École nationale des ponts et chaussées")Notes sur le cours d'hydraulique. 1841 à 1842 : récapitulation préliminaire des notions essentielles de la dynamique / Jean-Baptiste Bélanger /ark:/12148/bd6t54644538r.highres Introduction au cours de construction. Notes prises par les élèves : notions succinctes sur le levé des plans, le nivellement, la cubature [cubage] des terrasses et le mouvement des terres / M Cavalier, professeur, M Baron, professeur adjoint /ark:/12148/bd6t546445395.highres
-
-
Page
chiffre de pagination vue 31/35
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k13423331/f31.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k13423331/f31.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k13423331/f31.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k13423331
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://heritage.ecoledesponts.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k13423331
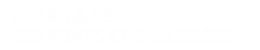


Facebook
Twitter